
 Flux RSS
Flux RSS

«Faut-il aborder la question de la sexualité, et notamment les différentes orientations sexuelles, dès l'école primaire ? » La demande est revenue sur la table ce mercredi 16 octobre 2019 dans le cadre des nouveaux référentiels du cours d’éducation et santé. De plus, la nouvelle ministre francophone de l’Enseignement y est favorable.
À la vue de cette question, je ne peux que vous conseiller la lecture de la bande dessinée "Je suis qui ? Je suis quoi ?" éditée au Éditions Casterman. C’est aussi l’occasion de partager avec vous l’entretien que j’ai eu avec Jean-Michel Billioud, scénariste de cette bande dessinée.
Qui a eu l’idée de créer ce livre et comment cela s’est-il déroulé ?
À l’origine, l’idée a été proposée par Sophie Nanteuil. Un jour où elle est allée rechercher son fils à l’école primaire, elle a eu une conversation avec l’enseignante. Cette dernière lui a confié « Je suis embêtée, j’ai dans ma classe un petit garçon qui m’a avoué être amoureux d’un autre petit garçon et je ne vois pas vraiment comment l’aider dans une telle situation ». Au début de l’aventure, nous ne nous imaginions pas qu’elle allait être aussi bouleversante et captivante. Nous avons fait appel aux témoignages de nombreuses personnes selon leurs différentes orientations sexuelles. Nous voulions faire de cette thématique un livre collectif abordable par le grand public, mais aussi répondre aux questions des plus jeunes, enfants et adolescents.
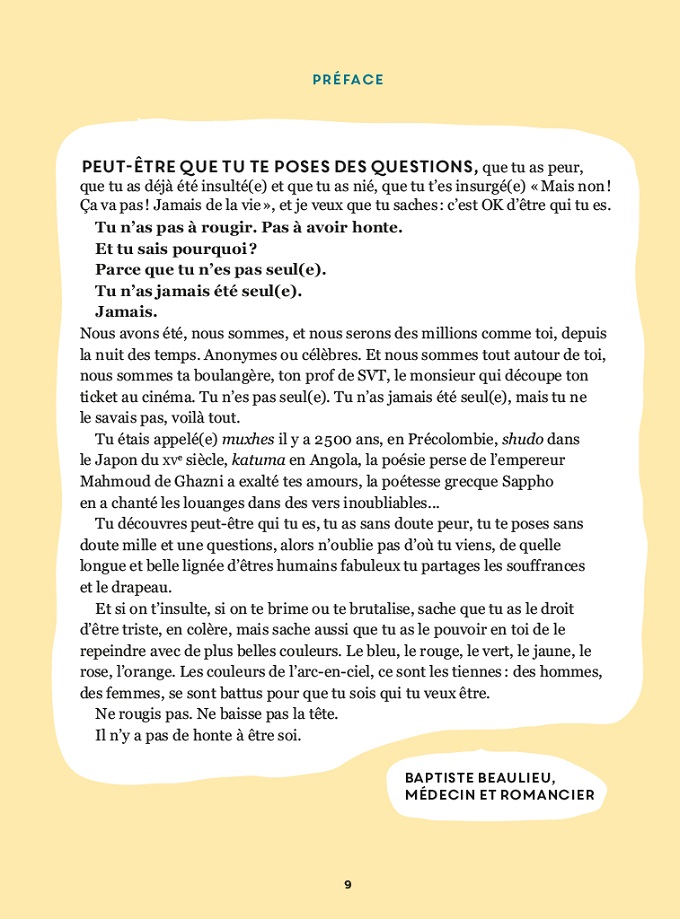
© Jean-Michel Billioud – Sophie Nanteuil – Zelda Zong – Terkel Risbjerk -Casterman
À partir de quel âge, peut-on considérer que le livre est abordable ?
Pour moi, à partir de 11 ans. J’ai moi-même vécu une scolarité qui a duré une douzaine d’années et jamais les sujets traités dans ce livre n’ont fait surface durant ma scolarité. Pourtant, je suis certain qu’ils étaient déjà présents à mon époque, mais sont restés cachés chez mes camarades car considérés comme difficiles et intimes, donc tabous.
Qui est à l’origine du tableau permettant à chacun de se situer ?
C’est aussi l’idée de Sophie Nanteuil. Ce tableau est essentiel, car sans vouloir classifier les individus, il permet à chacun de se « situer » dans la catégorie qui lui convient le mieux. Certains lecteurs vont même en découvrir des nouvelles. Nous avons obtenu des témoignages pour chaque catégorie présentée, c’est l’une des forces de ce livre. Aussi, on en profite pour tordre aussi le cou à beaucoup d’idées préconçues véhiculées par les médias (Exemple : non, tous les gays ne sont pas efféminés). On y aborde aussi le sujet essentiel instaurant la construction d’une relation entre individus : l’explication du consentement. Nous avons aussi beaucoup travaillé en collaborations avec les responsables de diverses associations présentes aux côtés des personnes en difficultés. En fin d’ouvrage, l’ensemble de coordonnées de celles-ci sont présentes.

© Jean-Michel Billioud – Sophie Nanteuil – Zelda Zong – Terkel Risbjerk -Casterman
Quels ont été les premières réactions lors de la sortie du livre ?
Il vient de de sortir, c’est donc encore un peu tôt pour se faire une idée mais les premières réactions sont positives. Le livre a été présenté en avant-première à de nombreux responsables de bibliothèque et médiathèque qui l’ont immédiatement mis en avant.

© Jean-Michel Billioud – Sophie Nanteuil – Zelda Zong – Terkel Risbjerk -Casterman
Votre actualité coïncide aussi avec la sortie d’un autre livre intitulé « Les combattants ». Dans cet ouvrage, vous présentez le combat de trente personnalités diverses ayant pour but d’améliorer le quotidien des hommes. Comment avez-vous procédé pour sélectionner ces diverses personnalités ?
Au départ, nous avons porté notre choix sur des personnages qui nous ont fascinés. Ensuite d’autres, moins connus du grand public, se sont ajoutés. Chaque personnalité est évoquée sur quatre pages comprenant une description de leur combat à leur époque, une mini bande dessinée et un regard sur la situation actuelle de leur action menée.
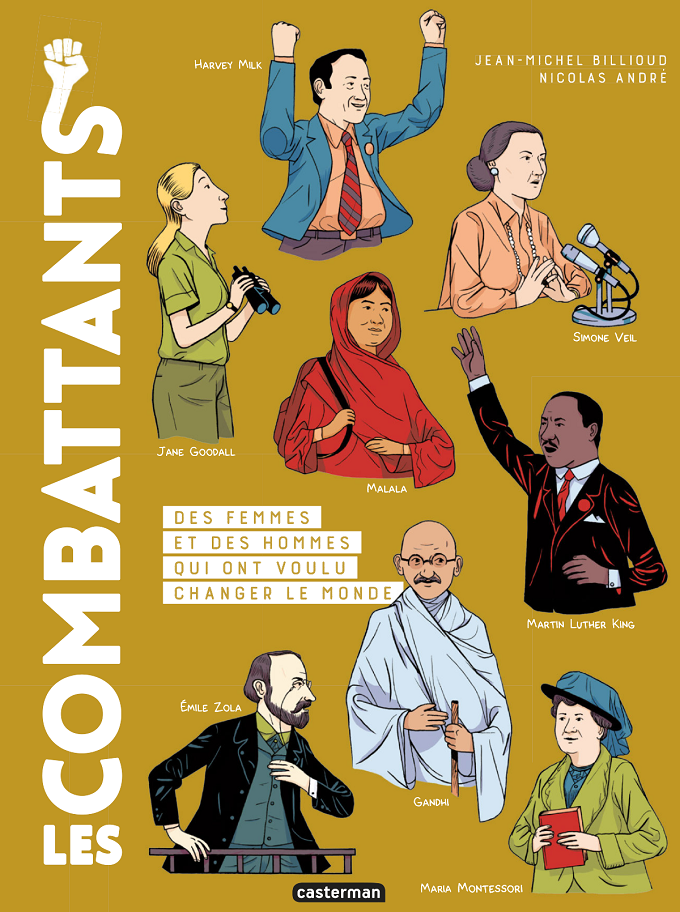
© Jean-Michel Billioud – Nicolas André -Casterman
Avez-vous un regret par rapport à une personne « oubliée » qui aurait pu figurer parmi la sélection ?
Oui, on aurait dû y intégrer le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui a soigné des milliers de victimes de violences sexuelles des guerres oubliées dans l’est de la République démocratique du Congo.

On y trouve Ernesto Che Guevara, pourquoi ce choix ?
Vis-à-vis de son combat pour la liberté des peuples sud-américains contre l’impérialisme américain.

Quid du combat de Greta Thunberg ?
Elle est encore fort jeune, vient d’apparaître sur l'échiquier mondial ! Où sera-t-elle dans trois ans ?
C’est la première fois que vous collaborez avec les Éditions Casterman, d’autres projets sont-ils prévus ?
Oui, mais c'est encore trop tôt pour en parler.
Quelques mots pour défendre « Les combattants » ?
Nous avons voulu réaliser un livre didactique multi-générationnel. Avec cette série de portraits (15 hommes et 15 femmes), nous parlons de l’engagement de ces personnalités dans leurs combats individuels afin de tenter d’améliorer notre vie actuelle.
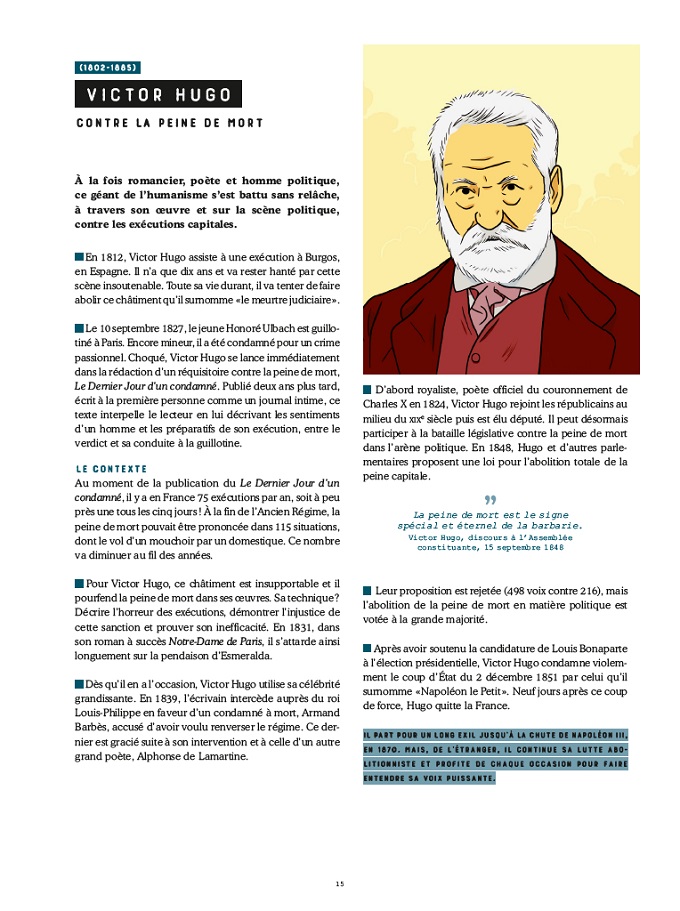
© Jean-Michel Billioud – Nicolas André -Casterman
Propos recueillis par Haubruge Alain

« Bijou, bijou
Pense à tes rendez-vous
Rappeler le gynéco, passer à la banque prendre des sous
Trouver quelqu’un d’autre
Moi je mets les bouts »

© Bernard/Loustal chez Casterman
Vous connaissez ça ? C’est du Bashung, plaqué or. Et depuis que je connais cette chanson, j’ai du mal à voir le mot bijou apparaître sous mes yeux sans penser à quelques notes de cette chanson. « Bijou, bijou ». Alors, vous imaginez bien que quand le nouveau Loustal, accompagné du toujours surprenant Fred Bernard, est arrivé sous mes doigts… j’ai fredonné. Sans savoir que le duo avait réservé une place de choix à l’Immortel. Interview avec Jacques De Loustal qui se fait plaisir en faisant encore de la BD mais dans une forme peu conventionnelle.

© Jorge Colombo
Bonjour Jacques, c’est avec un bijou dont les feux éclairent les époques que vous nous revenez. Mais, est-ce encore de la BD ?
J’aime changer les formats, c’est vrai. Ici, c’est un retour à ce que je faisais au tout début : des grandes images et des textes off. Je crois que je ne ferai plus que ça. Je me suis amusé sur le story-board, j’avais l’impression de faire mes films. Ce n’est pas pour rien que le cinéma est une influence générale.
En réalité, j’ai de plus en plus de mal à subir les contraintes : les découpages, le fait de devoir dessiner une voiture sous plusieurs angles, de faire intervenir les mêmes personnages qui tournent dans une maison ou des décors. J’ai envie de faire de la BD en en gardant le plaisir. Du coup, je me suis mis à l’affût et j’ai demandé à mon éditrice de me trouver un projet sur lequel je pourrais imaginer deux images par page. Dans la veine de ce que je pouvais faire avec Paringaux dans Métal Hurlant et Rock & Folk. J’aime l’idée d’images fixes, aux proportions d’un écran de cinéma. En adaptant le Colorado de Lehane, je m’étais beaucoup amusé avec des découpages très cinématographiques.
Comment Fred Duval est-il arrivé dans votre univers, du coup ?
Sur proposition de mon éditrice qui m’a présenté son texte. Sans avoir jamais collaboré avec lui, je le connaissais. J’ai lu son histoire et elle me semblait convenir au format que je voulais adopter.
Je ne travaille jamais avec des scénaristes classiques de toute façon. Me dire ce que je dois dessiner, c’est insupportable.

© Bernard/Loustal chez Casterman
Pourtant, Fred Bernard est aussi dessinateur.
Les écrivains sont plus exigeants mais aussi fous de joie de voir naître les images. Par contre, ils refusent de toucher à une virgule. Avec Tonino Benacquista, j’ai compris qu’il ne fallait pas trop plaisanter. D’ailleurs, sur le projet qui nous occupe, je le soupçonne de se venger en me faisant changer mon dessin à certains moments. Mais ce projet me semble insurmontable : ce serait un projet de recueil de micro-fictions, un texte au dos de cartes postales. Je me chargerais du recto, Tonino du verso.
Fred, lui, a accepté que beaucoup de choses changent. Il m’appelait à chaque fois qu’un mot changeait. Nous nous sommes retrouvés à polir ce bijou.
J’imagine qu’il y a eu des ajustements.
Le texte a beaucoup bougé pour adopter ce ton distancié. Comme un film muet avec des textes dans des cartons, des intertitres. Ce sont ces sortes de légendes qui apportent la tension. Moi, je suis incapable de dynamiser. Ça a toujours été comme ça.

© Bernard/Loustal chez Casterman
Comme Lavilliers suivait les aventures d’un billet de banque, vous vous êtes lancé à la poursuite de ce bijou qui a tant fait tourner les têtes.
Vous savez, je collectionne, j’accumule. Des bronzes, des statues, des objets d’art… Je n’ai aucune idée d’où ils étaient avant d’être chez moi. Et après, qui sait. D’autant qu’un bronze, ça dure.
Le procédé que nous utilisons n’est pas nouveau: nous suivons un objet que se refilent des personnages les uns aux autres. Il y avait eu le Violon Rouge, Winchester 73, auparavant.
Ce genre de récit impose des dessins et des lieux différents. D’ailleurs, au début, je me suis fait avoir, j’ai commencé à accumuler de la documentation. La démarche classique, quoi. Sauf que si je devais faire ça pour chaque image, je n’en serais pas sorti.
Comment avez-vous choisi les différents événements abordés ?
Tout est vrai si ce n’est dans les personnages, tous les propriétaires ont été inventés ! Avec une idée d’agenda, de calendrier. J’ai choisi de resituer les jours liés aux événements, mais sans les représenter forcément. J’ai opté pour le contre-champ, souvent. Bon, j’ai dû me forcer pour le naufrage du Titanic. Puis, il y a de l’humour. Il y a plusieurs intertitres nommés L’Homme Volant. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans cet album. Le dernier, c’est Gagarine, lors de son tour de la Terre. Nous avons essayé de parcourir tous les grands événements de 1894 à 2005.

© Bernard/Loustal chez Casterman
Sur ce projet, à la relecture, je me suis finalement rendu compte que j’avais mis beaucoup de moi, dans les détails. J’ai aimé aller dans le monde agricole, je me suis souvenu de ma mère et de la maison en Franche-Comté. Au final, c’est un travail plus proche de l’illustration que de la BD mais en empruntant ses codes, le ressort de la vitesse.
De quoi faire le tour de la terre.
Oui, nous nous sommes rendu compte que nous avions fait le tour du monde.
Cet album se serait bien prêté à un format à l’italienne, non ?
La seule fois où j’ai voulu un format à l’italienne, c’était pour Les amours insolentes, des histoires d’amours qui se terminent… bien – ce qui n’est pas évident – à portée universelle. Avec Tonino Benacquista. J’ai remarqué que c’était l’album qui avait le moins bien fonctionné. Si ce n’est en Corée, il n’a été traduit nulle part.
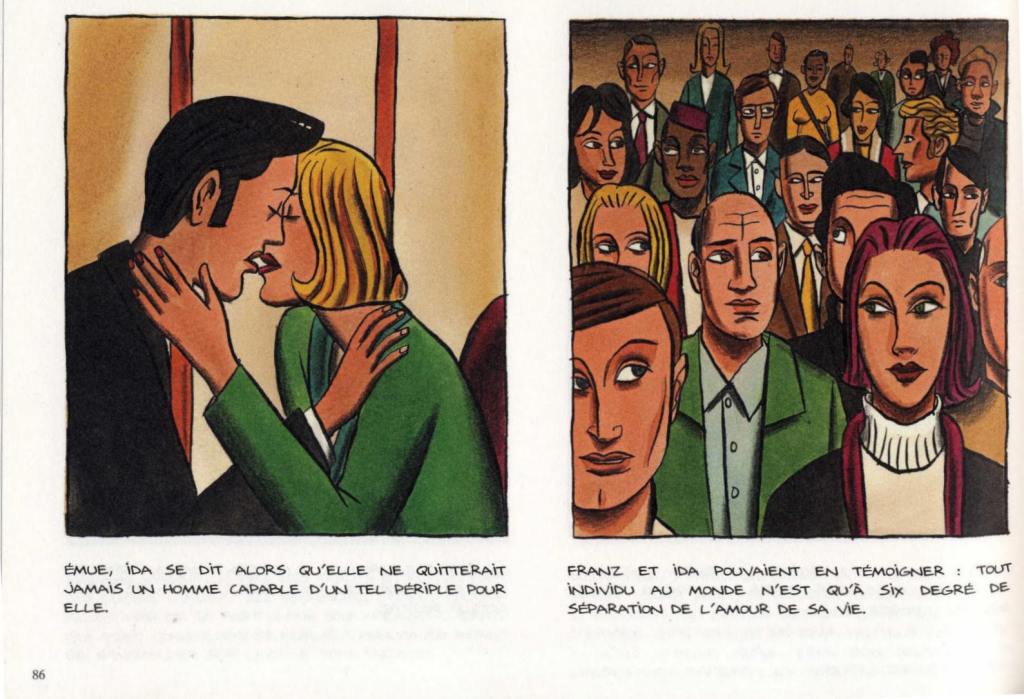
© Benacquista/Lousal chez Casterman
Et les contraintes ?
Elles n’en sont pas. Du moins, celles que je m’impose ne sont pas contraignantes. J’ai fait beaucoup de photos, de peintures, de dessins de voyage. Je maîtrise bien ce format.
Par contre, je ne comprendrai jamais comment les gens qui sont témoins de faits divers font pour filmer verticalement, avec du flou partout. Faut pas faire ça! Pourquoi ? Au début, on disait qu’ils se planquaient. Mais désormais, ils n’ont aucune honte à filmer de cette manière. C’est devenu un genre en soi.

© Bernard/Loustal chez Casterman
Parlons de votre titre !
Je suis retombé sur la mort de Bashung qui a sa place dans le livre ! Et son « Bijou bijou » qui m’a trotté en tête. Nous ne pouvions pas l’utiliser tel quel, problèmes de droit. Du coup, nous avons galéré. Il y avait Ô bijou, mais je le trouvais nul. Je me voyais déjà, à chaque interview, devoir l’expliquer.
Comment l’avez-vous choisi ce bijou ?
Il en fallait un qui soit assez gros. Qui brille. Je ne suis pas connaisseur. Je me suis donc renseigné, sur la manière de tailler aussi, puisqu’il va au long de son périple changer de forme. C’est amusant de trouver tous les docs dont on a besoin sur Google. Cela dit, je ne devais pas oublier que je ne pouvais pas faire de gros plans sur ce bijou. Je devais rester dans le cadre… puis y poser les personnages.

© Bernard/Loustal chez Casterman
Comment avez-vous dessiné cet album ?
J’ai redécouvert le dessin à la plume, puis l’aquarelle rehaussée avec des accents de crayon noir. Avec des raccords à l’encre de chine.
Au début, cet album faisait 24 pages. C’est après que nous avons opté pour deux cases par dates. Mais, il fallait commencer le livre sur une page de gauche, pour coller et avoir une double-page par époque.

© Bernard/Loustal chez Casterman
Ici, c’est un travail que je pouvais interrompre, assez irrégulier. C’est d’ailleurs peut-être ce qui m’a manqué par rapport aux projets classiques que j’ai pu faire : l’attachement au héros, l’empathie. Avec Bijou, j’ai quitté le bouquin mais je n’ai quitté personne. Mais je persiste à dire que la BD, on doit en faire pour s’amuser. Ou alors pour combler un public, qui est un moteur génial. Mais je n’ai jamais trouvé ça.
Enfin, il y a Instagram pour se prouver qu’on a un public. Même Rochette et Juillard s’y sont mis (il rit).
Cela dit, il y a des scènes très BD, comme le Casse du siècle. Dedans, je me suis souvenu du tunnel dans Bobo, le roi de l’évasion.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Une exposition est-elle prévue?
Bijou, je pensais que ça intéresserait un galeriste. Rien ! Pour une fois, il y aurait eu des planches en couleurs directes.
L’autre actualité, c’est Simenon.
Alors, oui, une exposition à la Galerie Huberty-Breyne, pour les trente ans de la mort de Simenon. Il y a un moment j’avais signé dix couvertures pour des intégrales de nouvelles. Panoramiques.
J’ai voulu adapter Simenon en bande dessinée, j’avais fait la demande à Futuropolis. Il était impossible d’avoir les droits. Du coup, j’avais fait un Mac Orlan, proche de l’univers que je voulais évoquer, les années 30.

© Loustal
Et, un jour, j’ai reçu un coup de fil : Mylène Demongeot ! Marc Simenon, son mari, était un ami de José-Louis Bocquet et souhaitait illustrer les livres de son père. Marc est mort et John a poursuivi le travail. J’ai ainsi commencé ce travail avec Touristes de bananes. C’était Tahiti. Et comme une chanson d’Aznavour Un SDF paumé qui pense que la misère serait moins visible, plus douces au soleil.
En fait, je me suis leurré. Simenon, c’est un univers dont on découvre la richesse, qu’on apprécie au fur et à mesure qu’on vieillit. Ce n’est pas un auteur pour ado. Et il n’y avait aucun intérêt à adapter Simenon en BD. Ce qui m’importe, c’est son écriture. Je fais cinquante dessins par livre. Pour l’exposition, j’ai rajouté des légendes, des extraits des livres qui m’ont inspiré.
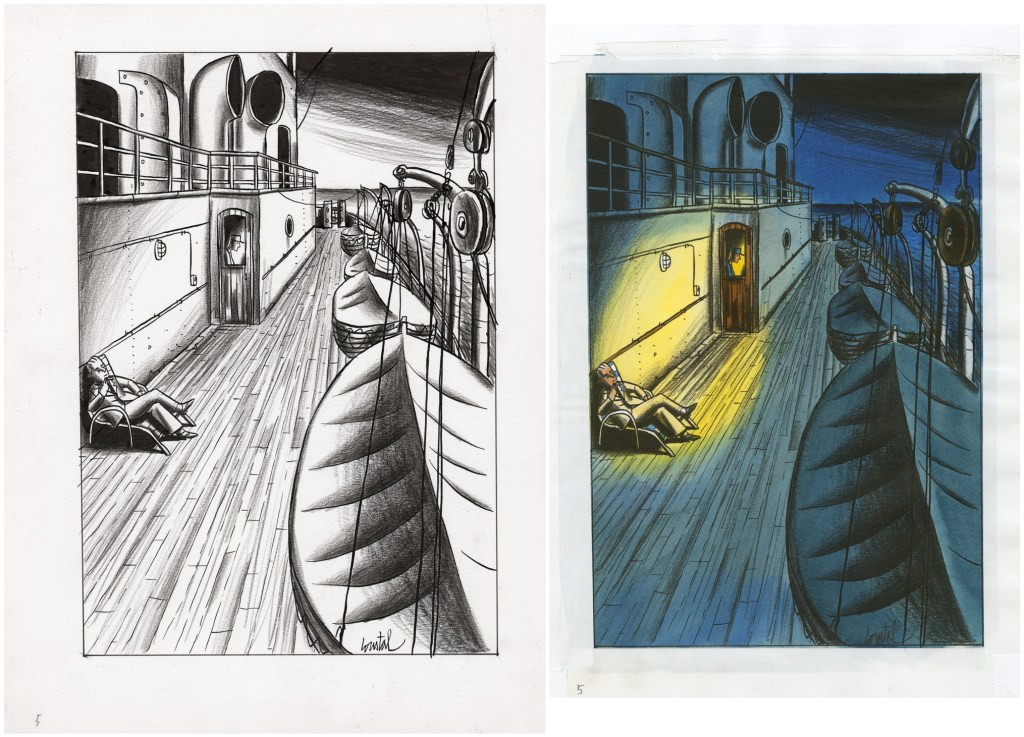
© Loustal
Il y a d’autres personnages que vous souhaiteriez adapter ?
Celui autour duquel j’ai le plus bordé, c’est Tintin. J’en ai fait des illustrations. J’ai hésité à les poster sur Instagram, de peur des représailles.
Merci Jacques et vivement le prochain voyage en BD ou ailleurs. Vous exposez jusqu’au 19 octobre à la Galerie Huberty-Breyne de Bruxelles.
Propos recueuillis par Alexis Seny
Titre: Bijou
Récit complet
Scénario: Fred Bernard
Dessin et couleurs: Loustal
Genre: Chronique sociale, Drame, Humour
Éditeur: Casterman
Nbre de pages: 72
Prix: 19€
.jpg)
Peyo, Franquin, Tillieux, Roba, Walthéry, Jidéhem, Seron, Derib, Mittéï,… Quel grand auteur encore en activité a travaillé avec autant de grands noms de la bande dessinée ? Gos. Pour BD-Best, Laurent Lafourcade a eu la chance d’interviewer son auteur préféré, le créateur du Scrameustache. Après la première partie consacrée au voyageur de l’espace, voici le second volet survolant la carrière de l’auteur.
Vous avez démarré une carrière de militaire. Comment passe-t-on de l’uniforme à la bande dessinée ?
Ah, ça, c’est assez rigolo. J’ai travaillé au ministère de la défense nationale comme secrétaire particulier de l’amiral en chef. Il y avait un livre d’or avec une couverture en cuir dans lequel on faisait à chaque fois un beau dessin pour accueillir l’arrivée d’une personnalité étrangère. Le type que je suis venu remplacer était un peintre qui faisait des tableaux merveilleux. Un jour, mon chef de service adjudant-chef m’a dit que je dessinais bien et que je devrais faire un dessin dans le livre d’or car un amiral devait venir. Répondant que mes dessins étaient plus proche de la BD, on m’a répondu que si je savais faire ça, je savais faire autre chose. J’ai été mis au pied du mur. C’est comme cela que j’ai commencé à faire des dessins régulièrement dans le livre d’or. Un jour dans une revue militaire inter force, je vois de la BD. J’ai appelé le dessinateur Jean-Luc Engels et je suis passé le voir avec des croquis que j’avais fait pour m’amuser. Il m’a expliqué comme faire de la BD, quelles plumes employer, quel papier. Le rédacteur en chef de la revue, un major, est arrivé et, voyant que j’étais dessinateur, m’a demandé de dessiner une dizaine de planches racontant la vie d’un matelot, de son incorporation jusqu’à sa démobilisation. A l’époque, on faisait des services militaires de 24 et 18 mois. J’avais le choix pour faire balader mon personnage. L’ennui est qu’ils ont changé tous mes dialogues dans mes planches pour que ça devienne de la propagande. Mais j’avais mis le pied à l’étrier et voulais me lancer dans la BD. Les démissions de l’armée étaient refusées à l’époque. Soutenu par ma femme qui a mis de l’argent de côté, j’ai fini par pouvoir démissionner un an après.
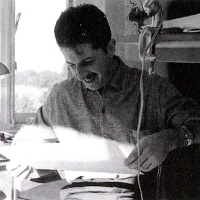
© Gos
Vous avez commencé comme assistant de Peyo sur du lettrage. Comment l’avez-vous rencontré ?
Quelques temps avant de pouvoir démissionner de l’armée, j’avais rencontré Peyo et lui avais montré ce que je faisais. Trouvant qu’il y avait encore du boulot, il m’a dit qu’il me faudrait encore au moins deux ans de travail pour être prêt. J’étais un peu sonné.
Un an après ma démission, Peyo m’a rappelé. Derib repartait en Suisse. Il m’a demandé que si la place m’intéressait, elle était pour moi. Entretemps, il m’avait engagé pour faire du lettrage pour Johan et Pirlouit, les Schtroumpfs et Benoit Brisefer, ce qui fait que je suis un des rares à connaître les « bas de casse » (lettrage en caractères d’imprimerie minuscules) que les autres ne maîtrisent pas. C’est pour cela que Dupuis m’a demandé de faire du « bas de casse » sur le Scrameustache, que j’avais commencé en textes majuscules, car s’adressant à des petits, ils retrouvaient une écriture proche de l’écriture cursive qu’on leur apprenait alors à l’école.
.jpg)
© Gos, Peyo - Dupuis
Puis vous participez au scenario et aux dessins du Cracoussas.
Vraiment tout seul, oui. Les autres nous les faisions ensemble. J’écrivais un scénario, le lui soumettais et on le continuait tous les deux s’il le trouvait bon. On commençait le samedi suivant. Je me rendais chez lui et on démarrait sur le synopsis que j’avais fait en le changeant au fur et à mesure que l’on avançait pour le modifier et le perfectionner. Peyo était très fort pour ça. On faisait le scénario comme une partie de ping-pong. L’idée partait de l’un, revenait chez l’autre, puis retournait au premier jusqu’à ce qu’elle soit bonne. Il faisait des petits croquis et moi j’écrivais les textes. Quand c’était fini, ma femme retapait les textes à la machine. On donnait à François Walthéry, par exemple, mon texte imprimé et les petits dessins de Peyo. Peyo relisait tout, rajoutait une virgule par ci, remplaçait parfois un mot par un synonyme par là.
C’est la méthode qui a été employée sur les scenarios de Tonton Placide et du Cirque Bodoni pour Benoît Brisefer.
Oui, c’est ça. D’ailleurs le mot « Bodoni » vient d’un type de caractère d’imprimerie. Ce nom m’est revenu en tête. C’est pour ça qu’on l’a appelé comme ça.
.jpg)
© Gos, Walthéry, Peyo - Dupuis
Rapidement, vous co-écrivez des scénarios de Jacky et Célestin. Cette série était une véritable pépinière de talents : Walthéry, Derib, Mittéï, et bien sûr Peyo lui-même. Comment tout ce petit monde travaillait-il ensemble ?
Derib et moi, on travaillait sur le scénario. On le soumettait à Peyo qui faisait deux trois corrections et il le passait à Walthéry qui devait le dessiner. C’est comme ça que ça marchait. Seulement, Derib avait des idées bien précises et préconçues. Il avait du mal à s’adapter à quelque chose qui existait déjà. Ça n’allait pas parce qu’on passait plus de temps à discuter qu’à travailler. Après le départ de Derib du studio, je devais m’en occuper, mais on a laissé tomber la série, qui était publiée dans Le Soir Illustré, pour s’occuper de Benoit Brisefer, pour Dupuis. Pour Jacky et Célestin, on était moins bien payés et, en plus, on ne faisait pas d’albums. Ils sont parus bien plus tard dans la collection « Péchés de jeunesse ».
.jpg)
© Gos, Walthéry, Peyo - Dupuis
Vous avez aussi participé au scénario de Panade à Champignac, le dernier Spirou de Franquin.
Oh, oui, ça s’était marrant. Un jour, la femme de Franquin téléphone à Peyo et dit : “Je suis embêtée parce qu’André va refaire une dépression si ça continue. Dupuis veut qu’il continue Spirou et lui ne veut plus. Ça ne l’amuse plus. Il n’y a que Gaston qui compte pour lui. Il a commencé une histoire mais il n’en sort pas. Vous ne voulez pas l’aider ?”. Peyo m’en parle. On a trouvé comme prétexte pour amener Franquin chez Peyo que j’avais un problème avec le Cracoucass. Il m’a dit : “Ton oiseau est bien, mais il n’est pas méchant. ”. Il m’a fait un petit croquis vite fait pour l’améliorer. Puis, on a parlé de lui. Peyo l’a habilement amené à parler de son avenir. Franquin a avoué en avoir marre de Spirou. Peyo lui a alors proposé qu’on lui donne un coup de main pour l’aider à finir son scénario. Il avait déjà dessiné onze planches. Il nous a expliqué ce qui venait après, mais il y avait de quoi faire cent-vingt pages en plus. Ça n’allait pas. On a suggéré de repartir sur ce qu’il avait fait et de le conclure en quarante planches. Il a trouvé l’idée merveilleuse et nous a donné carte blanche. J’ai réécris la suite. Ça ne valait évidemment pas ce que Franquin faisait, mais il a bien aimé. Quand je lui montrais le scénario, il rajoutait sa mayonnaise personnelle et ça devenait vraiment du Franquin.
Un jour, il m’a étonné. Il avait dessiné la planche où un landau passe devant le train. Il avait fait ce dessin vu au ras du sol, mais ce n’était pas impressionnant. Devant moi, il a déchiré sa demie-planche et l’a refaite. J’étais soufflé qu’un type qui avait quarante-six ans de métier fasse ça. Chapeau. Il est revenu deux jours après avec le même dessin vu d’en haut. C’était évidemment beaucoup plus net et précis. Ça m’a tellement marqué… Un jour, sur une planche du troisième album du Scrameustache, ma femme m’a fait remarquer qu’il y avait un problème avec la boule qui reçoit toutes les infos de la Terre. J’avais dessiné un mur de télévisions, mais ma femme m’a dit que ce n’était pas dans l’esprit du Scrameustache, mais plutôt du Gil Jourdan. Pour éviter toute discussion stérile, je lui ai dit que j’allais voir ça. J’ai fait comme Franquin. J’ai déchiré ma planche. Je l’ai refaite et je ne le regrette pas. Le jour où j’ai vu Franquin détruire sa planche, j’ai eu une belle leçon et je devais en profiter. Chapeau, Franquin ! Il était extraordinaire.
La meilleure chose qu’on a pu faire à l’époque est qu’on se réunissait tous les mois, Franquin, Peyo, Walthéry, Roba, Jidéhem et moi, une fois chez l’un, une fois chez l’autre. On cherchait des idées pour tout le monde. C’est pour ça que l’on voit mon nom apparaître sur certains gags de Roba. C’était très enrichissant. Mais je crois qu’on aurait plutôt dû faire du scénario pour Playboy que pour Spirou. C’était gratiné. Qu’est-ce qu’on s’est marrés ! Nine Culliford, la femme de Peyo, venait de temps en temps et nous disait : « C’est comme ça que vous travaillez ! ».
.jpg)
© Franquin, Gos, Jidéhem, Peyo - Dupuis
Vous avez à une époque fait des essais pour une reprise de Spirou. C’était juste après Franquin ?
Oui. Mais seulement Dupuis a dit que si je reprenais Spirou, je ne ferai plus de Schtroumpfs. C’est comme ça que je ne l’ai pas eu. Et c’est une très bonne chose. Franquin m’avait dit : « C’est bien mais c’est une corvée parce que tu vas devoir te baser sur tout ce que j’ai fait avant. Tandis que si tu créé des trucs à toi, tu feras ce que tu voudras. ». J’ai compris plus tard qu’il avait bien raison.
On n’aurait jamais eu le Scrameustache si ça avait marché.
Exactement. Franquin était de bon conseil pour tout ça. Peyo, lui, avait toujours peur qu’on s’en aille. Et c’est finalement ce que j’ai fait. Je ne pense pas qu’il m’en ait voulu quand je suis parti, mais il ne me l’a pas dit.
.jpg)
© Gos - Dupuis
Puis démarre l’aventure Natacha avec Walthéry. Vous la co-créez en quelque sorte.
Oui, ça, c’était la grande aventure. A part Sophie dans Spirou et Secottine, il n’y avait pas de femmes, pas de filles. Je cherchais des idées, parce que souvent Peyo partait en vacances et, deux jours avant, il nous disait : « Samedi, je suis parti, je pars en vacances ! ». Peyo ne voulait pas qu’on travaille sur ses planches pendant son absence, alors il fallait que l’on trouve quelque chose. Je cherchais vite des petits scénarios de quatre cinq planches et je courais les proposer à Yvan Delporte, rédacteur en chef de Spirou. C’est comme ça que l’on faisait des petites histoires comme Roland Labricole avec François Walthéry. Un jour, François en a eu marre. Il a proposé que l’on fasse une longue histoire dont il pourrait faire quatre ou cinq planches à chaque fois que Peyo partirait. J’ai cherché, je voulais faire un récit qui pourrait se passer n’importe où. Yvan Delporte a alors émis l’idée de faire une histoire d'hôtesse de l’air. Il avait vu des croquis de François qui dessinait les filles divinement bien, et c’est comme ça que c’est parti. Delporte nous a encouragé : « Allez les gars, faites la bien qu’on ait envie de la coucher sur un divan. ». Au fur et à mesure de l’histoire avançait, sa jupe rétrécissait de plus en plus. Dupuis nous a dit : « J’espère qu’on va arriver à un moment où elle a une culotte. ». Walthéry lui répondait : « Vous aurez la surprise la semaine prochaine. ». Ça a été un succès dès le départ.
J’ai compris un peu tard, et je m’en excuse auprès de lui, que Walthéry est un gars à qui il ne faut pas remettre un scénario et s’attendre à ce qu’il soit respecté à la lettre. Il va toujours changer quelque chose pour amener de l’action. Je ne l’avais pas compris au départ et c’est bien dommage. Si je devais refaire un scénario pour lui maintenant, je lui laisserai la main libre sur les scènes d’action, sans lui imposer quoi que ce soit. Mais je lui suis reconnaissant. Ces deux premiers Natacha, c’était un sacré boulot.
.jpg)
© Gos, Walthéry - Dupuis
Walthéry avait dû rajouter sur la couverture du premier album une main de Natacha pour cacher sa poitrine.
Oui, c’est vrai. On voyait un bout de téton qui faisait une petite bosse en dessous de son chemisier. Les pudiques de chez Dupuis lui ont demandé de mettre une main devant. Ce n’est pas croyable. Il faut dire que la maison Dupuis au départ était fortement sous influence du curé de la paroisse.
Vous avez eu la chance de bénéficier d'une époque où la presse était reine avant les albums, de travailler dans un journal et se faire la main.
C'était bien parce que l’on était payé au prix de la planche qui passait dans Spirou, plus les droits d’auteur sur les albums vendus. C’était vraiment rentable.
.jpg)
© Gos - Dupuis
A partir de 1970, vous êtes adoubé par Maurice Tillieux pour lui succéder au dessin de Gil Jourdan. Comment s’est déroulé ce passage de témoin ?
Chez Dupuis, il y avait une réunion annuelle. Un jour, Tillieux était à côté de moi et je lui ai dit : “Dis donc Maurice, quand est-ce que tu vas refaire du Gil Jourdan ? ça commence à manquer”. Il m’a répondu : “Quand je trouverai un couillon comme toi pour me le dessiner.”. Et j’ai dit bêtement : “Chiche”. J’ai fait des croquis que je lui ai montré. Il les a trouvés bons, et c’est parti comme ça.
.jpg)
© Gos, Tillieux - Dupuis
Aviez-vous une pression particulière à prendre sa suite ?
J’étais tenu de faire du Gil Jourdan et les voiture, ça, c’était mon problème. Il m’a montré deux ou trois trucs un jour, et là j’ai appris à dessiner les voitures : incliner la voiture dans un virage, soulever les roues du sol pour montrer qu’elle va vite,… Tillieux était malin. Il me donnait un scénario et disait : “Tu vois, dans cette image, Gil tire sur le volant, la voiture va faire des tonneaux et il va s’éjecter. Quand il aura retrouvé les deux pieds sur terre, je reprendrai pour faire la suite.”. Il me laissait toute liberté pour faire la scène d’action. Je prenais le nombre d’images qui me semblait nécessaire ; ça c’était très chouette.
Après sa disparition tragique en 1978, vous avez clôturé l’épisode en cours. Avez-vous envisagé après de poursuivre seul la série ?
Non parce que déjà, avant, j’avais dit à Maurice que je n’arrivais plus à mener de front Gil Jourdan et le Scrameustache. Je lui avais demandé de trouver un repreneur parce que je ne m’en sortais plus. Ayant liquidé pas mal de dessinateurs pour qui il fournissait des scénarios, il avait l’intention de redessiner Gil Jourdan. Malheureusement, il a eu son accident de voiture et il est mort. Vis-à-vis de l’éditeur, j’étais obligé de terminer l’album en cours. En revanche, il ne m’avait pas raconté son scénario et je ne savais pas la fin. Il m’avait juste dit un jour que le trafic sur la Manche était organisé de telle façon que son histoire ne tenait pas debout. Après son accident, j’ai trouvé l’astuce de faire échouer l’aventure avant qu'elle ne démarre. On a rajouté dans l’album des petites histoires complètes.
.jpg)
© Gos, Tillieux - Dupuis
En 2015, paraît Histoires courtes, reprenant les 3 histoires de Boubou le puma, Adhémar le petit lapin et Roland Labricole. Reste-t-il d’autres trésors à exhumer ?
Non, il n’y a que ça. Ce sont les petites histoires que l’on faisait pour meubler pendant les vacances de Peyo.
.jpg)
© Gos - Hématine
Du 27 août au 14 septembre, la galerie Daniel Maghen à Paris a fait une exposition de vos planches et dessins originaux, ainsi que de Walt, Mazel et quelques Tillieux. Un bel hommage.
Oui ! Daniel Maghen est notre galeriste depuis une quinzaine d’années. Comme ça fonctionne bien, il continue. Il a récemment déménagé et occupe une plus grande galerie. J’ai essayé de convaincre François Walthéry d’exposer simultanément avec nous. A l’approche de l’anniversaire des 50 ans de Natacha, cela aurait été chouette. Mais il n’a pas donné suite. Je pense qu’il ne souhaite pas vraiment céder ses originaux encrés pour le moment.
Merci, Monsieur Gos.
.jpg)
© Gos - Glénat
Entretien réalisé par Laurent Lafourcade
.jpg)
Peyo, Franquin, Tillieux, Roba, Walthéry, Jidéhem, Seron, Derib, Mittéï,… Quel grand auteur encore en activité a travaillé avec autant de grands noms de la bande dessinée ? Gos. Pour BD-Best, Laurent Lafourcade a eu la chance d’interviewer son auteur préféré, le créateur du Scrameustache. Avant le second volet survolant sa carrière, voici la première partie consacrée au Scrameustache.
Au fil de la lecture des épisodes du Scrameustache, on se rend compte que la série est savamment construite. Que ce soit les origines de Khéna aussi bien que celles du Scrameustache, aviez-vous tout prévu dès le départ ?
Pour Khéna, oui, dès le premier épisode, mais pas plus. Pour expliquer comment est né le Scrameustache, c’est venu au fur et à mesure des histoires. L’histoire de Scrameustache vient du rédacteur en chef de Spirou à l’époque qui m’a dit un jour : “Mais le Scrameustache, ça veut dire quoi, d'où vient-il”. Ça a fait tilt et le lendemain j’avais tout mon scénario du tome 18. Pour tous les épisodes précédents ou suivants, la plupart du temps, ça vient d’une réflexion, la vue d’une image quelque part. Je me dis que je pourrai peut-être faire ci ou ça. Mais alors je suis parti d’un grand principe que m’avait donné Franquin : “Si tu ne veux pas t’embêter dans tes histoires, à part tes deux héros principaux, amène régulièrement des gens, des inconnus, qui peuvent apporter un plus”. C’est comme ça que sont arrivés les Galaxiens dans la série. Ils étaient d’ailleurs les premiers croquis du Scrameustache. Comme ça n’allait pas, ils étaient trop nus. Comme j’aime beaucoup les chats, j’ai fait un Scrameustache qui ressemble à un peu à un chat.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Georges Caillaut, appelé Oncle Georges, est archéologue et ethnologue. Après avoir bourlingué autour du monde, il rédige ses mémoires et s’occupe de mon neveu d’une quinzaine d’années : Khéna. Est-ce que Georges, c’est un peu vous, et Khéna votre fils Walt ?
Non pas du tout. Quand j’ai fait ça, Walt était tout gamin. Il avait huit ans. Il est né en 66, le Scrameustache date de 72.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
On apprend dans le troisième épisode, le Continent des deux Lunes que Khéna vient d’une autre planète. Il faudra attendre le neuvième volume (Le dilemme de Khéna) pour en savoir plus sur ses parents, puis le seizième (Le grand retour) pour qu’il les ramène du passé. Distiller ces informations au fil des ans, est-ce un moyen de garder un fil rouge ?
Oui, peut être que j’ai fait ça inconsciemment. Quand je fais l’histoire, je me laisse toujours une porte ouverte où je peux retourner pour la suite. Là, je ne sais pas comment ça s’est fait. L’envie de donner une vraie famille à Khéna, de lui permettre de voyager, je trouve que c’est très chouette. Je n’ai jamais pu expliquer d'où venaient mes idées et en y réfléchissant dernièrement j’ai trouvé une explication. Quand j’étais gamin, c’était la guerre. Mes parents habitaient un trou perdu dans les Ardennes, un hameau du village à 2 km et demi du centre. C’était quand même assez loin, les copains ne venaient pas jouer avec moi et je ne pouvais pas aller jouer avec eux. Comme j’étais seul je m’imaginais des histoires et je pense que c’est là que ma capacité à écrire des histoires s’est développée. Après, j’ai eu un petit vélo et j’ai pu me déplacer.
A l’école, quand il fallait faire une rédaction sur un sujet précis, le prof me disait toujours : « Le fond est très bon, Goossens, mais le style est nul. »
.jpg)
© Gos - Glénat
Quelle est l’origine du mot Scrameustache ?
C’est un mot inventé au service militaire. J’étais engagé. Il y avait deux matelots rigolos dans mon service qui s’amusaient à inventer des mots qui n’existaient pas en collant des syllabes les unes aux autres. J’avais trouvé le mot « Scra » : Sujet Créé par Radiations Artificielles. J’avais le début, il me manquait la fin, puis je l’ai trouvée : « -meustache » : …et Manipulations Extra-Utérines Sans Toucher Aux Chromosomes Héréditaires Endogènes.
Pourquoi la série Khéna et le Scrameustache, a-t-elle été rebaptisée Le Scrameustache au tome 7 ?
C’est à cause du rédacteur en chef de l’époque Thierry Martens. Il s’amusait à faire des commentaires sur les lettres des lecteurs. Pour gagner du temps, comme il est plus facile de taper à la machine “Khéna” que “Scrameustache”, c’était toujours Khéna par ci, Khéna par là. Cela m'énervait souverainement et j’ai proposé au directeur éditorial de rebaptiser la série Le Scrameustache, car c'était lui le héros, et non pas Khéna. Il a accepté et c’est comme cela que la série a changé de nom.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Dans La fugue du Scrameustache, expatrié, le Scrameustache se pose des questions existentielles sur sa place dans la société. Il va mettre la panique dans le village. Ses tourments l’amènent à faire tout un tas de potacheries. On se rend compte que le personnage à une vraie âme. Pensiez-vous tenir là l’album de la maturité ?
Je n’ai jamais travaillé en me disant ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais plutôt dans le sens où si je me suis bien amusé, ça peut amuser les autres. Et effectivement, la série a décollée au troisième épisode de la série. A l’époque, on faisait des référendums dans Spirou. Le Scrameustache s’est trouvé classé deuxième, juste derrière Gaston. Ça m’a évidemment fait plaisir mais pas apporté d’augmentation pour autant. Ha ha !
L’épisode La fugue du Scrameustache voit également la première apparition des Galaxiens (mise à part la dernière case du tome 3).
Les Galaxiens sont apparus dans l’un de mes tout premiers croquis. Je l’ai mis dans un tiroir et je l’ai oublié. A moment donné, j’ai voulu apporter une explication hors contexte de l’histoire. J’ai pris ce petit personnage-là qui a eu tellement de succès auprès des gamins que je l’ai ensuite repris. C’est comme cela que sont nés les Galaxiens.
Comme j’étais à l’armée dans la marine, j’avais un insigne sur mon bras gauche qui désignait ma spécialité. J’étais secrétaire et je ne sais d’ailleurs pas pourquoi j’avais une feuille d’érable comme insigne. Voulant reprendre un tel codage pour désigner les spécificités de mes personnages, si je mettais un insigne sur le bras, on n’allait rien voir. Alors, je le leur ai placardé sur le ventre.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Les Galaxiens, aussi organisés que drôles, accompagnent une bonne partie des aventures. On pense aux Schtroumpfs, mais leur communauté a un côté beaucoup plus scientifique, politique et tayloriste dans leur façon de vivre. Etait-ce un moyen pour vous de vous démarquer ?
Oui. Les Schtroumpfs viennent des sept nains. On peut comparer les Galaxiens avec les Schtroumpfs, mais chaque fois qu’un type va faire une histoire avec des petits personnages, il va tomber dans cette comparaison avec l’un ou l’autre. Moi, ça m’est bien égal. J’ai travaillé cinq ans sur les Schtroumpfs. J’en ai appris beaucoup de choses. Peyo était charmant mais très difficile.
Dans Le prince des Galaxiens, une Galaxienne naît par magie. On y voit un hommage à une certaines Schtroumpfette, elle aussi naquit artificiellement.
Oh, non pas du tout. Je n’y ai même pas pensé. D’ailleurs, je lis très peu de BD, sauf ce qui paraît dans Spirou, pour éviter les influences.
En 1983, votre fils Walt vous rejoint et vous formez un véritable duo indissociable tant sur les scénarios que sur les dessins.
La plupart du temps, les scénarios viennent de moi. On discute tous les deux. Il apporte des idées et/ou me fait remarquer quand quelque chose ne va pas et me propose des modifications. Il peaufine aussi, souvent, les dialogues. Walt a aussi écrit quelques scénarios seul comme Le président Galaxien, Tempête chez les Figueuleuses, Casse-tête olmèque et des gags des Galaxiens. Accaparé par ses autres activités, on a moins collaboré ces derniers temps, mais il revient. Il va faire de bonnes choses. Vu mon âge, je ne vais plus en faire beaucoup.
.jpg)
© Walt
Des albums mettant en scène uniquement les Galaxiens dans des gags ou des histoires courtes s’insèrent dans la collection. Il était question à une époque que votre fils Walt s’en occupe, parallèlement aux histoires du Scrameustache que vous auriez pris en charge ?
Oui, il a déjà commencé mais pour des raisons qui lui appartiennent il a suspendu ce projet. Il m’a dit qu’il allait le reprendre, qu’il était temps qu’il finisse cet album. Au départ, je pensais que si les Galaxiens avaient une collection parallèle, je ne pourrais plus les utiliser. Or, ce n’est pas un problème. Quand Peyo a lancé la série Les Schtroumpfs, il a continué à les faire participer aux aventures de Johan et Pirlouit.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Une autre personne est intervenue sur les albums de gags, c’est François Gilson.
C’est un confère dont la collaboration nous avait été suggérée par Patrick Pinchart lorsqu’il était rédacteur en chef du magazine Spirou.
Vous avez eu une carrière parallèle à celle de Pierre Seron. Enfant, j’attendais impatiemment dans Spirou les nouvelles aventures du Scrameustache et celles des Petits Hommes. Puis un jour, un cross over a mélangé les deux séries. Comment est née cette double collaboration dans lesquelles les séries se sont invitées l’une chez l’autre ?
C’était l’idée de Pierre Seron. On revenait d'Angoulême un jour et il y avait sept à huit heures de train. Tout en parlant, on s’est dit qu’on avait un style de dessin très proche. On pourrait se faire rencontrer nos personnages, même dans l’espace si c’est nécessaire. J’ai pensé que c’était une bonne idée. En discutant le long du trajet, on en est arrivé à la conclusion que ce serait encore plus rigolo, de faire deux histoires qui s'interfèrent l’une dans l’autre. Comme j’avais déjà sept pages de dessinées dans ma nouvelle histoire, il m’a dit: ”Ce n’est rien. Tu m’envoies des copies et moi j’adapterai mon histoire à la tienne”. Au fur et à mesure que j’avançais je lui envoyé mes planches et lui créait son scénario d'après ça, bien que ce soit très différent de ce que je faisais. Dans certains passages, je lui disais : “Attention nos personnages vont travailler pendant deux ou trois planches ensemble.”. Au fur et à mesure, il dessinait ses petits personnages, me les envoyait et Walt les redessinait sur nos planches. C'était très complexe car à l’époque il n’y avait pas de mail et toute l'électronique. Alors on faisait des photocopies que l’on envoyait par la poste. Ça nous a coûté une petite fortune en timbres mais ça a fonctionné. Pierre Seron était un virtuose. Il savait s’adapter à tout.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
La prépublication d’une telle « double histoire » dans Spirou a dû être complexe.
Justement, je me suis fâché avec la rédaction à l’époque. Je les avais prévenus que les deux histoires devaient paraître en même temps pour que les lecteurs puissent passer d’une image à l’autre, pour voir ce que disait l’une par rapport à l’autre. Ils m’ont dit que oui, mais ne l’ont pas fait. Un assistant de rédaction s’était trompé mais ne voulait pas l’admettre.
Très souvent, les militaires et les gendarmes passent pour de sombres crétins dépassés par les événements (T.7 : Les galaxiens, T.27 : Les naufragés du Chastang,…) Aviez-vous des comptes à régler avec votre premier métier ?
Non pas du tout. Il fallait bien que quelqu’un représente un peu l’autorité. Ce n’est pas bien méchant. Ils passent un peu pour des innocents, mais pas pour des salopards. Ça reste affectueux.
Avec le diptyque La caverne tibétaine et Le cristal des Atlantes sur le mythe de l’Atlantide, vous signez un scénario exigeant. Vous montrez que ce n’est pas parce qu’on s’adresse en priorité à des enfants qu’il ne faut pas les faire réfléchir. Est-ce un objectif que vous gardez en tête quand vous écrivez ?
Oui, je ne veux pas devenir bêtifiant. J’essaye toujours que les gosses posent une question à leurs parents et leur demandent des explications s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais les enfants d’aujourd’hui sont beaucoup plus délurés qu’avant, avec tout l’électronique qui les entoure.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Les naufragés du Chastang (T.27), aventure scientifique, est une bonne synthèse de l’univers du Scrameustache : un problème dans l’espace, des aliens en péril que Khéna et le Scrameustache doivent aider et qui débarquent sur terre, et des militaires hébétés. L’action se déroule autour du barrage éponyme, centre hydro-électrique corrézien existant.
J’ai des amis de longue date qui sont partis habiter à Argentat en Corrèze, non loin du barrage. Un séjour pendant huit jours dans un petit hôtel à côté de chez eux a donné naissance au scénario. En voyant le barrage, j’ai eu des idées et les ai écrites en rentrant.
Il y a de nouveau un décor réel dans Les petits gris (T.28), dont l’action se déroule à Pommerol en Drôme provençale, basé sur un schéma narratif semblable, les militaires en moins.
Pour Les petits gris, le scénario était quasiment écrit et je cherchais un endroit pour le développer. Un reportage vu à la télévision sur un médecin à la retraite qui avait retapé tout un vieux village m’a donné l’idée. On a loué une maison sur place, puis j’ai imaginé toute l’action en référence aux croquis et aux photos que j’avais faits. Je me suis bien amusé à faire cet album.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Est-ce que le fait de partir de lieux et de choses réelles apporte un plus ?
Quand on a un décor à sa disposition, ça apporte de la facilité pour évoluer.
Aventure, science et fantastique, ce sont pour vous les trois angles d’une histoire réussie ?
Oui. Pour le Scrameustache, c’est exactement ça.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Vous êtes un des derniers dinosaures de l’âge d’or. Pensez-vous que c’est parce que votre série n’est pas figée dans une époque révolue et a évolué avec la société ?
C’est fort possible. Quand j’ai commencé cette histoire, je suis allé voir Charles Dupuis et je lui ai dit que j’avais une nouvelle série à proposer. Il m’a dit : « Tâchez d’être original, parce que l’on a déjà un peu tout fait. ». Alors, j’ai dessiné trois pages et les dix suivantes au crayon. J’avais mon scénario écrit que je lui ai montré, et lui ai expliqué qu’avec mes personnages, je pouvais faire vivre des aventures dans le présent, dans le passé, dans le futur, ici sur terre ou sur une autre planète, rien n’était impossible. Il m’a répondu : « Je n’y aurais jamais pensé. Ça va faire un bel album ! ».
.jpg)
© Gos, Walt - Dupuis
Le dernier album paru à ce jour montre que le Scrameustache est une série résolument d’actualité. Cette « porte des deux mondes » est un symbole de passages de migrants. Sans qu’ils ne s’en rendent forcément compte, vous inculquez à vos lecteurs des valeurs de tolérance et de respect, voire d’œcuménisme.
C’est involontaire de ma part. Je n’ai pas fait le rapprochement. Si je l’ai fait, c’est inconsciemment.
Je suis simplement parti sur le fait que beaucoup de soleil faisait monter le taux de mélanine. La peau des Galaxiens noirs s’est adaptée au soleil. La température étant montée sur la planète de ces personnages, certains sont partis, d’autres se sont adaptés.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
En 2005, coup de théâtre, vous quittez Dupuis pour Glénat. Mais que s’est-il passé ?
C’est une longue histoire. Mon fils connaissait un journaliste chinois qui venait régulièrement en Europe. Il voulait éditer tous les Scrameustache en chinois. A eux deux ils ont monté tout un business plan pour ce marché. Différentes éditions étaient envisagées : en couleur pour les plus riches, en noir et blanc et d’autres encore avec une couverture souple bon marché. Ils avaient fait une étude de tout le marché chinois, ce qui représentait un boulot énorme. On a proposé ça chez Dupuis. Ils ont tergiversé de manière frileuse en humiliant notre correspondant chinois avec des discussions de tapis sans fin, ce qui est ne rien connaître de la mentalité d’affaire locale.
Nous nous sommes fâchés. Mon fils Walt, qui -à l'époque- n’avait pas sa langue dans sa poche, leur a fait entendre quelques bonnes vérités. Le directeur de collection a dit qu’il ne voulait plus le voir, mais qu’il me gardait moi parce que j’étais sympa. Je lui ai répondu que je refusais car nous étions deux qui ne formions qu’un. On reste ou on part. Nous sommes partis le lendemain et avons prospecté. On ne voulait pas aller au Lombard parce qu’on trouvait qu’il y avait trop d’histoires réalistes. Walt a entamé des démarches avec Glénat qui nous a dit tout suite “Bienvenue chez nous”.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Au final, on trouve le Scrameustache en Chine ?
Non, pas du tout. Notre interlocuteur a poursuivi son métier de journaliste mais s’est tourné vers d’autres types d’investissements professionnels d’après ce que je sais.
Le Scrameustache devait être le fer de lance du label Paris-Bruxelles, hébergé par Glénat. Il en est aujourd’hui le seul survivant.
Je ne connais pas toutes les différentes raisons de l’étiolement de cette collection. J'apprécie Jacques Glénat. Il est très sympa et maintenant sa fille Manon va reprendre la direction d’édition. Son autre fille va reprendre la logistique d’après ce que je sais.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
On ne peut pas dire que Glénat fasse le moindre effort pour mettre la série en évidence. Ne regrettez-vous pas aujourd’hui de ne pas avoir une belle série en intégrale dans la collection Dupuis patrimoine ?
On parle de moi dans les albums de la collection Dupuis patrimoine, c’est déjà une chose. Mais une édition en intégrale ne m’enchante pas. Il y a minimum trois albums dans un volume. Parfois, vous touchez à peu près en droits d’auteur l’équivalent de ce que vous touchez pour un album classique. C’est l’éditeur qui empoche la différence.
Les lecteurs prennent l’habitude d’acheter des intégrales et n’achètent plus les albums individuels. Si je donne mon accord pour une édition en intégrale, on ne vendra plus les autres. Je travaille pour les enfants. Lire une intégrale pour eux, c’est comme soulever un sac de dix kilos de patates.
Roger Leloup a embarqué Yoko Tsuno dans une grande histoire composée en fait de deux parties indépendantes d’une trentaine de planches car il avait peur de ne pas arriver au bout. Raoul Cauvin vient d’annoncer qu’il arrêtait le scénario des Tuniques bleues. Vit-on la fin d’une époque ?
Malheureusement, je crois que oui. Par exemple, dans le journal Spirou, il y a un tas de gars qui travaillent mais je n’en connais que trois qui font vraiment du bon travail. Tous les autres font du boulot de fanzines. Mais quand on sait combien on les paye, ce n’est pas étonnant. Nous, en faisant avec soin, une planche à une planche et demie par semaine, on arrivait au bout du mois en pouvant vivre avec notre travail. De nos jours, pour vivre, les jeunes doivent faire au moins trois planches. Ils ne peuvent pas y consacrer beaucoup de temps, ce qui s’en ressent dans la qualité du travail.
Le Scrameustache est l’une des créations les plus originales en bande dessinée. Il a encore un potentiel certain qui ne demande qu’à être lu par les nouvelles générations. Y a-t-il encore des enfants qui découvrent la série avec les nouveautés ?
Je ne saurais pas dire. La plupart de mes jeunes lecteurs sont des gens qui ont maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d’années, et qui ont passé la collection à leurs enfants. Alors, une fois qu’ils ont commencé, ils accrochent et ils continuent. C’est plutôt par les parents que ça se fait.
.jpg)
© Gos, Walt - Glénat
Qu’en est-il du projet de dessins animés du Scrameustache que l’on nous promet depuis 2016 ?
Il était bien avancé. Le producteur qui avait monté ce projet a eu un enfant gravement malade. Il a alors mis toute son énergie pour s’occuper de cet enfant et il a eu raison. De ce fait, il a fait faillite. C’est très dommage car le projet était prometteur.
Je n’ai jamais eu de pot dans ce domaine. Quand j’étais chez Dupuis, le directeur commercial me disait qu’ils travaillaient sur les dessins animés des Schtroumpfs et que pour mes personnages il faudrait attendre. Après, il y avait autre chose. Un gars m’avait dit : « Vous les suivants des grands seigneurs de la BD, vous êtes des sacrifiés. ». Il y avait Franquin, Peyo, Roba, Tillieux dont on s’occupait. On arrivait juste derrière et on nous disait de patienter. Puis, une troisième génération est arrivée avec des gars plus jeunes et on s’est tout de suite occupés d’eux. Le rédacteur en chef de Spirou se trouvait plus en relation avec les troisièmes qu’avec les deuxièmes. On avait des antécédents avec la maison, tandis que les nouveaux venus étaient bien obligés de marcher comme on leur disait.
Une adaptation en live comme l’a fait Alain Chabat avec le Marsupilami vous séduirait-elle ?
Ah, oui, peut-être...
Lire un nouveau Scrameustache, c’est comme lire un nouveau Natacha, un nouveau tuniques bleues,… C’est une délicieuse madeleine qui revient en bouche. Avez-vous conscience, lors de séances de dédicaces par exemple, de l’effet que vous faites sur les lecteurs maintenant quadras ?
Oui. Je ne fais plus beaucoup de séances de dédicaces avec la santé de ma femme, mais je vais tout de même tous les ans au salon de la BD à Bruxelles. Il y a des gens qui viennent de partout, d’Allemagne, de France, du Luxembourg, qui ont 45, 50, 60 ans, qui continuent d’acheter la série et qui en sont toujours friands. Ils ont l’impression de commettre une faute s’ils n’achètent pas la suite de ce qu’ils ont. Et c’est tant mieux pour moi, d’ailleurs. Ha ha ! Mais il faut être honnête, la vente de BD a fortement diminué.
.jpg)
© Gos - Glénat
Que nous réserve le prochain album ?
Là, ça va être une surprise. Khéna et Scrameustache, qui sont avec une petite gamine, commettent une imprudence. Ils sont embarqués dans un ovni qui appartient à des êtres venus sur terre pour chercher des plantes médicinales parce que leur médecine ne convient pas à tout le monde. Ils repartent avec eux. Ils demandent à faire demi-tour, mais trop tard. Ils sont entrés dans un vortex et partis jusqu'à la destination finale. Mais ils leur promettent de les ramener le lendemain une demi-heure après leur départ. En attendant, Khéna et sa compagne de voyage vont découvrir là- bas un monde qu’ils ne connaissent pas … Mais je ne vais pas tout spoiler !
Ça va être surprenant, d’autant plus que, je ne l’ai jamais fait, mais je vais tuer un personnage annexe pour mettre un peu plus d’action dans l’histoire.
(à suivre...)
Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

2019 commence en fanfare pour le petit monde impérissable et toujours aussi attrayants de François Walthéry. Un gros pavé, le premier d’une collection déjà incontournable, Une vie en dessins, vient de sortir faisant la part belle à ce grand bonhomme du Neuvième Art et de la vie liégeoise. L’occasion de revisiter son oeuvre, de la visiter et mieux la comprendre accompagné du maître, page après page. On en reparlera, avec une interview.
Parallèlement, deux de ses amis et collaborateurs de longue date, Dragan de Lazare et Gilson, livrent une compilation de pastiche et de parodie réunissant pour le plus grand plaisir des lecteurs Rubine et Natacha. Deux héroïnes emblématiques traitées avec respect et emmenées dans différents univers pour profiter de l’occasion pour rendre aussi hommage à quelques autres grands maîtres de cet Art. Hommage Collatéral, un album pour lequel nous avons collaboré à la finition en réalisant une interview des deux auteurs, en fin d’album. En voici des morceaux choisis à lire en intégrale dans l'album si vous le possédez déjà.
Mais avant toute chose, un petit mot d’explication sur le cadre dans lequel paraît cet album. Derrière cette initiative, on trouve un duo de créatifs, Olivier Ghys et Michèle Lahaye, passés en 2018 par le programme reStart de Beci, qui accompagne les entrepreneurs ayant fait faillite. Né de la solidarité des temps difficiles, le tandem a pensé à un concept simple pour retrouver du travail : un contrat d’emploi via la Smart pour promouvoir les artistes, leurs œuvres et le patrimoine culturel. C’est ainsi qu’est née ABA ASBL, dont la première initiative est donc cet album, « Hommage collatéral », commis par un collectif de dessinateurs dont Walthéry himself, mais surtout Dragan De Lazare et Gilson, pour ne citer qu’eux.
Bonjour à tous les deux. Vous voilà bien accompagnés. Rubine, Natacha, on ne s’en lasse jamais ?
Dragan De Lazare : Non jamais, des belles filles comme ça, on en redemande. Et pas que nous, il n’y a qu’à voir les files d’attente en dédicace.
Gilson : C’est comme manger ou boire, c’est vital (rires).
Cela fait longtemps que vous collaborez avec François Walthéry, comment est-il au travail ? On a souvent l’image de la BD de papa avec des ateliers et des studios d’auteurs stakhanovistes. J’imagine que ce n’est pas le cas avec François ?
Dragan : Du tout. Travailler avec François est un vrai plaisir. Je n’ai malheureusement pas vraiment eu l’occasion d’être à ses côtés, dans son atelier, comme lui à ses débuts dans celui de Peyo, car à l’époque où j’ai commencé Rubine, en 1991, François avait des soucis de santé, notamment un problème avec son pouce à la main droite. Il n’a pas pu dessiner pendant près d’un an. Et surtout j’habitais Paris et lui à Cheratte. Heureusement, la Poste a très bien fait son travail. Je lui envoyais les crayonnés, François corrigeait ce qui n’allait pas puis me renvoyait les planches, et je faisais l’encrage. Il était toujours très, très délicat lorsqu’il fallait corriger quelque chose. C’était fait avec une gentillesse inouïe. La plupart du temps c’était pour ajouter du mouvement, car le fait de travailler avec un si grand maître de la BD, qui a bercé mon enfance, me rendait assez coincé à l’époque, je dois l’avouer.

© Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf
Avec ces fausses couvertures, vous réalisez le rêve de beaucoup : une aventure commune de ces deux dames parmi les plus adulées du Neuvième Art. Vous en avez rêvé aussi ?
Dragan : Exactement, je crois que tous les fans de l’univers Walthéry ont rêvé de voir ce magnifique duo de choc ensemble. Il m’est, ma foi, arrivé de glisser Natacha par-ci, par là dans les albums de Rubine, Mais c’était un petit clin d’œil amical c’est tout. Ce que nous avons fait avec Bruno et François dans ce livre est vraiment un vieux fantasme qui se réalise enfin.
Au fond, y’a-t-il une bible Walthéry qui dit ce qu’on peut faire ou pas ? Déshabiller mais pas trop ses héroïnes ?
Dragan : Non ça n’existe pas, mais le respect des personnages tels qu’ils sont dans les album nous oblige à rester dans une limite disons « tout public » avec, bien sûr, un peu plus de liberté quand même… mais sans jamais dépasser celle du bon goût et surtout pas sortir du cadre de la beauté. On les aime trop.

© Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf
À quoi faut-il penser quand on fait une couverture, qu’elle soit fausse ou réelle ?
Dragan : À se faire plaisir surtout. Ce plaisir déteint sur les lecteurs. Et croyez-moi c’était le cas avec chacune d’entre elles. Nous avons tous lu beaucoup de bandes dessinées étant enfants et ces histoires ont aidé à développer notre imaginaire. Une fois arrivé dans le métier, on a su et enfin pu dessiner ses rêves d’enfant, entre autres, des couvertures qui n’ont jamais existé, sauf dans notre imagination, mais dont certaines aurait pu réellement exister. Elles sont tellement poignantes qu’en les voyant on regrette presque qu’il n’y ait pas un livre derrière certaines d’entre elles, tellement on aimerait l’ouvrir et plonger dans l’histoire.
Gilson : Une couverture est une invitation lancée au lecteur. La vitrine de ce qu’il va découvrir à l’intérieur de l’album. Elle évoque l’histoire dans laquelle il se plongera au fil des pages. Dans le cas de figure qui nous intéresse ici, nous allons plus loin en lui proposant quelque chose de totalement imaginaire comme le dit Dragan. Car bien entendu, le contenu n’existe pas. Et quoi de plus grisant du susciter l’imagination collective.
Pour les albums classiques, les auteurs ont l’habitude de faire beaucoup de tests et croquis pour arriver à la « bonne » couverture qui va attirer le regard. Quand on se lance dans la parodie, c’est aussi le cas ?
Dragan : Absolument, tout le travail est pareil. Le but, justement, est de réussir à créer une couverture qui donne envie, une couverture qui déjà nous plaît à nous, en la faisant et qui réveillera des sentiments chez tous ces nostalgiques de la bonne bédé classique qu’on dévorait, enfants, dans nos journaux favoris. Bien sûr, lorsqu’on s’inspire d’une couverture existante certains éléments sont déjà en place, de ce point de vue-là, la tâche est plus simple. Mais d’un point de vue technique, le travail est identique à celui fourni pour une vraie couverture d’album. Une fois qu’on a l’idée il faut faire des croquis puis le dessin définitif, l’encrage et enfin la couleur.
Gilson : Et je dirais même plus : c’est un travail encore plus pointu car l’erreur, je dirais, n’est pas permise. Un hommage ou un pastiche se doit d’être respectueux des personnages originaux. C’est aussi un travail de recherches et de documentation souvent fastidieux mais ô combien passionnant tout de même.
D’ailleurs, dans cet album, on trouve aussi des couvertures inédites, non-retenues pour des albums de Rubine. Pourquoi, Dragan ?
Dragan : Pour la simple raison qu’à l’époque, Yves Sente, le rédac-chef aux éditions du Lombard, me demandait de créer trois proposition de couvertures différentes pour chaque nouvel album. Il ne s’agissait bien sûr pas de dessin définitifs, mais plutôt de mise en place et de crayonnés plus ou moins poussés. Comme je m’investissais vraiment dans l’idée de chacune d’entre elles, mais que les trois ne pouvant être choisies, il m’en restait forcément deux jamais réalisées dans les fardes. Et bien là, j’en ai profité et certaines sont enfin devenues de vrais couverture alternative de mes albums parus il y a 25-30 ans.
C’est important de ne pas verser dans le too much, non ?
Dragan : Ah oui, très important. En faire trop est pire que pas assez. Le pas assez laisse encore de la place pour le désir, par contre le too much – donne la nausée.
Gilson : Moi je devrais en faire trop car je n’en fais pas assez (rires).
Une première version non-retenue de Kong Kong le gorille a très bonne mine

Premier essais pour l'album © Gilson
Et de dessiner à la manière de François là où vous avez une large palette de styles différents ?
Dragan : Croyez-moi ce que je fais est LOIN, même très loin du style Walthery. Son style est inégalable. C’est un virtuose qui a une facilité désarmante à faire des choses magnifiques. Chez lui, chaque trait chante, cela bouge de l’intérieur. Je ne me lasserai jamais de regarder encore et encore ces planches incroyables du « 13ème apôtre » de « La mémoire de métal » ou d’ « Un Trône pour Natacha ». Oui j’ai d’autres styles, si on peut dire cela comme ça, c’est un mélange de tout ce que j’ai aimé, de ce que je suis et surtout… de toutes mes imperfections.
Gilson : Je rejoins ce que dit Dragan. Cela dit, il n’y a qu’une personne au monde capable de faire du Walthery et c’est Walthery lui-même. On peut s’approcher du style, oui, mais arriver à confondre non. C’est impossible. Et croyez-moi, pour avoir vu François réaliser devant moi des merveilles à la mine de plomb, il me faudrait bien deux vies pour arriver à une telle maîtrise.
Êtes-vous perfectionnistes ?
Dragan : Ahahahahaha. Je dirais plutôt que je ne suis jamais satisfait de ce qui sort sous ma main. Donc faut gommer, recommencer puis encore re-gommer. Puis lorsque je ne m’y retrouve plus dans tous mes traits, je reprends le dessin à la table lumineuse et hop, c’est reparti…. Lorsque je n’en peux plus… j’abandonne. Et c’est ce que j’ai abandonné que le public voit publié. Mais ça ne veut pas dire que j’en suis content, oh non…
Gilson : Dragan est un Stakanoviste (rires) En fait, je suis paradoxal. Je suis entre guillemets perfectionniste mais doublé d’une indécrottable feignasserie si je puis utiliser ce néologisme. Dès lors il s’agit toujours d’une suite de compromis et de conflits intérieurs. Je dirais qu’être satisfait rapidement de son œuvre est une grosse erreur. Ce que je fais souvent, je laisse « reposer » comme on dit dans le métier. Ensuite quelques jours plus tard je ressors le dessin du tiroir et comment dire ?… je le déchire souvent et recommence en éructant des borborygmes et autre vociférations (rires).
Une première version non-retenue pour un hommage à Tembo Tabou

Scène coupée au montage © Gilson
Il y a le dessin mais aussi les couleurs de Renaud Mangeat qui retrouve les couleurs qui ont tant donné de peps aux albums de ces héroïnes. Lui aussi est passionné ?
Dragan : Oui, et ça se ressent dans ses mises en couleurs. Renaud a fait du très, très beau boulot. Il sent très bien les couleurs, les gammes et il sait créer une ambiance. C’est le plus important pour un coloriste. Il a mis en couleur la couverture principale du livre, les couvertures de François et certaines des couvertures de Bruno Gilson. En ce qui concerne les miennes, je me suis fait le plaisir de tout faire moi-même. Ça m’a beaucoup amusé, alors que d’habitude la mise en couleur ce n’est pas ce que je préfère, c’est très long et surtout fatiguant.

© Dragan de Lazare
Elle vous manque ? Vous aimeriez lui donner une nouvelle aventure ?
Dragan : Rubine? Elle ne me manque pas du tout, je la dessine tous les jours (rires). On m’en demande tout le temps, au point qu’elle ne me laisse jamais chômer. Une nouvelle aventure ? Qui sait ? Je constate surtout que même si la série est arrêtée depuis un moment déjà, la belle Rubine a encore un grand nombre fans. J’ai ouï dire que quelque chose se tramait du côté Mythic – Di Sano…. On attend avec impatience de voir.
Oui, même si plus aucun album ne sort pour Rubine, le public est toujours là au rendez-vous, aux séances de dédicaces notamment. Un personnage culte, intemporel ? Et pourtant délicieusement vintage ?
Dragan : Vous savez les belles filles c’est intemporel. On en veut toujours, encore et encore, et cela ne s’arrange pas avec l’âge (rires).

Une deuxième scène coupée au montage © Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf
Et même si Rubine, et Natacha aussi, ne connaissent plus autant d’aventures que le voudraient les lecteurs, vos couvertures, une seule image par page, n’est-ce pas le meilleur moyen pour raviver l’imaginaire du lecteur et le pousser à créer ses propres histoires ?
Dragan : Certainement. Vous savez, nous aussi ça a commencé comme un petit jeu anodin. On faisait des dessins clins d’œil à notre ami François et ensuite on en a refait pour faire plaisir à des amis, puis ça nous a bien plu et donné d’autres idées… Finalement le battement d’ailes du papillon est devenu ouragan. Et a un moment on s’est dit, pourquoi ne pas les montrer à tout le monde. J’espère que les lecteurs y prendront autant de plaisir que nous.

Un extrait de l'album de Dragan de Lazare
Gilson : C’est vrai, nous nous sommes bien amusés. Réunir ces petites calembredaines en un recueil est en quelque sorte une suite logique. À tel point que nous nous sommes attelés immédiatement à la conception d’un tome 2.
Vintage mais pas nunuche, à l’heure des mouvements metoo et de la révolte des femmes contre le sexisme et un certain paternalisme, Rubine et Natacha pourraient être les égéries de ces mouvements, sexy mais pas folles les guêpes !
Dragan : Je ne veux surtout pas partir dans la politique, mais tous ces mouvements qu’ils soient féministe ou autres m’ennuient profondément. Ils sont le plus souvent imposés aux femmes pour des intérêts de petits groupuscules qui les utilisent pour finalement mieux les exploiter… les hommes comme les femmes… Il est aujourd’hui bien connu que la « libération » de la femme n’est pas apparu pour aider les femmes, mais pour doubler le nombre d’ouvriers sur le marché du travail et donc baisser les salaires, donc pour aider le patronat, pas les pauvres bougres. On a dit à une femme qu’elle est « libre » si elle passe sa journée à trimer pour un patron au lieu de s’occuper de ceux qu’elle aime, de ses enfants, de sa famille. Chaque femme qui réfléchit et qui n’est pas manipulée est consciente de cela. Pour être franc, je ne crois pas que les héroïnes de BD sont des modèles sociaux-culturels. C’est de la détente, une évasion et du plaisir, et ça s’arrête là.
Comment expliquez-vous que ces femmes de papier aient toujours autant de succès, telles des madeleines de Proust ? C’est le génie de François ?
Dragan : Absolument, il a ouvert les portails d’un univers fantastique qui crée un dépaysement, nous fait oublier nos soucis, nous entraîne dans le rêve, l’aventure et la bonne humeur. Lorsque on est amateur de bonne BD, que peut-on demander de plus. Merci monsieur François !

Un ex-libris pour le champagne Vautrain © Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf
Et même si Rubine, et Natacha aussi, ne connaissent plus autant d’aventures que le voudraient les lecteurs, vos couvertures, une seule image par page, n’est-ce pas le meilleur moyen pour raviver l’imaginaire du lecteur et le pousser à créer ses propres histoires ?
Dragan : Certainement. Vous savez, nous aussi ça a commencé comme un petit jeu anodin. On faisait des dessins clins d’œil à notre ami François et ensuite on en a refait pour faire plaisir à des amis, puis ça nous a bien plu et donné d’autres idées… Finalement le battement d’ailes du papillon est devenu ouragan. Et a un moment on s’est dit, pourquoi ne pas les montrer à tout le monde. J’espère que les lecteurs y prendront autant de plaisir que nous.
Gilson : Si je ne m’abuse, c’est la première héroine du genre qui à été créée à l’époque. Elle a traversé les âges et se porte très bien pour une femme d’à peu près 49 ans hahaha ! Et puis il n’y a qu’à voir le public toujours aussi émerveillé et ce quelques soit les générations.
Comment expliquez-vous que ces femmes de papier aient toujours autant de succès, telles des madeleines de Proust ? C’est le génie de François ?
Dragan : Absolument, il a ouvert les portails d’un univers fantastique qui crée un dépaysement, nous fait oublier nos soucis, nous entraîne dans le rêve, l’aventure et la bonne humeur. Lorsque on est amateur de bonne BD, que peut-on demander de plus. Merci monsieur François !

© Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf
Gilson : Si je ne m’abuse, c’est la première héroine du genre qui à été créée à l’époque. Elle a traversé les âges et se porte très bien pour une femme d’à peu près 49 ans hahaha ! Et puis il n’y a qu’à voir le public toujours aussi émerveillé et ce quelques soit les générations.
Avec vraiment un style qui tranche par rapport aux BD’s d’hommes ? Une woman touch salvatrice dans une BD souvent trop dédiée aux héros masculins et où les femmes sont repoussées aux seconds-rôles ? Walthéry a ouvert la porte à une certaine égalité ?
Dragan : Égalité ? Vous me faites rire. Les femmes ont tellement davantage sur les hommes que je me demande ce qu’elles veulent de plus. Elles sont si belles, charmantes, mignonnes, en un mot : irrésistibles… Une femme attire cent fois plus l’attention qu’un homme. Non mais vraiment… de quelle égalité parlez-vous ? Si dans le temps il n’y avait pas tellement de héroïnes dans les BD, c’est que tout simplement on respectait trop la femme pour la caricaturer. Il a fallu au 9ème art le talent d’un François Walthéry pour enfin montrer que l’on pouvait dire aux femmes qu’on les adore même dessinées, même en papier.
L’efficacité du dessin de François, comment l’expliquez-vous ?
Dragan : Si je pouvais l’expliquer je serais sûrement capable de dessiner comme lui, mais malheureusement cela reste encore un grand mystère pour moi aussi. Voilà 40 ans que je dessine en essayant de comprendre comment ont fait les grands maîtres, et à chaque fois que je crois avoir saisi un petit quelque chose, vite je me rends compte que ce n’était qu’une chimère. Dieu donne a ceux que Lui a choisi.
Gilson : ça ne s’explique pas en fait. Mais…ça reste du travail, grand maître ou pas nous ne sommes pas des androïdes.
Dans l’univers Walthéry, quelle est votre couverture préférée ? Et votre aventure ? Pourquoi ?
Dragan : Ma couverture préférée ce n’est pas celle d’un de ses albums, mais une des premières que j’ai jamais découverte, dans Spirou. D’ailleurs elle apparaît dans ce livre en version Rubine à la place de Natacha avec un revolver sur les toits humides. C’est une couverture du journal Spirou datant de 1973.

Cette couverture m’a fait tant rêver. J’imaginais toute la ville, en bas, les gens dans les immeubles avoisinants qui regardent cette fille magnifique en mini-jupe sur leurs toits… puis cette pluie qui donne une ambiance irréelle. À mon humble avis, c’est une des plus belles couvertures de Spirou de tous les temps. Mes aventures de Natacha préférées sont les albums allant de la « Mémoire de métal » à « L’île d’outre monde », ce sont les plus belles aventures, puis surtout parmi elles, il a celles écrites par Maurice Tillieux…. que dire de plus. Si vous n’avez pas grandi avec ça… il vous manque une CASE! (rires).
Gilson : « Les machines incertaines », Je suis féru de science-fiction et celle-ci me parle plus que les autres par définition. Et puis elle réunit les talents de Walthery et Jidéhem ce qui n’est pas rien.
La parodie, est-ce un art facile ou plutôt difficile, finalement ?
Dragan : Les deux, et je m’explique. Avec la parodie on peut très facilement glisser dans le banal, le facile, le vulgaire. Par contre lorsqu’on fait ça vraiment avec amour, passion et tendresse, cela peut donner des résultats magnifiques. Lors de la réalisation de ces couvertures, le fait de sentir l’enfant en moi se réjouir, comme je me réjouissais il y a plus de 40 ans en recevant mon Journal de Spirou hebdomadaire, me rassure que j’ai réussi à y mettre tout mon coeur.
Gilson : comme c’est bien dit (rires). Dans mon cas l’exercice fut certes difficile du point de vue technique. Je n’ai jamais eu l’occasion de travailler sur les personnages de Walthery d’une manière intensive comme on le fait pour un album entier. Il m’a fallu une grande rigueur et pas mal de concentration. Pour le reste, oui c’est le cœur qui s’est exprimé avant tout.
Au fil de vos couvertures, on voit que Rubine comme Natacha sont tout-terrain, elles vont dans l’espace, affrontent des monstres, se retrouvent sur un sous-marin… C’est important de laisser évoluer les personnages dans des milieux où on ne les attend pas forcément ?
Dragan : Oui, c’est le but premier de l’aventure, mais dans ce cas précis, celui de ces couvertures c’est surtout le fait qu’on a voulu rendre hommage à des univers très différent, d’abord à d’autres auteurs et héros de bédé, mais aussi de cinéma et dont le cadre n’est pas toujours forcément lié à l’ambiance dans lesquelles évoluent Natacha et Rubine d’habitude.

© Walthéry chez Dupuis
Y’a-t-il une histoire que vous regrettez que François n’ait pas faite
Dragan : Oh oui ! Une histoire passionnante que j’ai écrite moi-même. (rires)
Gilson : Hmm, un troisième vieux bleu… non je plaisante (rires)
Y compris ailleurs que dans la BD. On ne compte plus les ex-libris, portfolio, objets dérivés auxquels ont donné lieu les albums de Walthéry. Natacha et Rubine ont dépassé leurs albums, sont vraiment devenues des icônes quasi de chair et d’os ?
Dragan : Vous avez raison, et pas uniquement en papier… il n’y a qu’à voir les figurines…. Elles sont de plus en plus grandes. Et là, finalement il y a une Natacha grandeur nature ! Une vrai « petite » perle ! Bon, moi j’attends quand même celle en chair et en os! Vu comment ça évolue, c’est sûrement pour très bientôt.
En tout cas, c’est aussi un jeu de titraille et de textes, trouvez un minimum de bons mots et leurs donner le style des albums, des films auxquels ils font référence. Pas évident ?
Dragan : C’est très facile quand vous êtes inspirés, et surtout amusant, mais des fois ça ne vient pas du tout et je veux justement profiter de cette occasion pour vous dire qu’un grand nombre de titres de ce recueil ont été trouvés par mes amis Dominique Léonard et Bruno Gilson, qui sont de vraies sources d’idées. Je leur dis un grand merci.
Gilson : Pour moi, jouer avec les mots est un pécher mignon, une marotte, quasiment une passion. Il ne se passe pas un jour sans que je détourne quoi que ce soit en une sorte de calembour ou d’à peu près. Mais rassurez-vous je sais quand je dois m’arrêter (rires).
Plus qu’un hommage parodique et bienveillant au monde de Walthéry, vous l’emmenez voir d’autres grands maîtres E.P. Jacobs, Tillieux, Vampirella, du Kox aussi, de la s-f des 50’s et au magazine Spirou, surtout. L’un ne va pas sans les autres ?
Dragan : Bien sûr, c’est un amalgame de bons souvenirs qui a enfanté cet ouvrage. On aurait tant aimé pouvoir dire sans arrêt merci à tous ceux qui nous ont donné tant de bonheur durant notre enfance. Mais la liste est bien longue …nous n’avons que commencé à rendre hommage à certains d’entre eux, mais il y en a tant d’autres. Il nous faut un tome 2 très vite (rires).
Outre ces anciens, dans la jeune génération, certains se réclament de Walthéry ? On le perçoit dans leur style, leur humour ?
Dragan : L’influence est naturelle, tous les grands artistes laissent des traces profondes et marquent les jeunes qui débutent. Certains, comme Franquin, Hergé, Peyo, Macherot, Goscinny, Tillieux, Walthéry et d’autres géants de la BD le feront toujours. Leur héritage est sublime et incontournable. On a une chance énorme de les avoir. On peut y puiser sans arrêt, et je suis sûr que l’on devrait le faire beaucoup plus, s’il y a une crise dans le monde du 9eme art, c’est bien par ce que l’on a un peu oublié ces sources.

Original extrait de l'album © Gilson
Cet album sort chez Bardaf, en auto-édition, si je ne me trompe ? Les maisons d’édition classiques ne sont pas friandes de ce genre d’exercice ?
Dragan : Je laisse Bruno répondre à cette question, car c’est lui qui s’occupe de tout cela.
Gilson : Cette fois il ne s’agit pas d’auto-édition mais d’une véritable structure qu’il serait bien long et complexe à décrire ici. Et en effet les majors ne sont pas friandes de cet exercice. Mais je pense que cela va évoluer. Nombre d’auteurs confirmés issus de grandes maisons se tournent eux-mêmes et de plus en plus vers l’auto-édition. Je pense personnellement que c’est en quelques sorte l’avenir de la BD car cela donne entre autre aux jeunes auteurs, plus de possibilités et de chances d’éditer en album leurs productions via notamment les sites de financement participatifs de plus en plus nombreux sur le web.
Quels sont vos projets ? Encore et toujours du Walthéry ? Cat, pour vous Dragan ? Et un petit indien, Tatanka, pour vous Bruno ? D’autres choses ?
Dragan : (rires) CAT c’est du cyrillique et en Serbe ça se prononce : SAT ce qui veut dire : L’HORLOGE. C’est ma toute dernière BD, mais que je n’ai pas dessiné… eh non… L’Horloge, je l’ai scénarisée. C’est d’ailleurs mon premier scénario publié et je suis fier de dire que c’est un très grand succès en Serbie. Avec mon ami dessinateur de grand talent, Vujadin Radovanovic – Vuja, nous avons reçu le prix de la meilleure BD du Salon du livre de Belgrade cette année. Comme il s’agit de l’histoire de nos arrières grands parents lors de la Grande Guerre, en plus de l’album l’un des plus grands quotidiens Serbes « Vecernje Novosti » a diffusé cette BD a plus de 120.000 exemplaires lors du centenaire de l’Armistice, le 11 novembre dernier. C’est un one shot poignant, une histoire vrai raconté avec émotion, qui a touché au plus profond et a fait pleurer la moitié de mon pays… j’espère que les lecteurs français et belges auront bientôt l’occasion de le découvrir.
Gilson : Tatanka cela veut dire bison en Sioux (rires). Blague à part je vais entamer le tome 2 avec Manuel Tenret (rantanplan). Le format restera à l’italienne en cartonné. Et une intégrale est même prévue avec encore plus de jeux pour les enfants. La date de sortie est normalement prévue pour cette fin d’année 2019 voire courant 2020. Dans le même temps Dragan et moi poursuivrons le travail sur le second tome des hommages et pastiches. Je caresse l’idée d’un recueil de créatures fantastiques mais bon, j’ai déjà pas mal de pain sur la planche pour cette année, nous verrons bien.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Hommage collatéral
Recueil de parodies
Auteurs : Walthery, De Lazare, Gilson
Auteurs invités : Di Sano, Kox, Carpentier, Bojan Vukic
Couleurs : Dragan De Lazare, Gilson & Renaud Mangeat
Genre : Hommage, Parodie
Nbre de pages : 56
Prix : 20 €

Dans les pas de McCloud, Eisner ou Toriyama et en même temps loin des sentiers battus, ce drôle de canard qu’est Yuio réalise un nouveau livre dont il est le héros, et nous avec. Auteur tout-terrain et multi-format, il raconte aujourd’hui son art dans « Dessiner, illustrer : manuel en BD ». Pour apprendre à en faire… ou à mieux la lire de manière didactique et ludique, fascinante et dynamique. C’est presque un artbook que livre celui qui semble capable de tout le crayon à la main. Grande interview à Ad Hoc à Namur (Belgique).

© Yuio
Bonjour Yuio, Dessiner illustrer, Mode d’emploi en BD, c’est un drôle de livre, non ?
Une sorte d’OVNI dans le catalogue d’Eyrolles qui est une maison d’édition habituée des livres didactiques et artistiques mais très explicatifs et démonstratifs. Sans visuel fort et assez rigides. Pour mon album, j’ai pensé à L’apprenti mangaka d’Akira Toriyama, avec un petit personnage qu’on fait rebondir, un petit théâtre, des personnages. Le nécessaire pour donner envie au lecteur de nous suivre.
Mais finalement, on y apprend à être auteur mais aussi à être (meilleur) lecteur, non ?
L’idée, c’est d’approcher l’univers de l’image, de la peinture au graphisme mais aussi le comment penser faire une BD. Je voulais d’un ton le plus universel qu’il soit pour porter la base d’apprentissage. Bon, si on ne veut pas apprendre, je ne peux rien faire.
Scott MC Cloud, lui, s’adresse aux gens qui veulent déjà s’intéresser à ce médium.

© Yuio chez Eyrolles
Quelle est la genèse de ce projet ?
Pour aider mes étudiants de St-Luc Liège, je m’étais mis en tête de faire de réaliser une planche de BD pour en expliquer un des concepts à l’oeuvre : la typologie, la trame… Une manière de montrer qu’il y a moyen de raconter tout, d’être didactique même au niveau presque 0. Et ça fonctionnait, j’ai procédé de la sorte pendant six ou sept ans, jusqu’à produire une quarantaine de planches, à accumuler et à faire le pas vers les éditeurs.
À cause d’un déclic ?
J’ai publié quelques pages sur Café Salé et sur Facebook. Les gens étaient intéressés. Bien sûr, je voulais bien leur faire plaisir mais pas en faisant un crowdfunding. J’avais besoin d’un relecteur, d’un directeur artistique. Je ne voulais pas non plus que ce soit hyper-directif mais je devais trouver à qui parler. Dans une BD, il faut se moquer de soi-même, il y a toujours une part de soi. L’humour que j’y ai mis, je n’en étais pas sûr, en dessinant certaines cases humoristiques, je voyais déjà le désespoir dans les yeux de certains.

Frères de la côte © Yuio
J’ai redessiné la moitié de la quarantaine de pages d’origine. Notamment celles sur l’écriture, la typographie. À la base, j’avais couché ça sur quatre planches, pas une de plus. Cependant, je ne devais pas être trop rapide, il fallait que tout le monde comprenne et reste dans le temps. Être précis et dilué. De l’idée de base, il fallait développer les fils dans un souci de bonne lecture. Ce livre est pensé pour le lecteur, pour que ce soit aussi fun et visuel. Cet album, c’est le résumé de l’expérience d’une personne qui collabore – je n’aime pas le mot « prof » – et donne du temps à des élèves. C’est le résumé d’échanges amicaux avec des jeunes motivés et posant souvent les mêmes questions.
Et les éditeurs ?
J’ai envoyé le dossier aux éditeurs classiques sans que ce soit vraiment concluant. C’est après que j’ai contacté Eyrolles. J’avais certains de leurs manuels mais je n’avais jamais pensé à eux. Ils ont mis un an à comprendre ce que je voulais faire.
Les éditeurs cherchent des BD qui, soit, vont se vendre, soit, vont remplir les étalages. Avec des auteurs plus ou moins mal coachés. Du coup, les albums se font rapidement et sur base de peu de moyens. On ne peut pas atteindre 100% de qualité si on n’y met pas le temps et l’argent. Aux éditeurs de savoir quoi faire.

© Yuio
Dans mon cas, ma première crainte, je l’ai exprimé comme tel : je ne sors pas cet album si « ce n’est que » pour bousiller des arbres. Puis, pour éloigner ma deuxième crainte, il me fallait une direction. Ainsi j’ai soumis le squelette à mon éditeur chez Eyrolles. Il a veillé à ce que je n’oublie rien. À commencer par ma présentation, et une page en fin de tome qui y revient. Puis, mine de rien, même si je n’en avais pas forcément conscience, j’étais un Belge qui parlait à des Français. Il fallait donc que tout soit compréhensible, dans mes expressions, ma manière de parler. Dans la structure et dans la lecture, je devais parler au plus grand nombre. Parce que, que je le veuille ou non, je parlais belge.
Pourquoi le faire avec des animaux ?
Le canard que je suis a un côté omniscient, un peu lourdingue. Même s’il est un peu moi, j’ai envie de le dégommer. D’où l’apparition des souris. Elles n’étaient pas censées représenter quelqu’un, au début. Puis, je me suis très vite rendu compte qu’elles ressemblaient à mes élèves. Ils savent des choses mais ils posent tout plein de questions, ils sont indomptables et mettent un peu le bordel.

© Yuio chez Eyrolles
Bref, les animaux, on peut les customiser, des lunettes, une moumoute, tout en se servant de ce qu’ils véhiculent. Chacun a son animal-totem. Pas mal d’auteurs se voient comme des ours dans leur grotte. Dans Blacksad, les animaux sont connotés. Le félin, ce n’est pas pareil qu’un poulet.
Remarquez, Blacksad fait des émules. Il y a toujours eu de la BD animalière mais là on tient une référence. je ne compte plus les étudiants qui me présentent une scène de bar dans Blacksad.
Pourquoi un canard ?
Ça vient d’un projet que j’avais créé avec d’autres, Tas de canards. Il suffisait de remplacer un « a » par un « o » pour arriver à ce que vous savez… Nous avions créé un jeu vidéo, Opération Wolf pour se lâcher, expurger les fantômes du passé? Avec des canards partout.
Quitte à parler d’animaux, on peut parler d’un crocodile très célèbre.
Oui, Kidibul. C’est une société d’Erpent, Pilipili qui gère tout ce qui concerne Kidibul et son image. C’est une marque belge qui continue à grandir. Du coup, pour marquer le coup, ils m’ont demandé de relooker le logo, la mascotte. Nous sommes en train de l’animer pour le site.

© Yuio/Pilipili
Par ailleurs, j’ai fait un calendrier pour les scouts, certains visuels de recettes de Delhaize. En fait, chacun a sans doute chez lui un visuel réalisé lors de l’une ou l’autre commande.
Sans que cela soit signé, bien sûr. Avec des commandes que vous refusez ?
Ces entreprises qui vous demandent de faire le portrait de leurs cinquante employés. Chacun ne se voit pas forcément comme il est et comme je le vois. Certains ont pris un peu de poids. Ça peut vite devenir un enfer.
Puis, il y a les faire-parts. Pour la même raison : les parents ne voient pas forcément leurs enfants comme ils sont.
Puis, il y a les couleurs et les retouches. En travaillant sur le logo de Vaillant, je me suis rendu compte qu’il y avait des touches de vert à des endroits précis. Que cela découle de référence. Il y a une logique, il faut se documenter mais, du coup, ce n’est pas spontané, ça nuit à la créativité. Aussi, je ne bosse pas pour les partis politiques, ni les mutuelles. Parce qu’il faut justement utiliser certaines couleurs et pas d’autres. Je n’aime pas trop le vert, par exemple, ça passe mal à l’impression.

© Yuio
Ce livre, en partant de la théorie, vous permet de faire des illustrations dans tous les genres.
Comme ce cheval qui débarque en spécialiste des couleurs, des chevaliers, des dragons. Puis, il y a les Primitifs flamands qui me donnent l’occasion d’aborder les costumes. Il fallait varier pour ne pas me lasser.
Vous arrivez après Eisner, McCloud et quelques autres qui se sont servis d’un album ou plus pour expliquer leur art, qu’amène le vôtre ?
Au moment où je voulais en faire une BD, beaucoup d’éditeurs m’ont dit que des grands noms comptaient le faire. Alors, j’ai attendu, je voulais voir et surtout ne pas faire doublon. Rien n’est venu. Alors, je me suis dit que j’allais le faire cet album.
À force de faire de la BD didactique, de la BD dont vous êtes le héros, on ne sait pas trop où me ranger. J’ai fait des bandes dessinées pour apprendre le français aux Allemands, des histoires faisant intervenir des références culturelles, des expressions. Avec une typographie très espacée pour que les apprenants discernent bien toutes les lettres. J’ai aussi travaillé sur des récits d’apprentissage pour Erasme, à destination des 16-18 ans, avec une sorte de super-héros, avec un blason. J’ai aussi fait des illustrations pour un jeu de société Artefact, en crowdfunding.
L’éditeur m’a posé la question de pourquoi je voulais faire ça, je n’étais pas le premier. L’idée n’était pas d’être plus actuel mais de montrer l’état d’esprit d’une école qui marche: St-Luc Liège.

© Yuio
Pourquoi ?
Les deux St-Luc, Bruxelles ou Liège, ont chacun leur flambeau. La Belgique et la France font exception culturelle: partout ailleurs en Europe, on ne lit pas autant de BD. La plupart des auteurs qui sortent de chez nous sont reconnus dans le métier. Les gens qui passent chez nous, sortent avec un bagage. Tout le monde ne réussit pas dans la BD, mais trouve sa place dans le monde de l’image. Dans mon année, nous sommes seize à être sortis, seize artistes devenus. Il y a peu de formations qui balancent vingt heures de cours ciblées dessin.
En Suisse, au Québec, les auteurs ont tendance à se débrouiller un peu tout seul, en apprenant le code des comics. Tout le monde n’a en tout cas pas de BD chez soi. En Espagne, la BD reste faire pour les enfants.

© Yuio
Mais, il faut essayer de rendre cette école perméable, que les auteurs ne soient pas la copie de leurs professeurs. Il y a des bases sur lesquelles les élèves se développent et dévient. En tout cas, St-Luc garde le lien, pas qu’amical: si un jour tu es passé par chez nous, on partage ton travail sur Facebook, on t’invite à venir en parler. Parmi les élèves, on voit ceux qui se permettent d’expérimenter et ceux qui sont oisifs par rapport à ceux qui prennent le pli de devenir professionnels. Je n’aime pas le mot « métier-passion » mais c’est ça. Si tu n’es pas moine, si tu ne donnes pas ta vie, tu n’auras pas assez de temps. C’est la cigale et la fourmi.
Avec toujours autant de succès ?
La section se porte bien avec des prix pour certains de nos anciens et des auteurs qui creusent leur trou : Julien Lambert, Grossetête…
Puis, il y a un certain girl power, des filles qui viennent avec des idées, un sens du dessin, amenant des thèmes particuliers là où les garçons nous parlent beaucoup de zombies et de dragons. Ça fait cliché, mais c’est la tendance.

© Yuio
On a produit beaucoup de BD de garçons, désormais ça changer. Puis, il y a aussi beaucoup de coming out en BD, des transgenres qui s’approprient le médium pour travailler le non-dit, avoir un regard intérieur et une certaine attitude qui construit le non-dit. La tablette mobile lumineuse et portative a également fait son entrée dans nos auditoires. Moi, j’aurais eu peur de transporter tout ça.
La BD, c’est un support didactique également pour les personnes dys, le visuel aide. Les enfants comprennent très bien. Puis, St-Luc se veut inclusif. Dans nos cursus, c’est incroyable le nombre de dys- que l’on retrouve. Ils viennent à l’artistique, à l’aspect créatif parce qu’il leur est important de trouver d’autres voies pour s’exprimer.
Et des inquiétudes ?
Une bonne partie a du mal à se projeter. La société fait peur, quelles seront les réalités du métier plus tard. C’est dur mais passionnant. Cela dit, le ver est dans le fruit. Certains étudiants n’ont pas de sous mais lisent des scans de BD. Pour la promotion de cet album, un journaliste m’a demandé que je lui envoie le pdf. Hors de question, je ne voudrais pas prémâcher le travail. Mais, la mécanique est lancée, beaucoup de lecteurs lisent des mangas en avance sur la parution française. Des éditeurs prennent aussi des risques en traduisant tout et n’importe quoi.
Cela dit, il y a malheureusement des albums auxquels on n’aurait pas accès sans les scans.
Dans l’album, vous expliquez mettre au feu vos archives, vos crayonnés.C’est vrai ?
Peut-être pas au feu, mais les trois quarts du temps, je garde juste ce qui me semble le plus intéressant. Je ne veux pas m’encombrer, je garde mes carnets de croquis. Je n’ai pas le culte de garder les originaux. D’ailleurs, on ne m’a jamais demandé pour en acheter… ou alors à des sommes dérisoires. Face à un collectionneur je serai un agneau pour le loup.

© Yuio
Dans cet album, vous abordez d’ailleurs la manière d’envisager les différentes parties du corps d’un personnage. À commencer par les mains. Outre le visage, ce sont elles qui donnent l’expression, également.
Ça peut sembler être des banalités mais si on ne le souligne pas, ça peut passer inaperçu. L’expressivité ne tient pas qu’au visage mais aussi à la manière dont on se tient. Et certaines expressions françaises doivent trouver un équivalent dans le dessin. Avoir un bâton dans le cul, il faut le dessiner ce bâton.
Le visage, on le dessine à partir d’une forme ovale, ou d’un carré. Puis, j’ai enrobé tout ça d’une culture pseudo-belge, avec des patates et des frites. Les frites pour les doigts, par exemple.
Quant au texte, il s’est progressivement réduit au profit de l’image. Avant il ne lui laissait que très peu de place.
Avant, la BD avait une image dérisoire, populaire, facile. Un personnage ouvrait une porte, il fallait aussi le dire dans le texte.

© Yuio chez Eyrolles
Aujourd’hui, le lecteur cherche plus une expérience, une mise en scène qui existe. Désormais, texte et image cohabitent plus qu’ils se superposent. Le silence qu’utilise Manu Larcenet dans Blast, cette volonté d’être contemplatif chez certains auteurs, ce n’était pas possible il y a quelques années. Bon, il reste Blake et Mortimer qui continue sur le même moule.
La méthode a changé niveau documentation ?
Avant, on achetait des modèles. Aujourd’hui, en plus, nous avons l’outil technologique, avec des modèles 3D dont on peut s’inspirer et déplacer carrément pour le mettre dans l’axe qui nous convier. Avant, on achetait des modèles. Désormais, on peut aller sur Google Skektch Up pour créer des modélisations. Ce n’est pas du copiage ou du plagiat. Faire du copier-coller, ça n’a aucun sens artistiquement.
Bon, pour les personnages, ça peut coincer. Mais il y a toujours les copains qu’on peut prendre en photo.

© Yuio chez Eyrolles
Si on revient aux modèles et documentations qu’on trouve sur internet. Un auteur de western me disait qu’en faisant ses recherches, il était tombé sur une image déjà croisée dans l’oeuvre de deux autres dessinateurs. N’y a-t-il pas un risque qu’un jour tout le monde utilise un choix restreint d’images, avec des similitudes et une perte de créativité ?
Pinterest, tout le monde connaît, mais beaucoup ne poussent pas assez loin leurs recherches et se limitent à quelques mots-clés. Avec le risque, en effet, de tomber sur la même image que le voisin. Il est nécessaire d’ouvrir le jeu. Ce n’est pas grave d’avoir des références, c’est même mieux.Mais il faut qu’elles activent l’imagination, qu’elles soient retravaillées. Pas uniquement un calque.
Vous parlez aussi du sens de lecture. Et, mine de rien, dans une BD, c’est parfois dur de s’y retrouver avec des phylactères parfois mal placés. Pourtant, récemment, dans Yasmina et les mangeurs de patates, Wauter Mannaert m’a surpris en amenant sur la planche de gauche, mon regard vers le bas, et, en passant sur la page de droite, en le faisant remonter, à contre-courant, contre la nature.
Je n’ai pas lu cet album. Mais Fred a été l’un des pionniers, il a décloisonné la BD. C’est du domaine public. Il y a Imbattable qui passe dans Spirou. Il faut être doué pour le faire. Si on se foire totalement, on risque de perdre le lecteur.
Votre dessin, comment le concevez-vous ?
Je n’aime pas la BD, les comics ou les mangas, j’aime la narration. Mon dessin, c’est un melting-pot, j’adore le dessin des auteurs de manga, je fais partie de la génération qui entrait en librairie pour, mais j’aime aussi le rythme insufflé aux Walking Dead. J’ai grandi avec Les chevaliers du Zodiaque mais ce n’est pas mon dessin naturel. Puis j’ai ma manière de taper dans l’humour, l’auto-dérision.
Aujourd’hui, les éditeurs ont permis aux couleurs de se libérer. Le trait a tendance à disparaître, à faire place à quelque chose de très animé, dans l’esprit japonais.

© Yuio
Parmi vos conseils, y’a-t-il des choses que vous n’appliquez pas ? Qui vous rebutent mais que vous devez malgré tout enseigner ?
Un truc que je ne fais pas souvent, c’est la démonstration graphique, la plongée – contre-plongée. Puis les carrelages, comme je travaille à l’outil informatique, je me sers de modèles à plat sur lesquels j’applique la perspective.
Vous le laissez tomber parfois, cet outil ?
Ma femme m’a forcé à partir en vacances, deux mois… j’en ai profité pour terminer mes planches à la main. Ça fait du bien d’abandonner ça. Il faut éviter la fracture numérique.
Il arrive encore que certains de mes étudiants n’aient pas d’ordinateur, pas Photoshop. Un crayon, du papier, tout le monde possède ça. Il est bon de reprendre ses tics, à l’ancienne, loin de cette fenêtre lumineuse qui cherche à nous aspirer, qui nous captive malgré nous.
Pour aborder la question des plans, vous parlez de « ségrégation des plans », elle est de vous cette expression ?
Ça me vient de mon professeur d’histoire de l’art. Je réintroduis aussi une partie de ce que j’ai pu apprendre quand j’étais étudiant.

Frères de la côte © Yuio
Et la BD du futur ?
C’est horrible pour un auteur de penser à ça. Parce qu’on nous fait fonctionner avec des contrats courts qui nous permettent de voir à un ou deux ans. Avant, on faisait une chose et on en vivait. Aujourd’hui, c’est le fruit de commandes, de rencontres, on doit se diversifier, être multitâche et commercial… malgré soi. Et ça a commencé quand les éditeurs nous ont demandé d’être un peu graphistes en scannant nos planches. Comme si dans une banque, le banquier vous demandait de faire le guichetier à sa place. Bien sûr, certains veulent se mobiliser, c’est très bien, mais les auteurs de BD forment un groupe d’autistes. On se connait tous pour la plupart, mais on ne bouge pas tous en même temps.
À St-Luc, je n’ai pas de casier. Pour partir quand je le voudrai, quand je n’aurai plus rien à raconter.
La BD du futur ? Une partie se développera sur le web, mais il faudra la réinventer. Parce que le papier est fait pour faire fonctionner l’ellipse, la double-page et participe au plaisir de lecture. Comment va-t-on garder le « tourner de page » ?

© Yuio
Aujourd’hui, moins de gens lisent plus mais plus de gens lisent moins. Pourtant, pour la BD, il y a une planche de salut, le fait qu’il y ait des images partout. Encore faut-il parvenir à les capter. Le futur de l’image, j’y crois. Celui de la BD, je ne sais pas. Il y a peu de nouvelles séries qui fonctionnent vraiment bien. Je ne sais pas comment on peut faire évoluer le médium. Que sera Thorgal dans vingt ans ?
Serons-nous condamnés à appliquer le modèle des comics, de la BD industrielle de masse alors que nous sommes partis sur le « luxe » de l’album, dans un procédé de fabrication auquel les gens sont habitués.
Cela dit, cela fait vingt ans que je fais ce métier, je suis surpris du temps que j’ai passé à faire ça.

© Yuio chez Makaka
Vous avez été à Angoulême, cette année.
Ce fut difficile, ils ont revu l’organisation du festival dans la ville. Comme si, à Namur, j’avais été au Grognon et que les attractions étaient à la citadelle. Le battement entre les rendez-vous ne suffisait pas et certains ont dû être annulés à cause de retards. Les deux premiers jours, j’en ai raté quelques-uns. Après, j’ai laissé venir.
J’étais donc dans la Bulle Manga, côté mangakas. Ils ont une part d’auto-formation mais aussi la puissance d’image sur tous les sujets, du vin au kamasutra. Nous, en Europe, nous sommes plus fictionnels, la plupart du temps. Le problème dans cette Bulle Manga, c’est que mon album était hors-budget. Les gamins qui y traînent n’ont que 10€ en poche pour un manga. Alors ils feuilletaient mon livre et le reposaient. Cela dit, j’ai aussi eu pas mal d’adultes, c’était assez chouette. Ils étaient curieux. Beaucoup m’ont demandé si ça allait être traduit. On verra le succès en français, déjà. Et une télévision du Kazakhstan m’a interviewé. Ils ne font pas de BD là-bas. Il trouvait ça intéressant, cette possibilité d’apprendre un sujet par la BD.

Trikaar © Yuio
Si j’aime les dédicaces ? Si j’en fais, c’est que je le veux bien… mais pas beaucoup. Quand une expo, même mini, accompagne une séance de dédicaces, la plus-value est là. Pour le reste… Cela dit, les moments échangés sont agréables, bien souvent, mais je serais tout autant heureux en passant plus de temps avec ma famille. Je partage du temps avec des gens qui ne se rendent pas toujours compte de ce temps.
À Angoulême, tu ne sais jamais ce que tu vas faire, c’est comme une mousse insaisissable, tu prends ce qui vient.
Et la suite ?
À Angoulême, avec Eyrolles, on a parlé de la suite. Toujours pour mes cours, j’ai réalisé d’autres planches explicatives qui ne sont pas parues : comme utiliser Photoshop… J’ai de plus en plus des envies de scénario ou de collaborer à un scénario. Avant, je faisais des plans de carrière. Arrive un moment où tu n’en fais plus, parce que ce n’est tout bonnement pas possible. Ici, j’ai encore quelques mois pour voir venir et me relancer dans un nouveau projet.
Un scénario ?
J’ai des fulgurances scénaristiques quand je cours ou que je suis en voiture, quand je ne sais pas prendre de notes. J’ai pas mal d’idées de récits, comme l’histoire d’une famille qui accueille une jeune fille. J’ai fait de même avec une amie espagnole, il y a peu, mais ce n’est pas autobiographique. Je réalise aussi des petits gags de capoeira. Ça marche auprès des initiés, mais les autres ?
Cela dit, ce nouvel album m’a prouvé que quand j’écrivais on me comprenait, que je pouvais faire rire le lecteur. Là où j’entendais la petite voix dans ma tête me dire : « tu n’es pas drôle ». Dessiner ou écrire, je le ferai toujours, je me vois mal faire autre chose. Mais je commence à pouvoir prendre du temps pour moi. Je me lève tôt mais je prends du temps pour moi, c’est un luxe après quelques années de carrière.

© Yuio
Des albums BD, vous en avez sorti peu finalement. Ce nouveau titre, c’est un peu la face visible de l’iceberg, non ?
Quand je compte le nombre de pages que je fais par année, c’est comme si je faisais un album par an. Pas forcément un 48 planches. Puis, il y a mon travail pour les jeux de société, les illustrations. Je fais des illustrations pour des récits enfants et express d’Averbode, j’ai fait de la mise en couleurs en collectif, notamment sur des albums de Duhamel, sous le nom de Corporate Fiction. Dans la communication, j’ai aussi eu deux fois l’Alph Art de la communication avec Dominique David, Rudi Miel et Christina Cuadra, puis, Denis Bodart.
Je crois qu’il y a un sommet à atteindre, après ça ira d’office moins bien. Je ne sais pas où j’en suis. En fait, Yuio, j’ai mis vingt ans à me rendre compte que cet auteur existait bel et bien. Dans l’actu, il y a aussi la réimpression des Magiciens du fer, un livre dont vous êtes le héros que j’avais réalisé avec Cétrix. Il s’est exporté aux États-Unis et en Pologne sans que je comprenne vraiment pourquoi. Cela dit, les pays de l’Est aiment beaucoup les jeux, sont ludiques et curieux, et beaucoup passent en leur centre névralgique, un gros salon Allemagne.
Ce genre d’album, c’est un casse-tête, il faut vraiment y intégrer la mécanique du jeu. Vérifier que les numéros puissent se suivre. Ce sont les codes de la BD mais pas sa narration. Et comme on élaborait ça sur PC, on ne se rendait pas compte du « tourner de page ». C’est beaucoup plus chronophage dans la phase de vérification. Ça nous force à sortir des habitudes de graphistes.

© Yuio
Des coups de cœur récents?
L’homme gribouillé de Serge Lehman et Frederik Peeters. Peeters, c’est le seul auteur à qui j’ai demandé une dédicace, il y a quelques années. Puis, il y a Phoolan Devi, ce n’est pas pour rien que c’est une fille, Claire Fauvel, qui l’a réalisé. Il y a aussi HMS Beagle, Aux origines de Darwin de Jérémie Royer et Fabien Grolleau. Dans les moins récents, il y a Golden Kanui, un manga seinen de Satoru Noda, pour les adolescents, qui aborde l’humain, un aspect anthropologique sur les Aïnous.
Puis, il y a Kidz d’Aurélien Ducoudray, un journaliste, et de Josselyn Joret, un Français parti s’installer au Québec et qui travaille dans le jeu vidéo.
Globalement, je trouve qu’il manque un magazine BD, Lanfeust et Psykopat ont fermé boutique, c’est triste.
Vous dédicaciez le 30 mars chez Adhoc, à Namur (Belgique).
C’est le lieu de mon premier boulot. Ils organisent rarement des séances de dédicaces. Si je n’allais pas chez lui, je ne sais pas où je le ferais.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Dessiner, illustrer: mode d’emploi en BD
Récit complet
Scénario, dessin et couleurs : Yuio
Genre : Apprentissage, Documentaire
Éditeur : Eyrolles
Nbre de pages : 128
Prix : 15€
Date de sortie : le 31/01/2019

Après une première partie d’entretien consacrée à Green Class, Jérôme Hamon nous raconte ses débuts, nous apprend la genèse de ses différentes séries et nous dévoile ses projets.
Entre des études de commerce et la bande dessinée, tu as travaillé dans le cinéma, les jeux vidéo et la télévision. Qu’as-tu fait dans chacun de ces domaines ?
J'ai commencé à travailler en finance de marché comme analyste financier. Dans le cinéma, dans les jeux vidéos et à la télévision, j'ai à chaque fois travaillé dans le marketing.
Je me suis toujours servi de ce que j'avais appris pendant mes études pour essayer de percer dans ce milieu et pour essayer à chaque fois d'aller un peu plus dans l'aspect artistique. Je me suis toujours servi de ma formation de base.
Quand j'ai travaillé dans le cinéma, je travaillais dans filiale de France Télévisions qui vendait les droits à l’international des films coproduits ou produits par France Télévision. Je m’occupais surtout de la création de plaquettes, de synopsis pour essayer de vendre, de faire connaître à l'international, pour trouver des sociétés qui accepteraient de distribuer des films de France télévision.
Dans les jeux vidéo, j'ai travaillé à l'époque chez Ubisoft, sur Far Cry, dans la création de tout ce qui pouvait accompagner la sortie des jeux. Je m’occupais de la relation avec les journalistes. Je diffusais les informations de façon progressive. En amont, je m’occupais d’études de marché pour savoir comment on pouvait se différencier par rapport à d'autres jeux vidéos.
Ensuite, dans la télévision, j'ai travaillé sur les sites internet France Télévision (France 2, France 3 France 4 et France 5). C'est là, que j'ai fait la passerelle avec la BD, en développant sur France 5 un site internet qui s'appelait “les rencontres de la BD”, avec le constat de base à l’époque, qu'il y avait très peu de choses faites sur la bande-dessinée, que c'était un art qui était finalement, assez peu représenté dans les médias. On a voulu développer un site internet sur lequel on faisait des interview d’auteurs de BD, et qu'on diffusait aux internautes. C'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des dessinateurs, des scénaristes, des éditeurs, et que je me suis vraiment plongé dans ce milieu là .
.jpg)
© Kana
Ton premier album, Yokozuna, se passe au Japon. Entre un début de carrière dans la finance aux Etats-Unis et un retour en Europe, était-ce une volonté de faire un grand écart ?
Quand j'ai commencé à créer des projets, ce qui m'intéressait, c'était de parler de choses qui me touchent vraiment. Le Japon m'a toujours attiré, parce que j'ai baigné dans cette culture là quand j'étais enfant. J'ai fait plusieurs années du judo et j’étais de la génération du Club Dorothée. Au lycée, j'ai pris une option japonais en troisième langue. J'ai toujours eu une sorte de fascination pour ce pays. Quand j'ai commencé à faire des histoires, pour la même raison que dans Green Class j'ai parlé de la Louisiane et pas de la France, j'ai voulu créer une histoire au Japon, pour parler de ce pays qui me fascine. Par contre, je me suis rapidement aperçu que j'avais le point de vue de l’occidental. Je n'avais pas vraiment de légitimité pour raconter une histoire qui se passait au Japon entre des Japonais. J'aurais pu faire ça, mais je pense que je serais complètement tombé à côté de la plaque, en faisant une histoire qui aurait parlé peut-être aux Occidentaux, mais qui d'un point de vue Oriental aurait manqué son but. Alors, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que j'allais parler de la vie d'un occidental qui découvrait la culture japonaise. J’ai découvert l'histoire de Akebono, cet homme au destin absolument incroyable, l’histoire d'un adolescent hawaïen qui ne parle pas un mot de japonais, ne connaît quasiment rien du pays, mais a un rêve, celui de devenir sumotori. Sa vie m'a vraiment parlé car dans mon quotidien de l’époque j’avais cette envie d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas, un domaine dans lequel j’étais totalement néophyte. Je me retrouvais dans ce personnage qui mettait sa volonté au service de la réalisation de son rêve : découvrir une culture, se battre, lutter contre soi et contre les autres pour y arriver. Après cette phase de découverte du personnage essayant de devenir sumotori (moi essayant de rentrer dans le domaine de la bande dessinée), Akebono va atteindre le plus grade et devenir le premier étranger à devenir Yokozuna. Au Japon, ils ont l’aura des demi-dieux. A cette époque-là où le Japon a des rapports très conflictuels avec les Etats-Unis, le destin d’Akebono était exceptionnel. Ça faisait écho à ce que j’avais vécu à New-York. J’étais bien établi dans un milieu. Je me suis demandé ce que je retirais de cela. Après un accident, Akebono va être opéré des genoux. Il va être persuadé que sa carrière est finie, et se rendre compte que le plus important n’est pas la destination mais le cheminement. Une fois devenu Yokozuna, Akebono porte un regard amer sur ce succès. Ces deux penchants du personnage correspondaient à deux facettes de moi.
.jpg)
© Kana
Nils est une fable écologique. Nils fait en quelque sorte une quête initiatique accompagné par son père. Est-ce que Nils serait un peu Jérôme accompagné de son père spirituel Miyazaki ?
Je n'avais pas vraiment vu ça comme ça mais oui probablement. Nils pour moi, c'était un peu le constat que dans ma vie, je m'étais laissé happé par notre société de consommation dans laquelle on consomme facilement des produits. Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup de BD, j'adorais les jeux vidéos, les films. Finalement, en tant qu'être sensible, je ne me suis intéressé que très tard à ce que je pouvais faire. J'ai découvert assez tard qu'on pouvait prendre une place dans la vie et s’investir.
L’histoire de Nils c'est la quête cathartique de ce jeune homme, qui va avoir un choix à faire, rester spectateur de sa vie ou essayer d’y prendre part.
.jpg)
© Soleil
L’écologie, la mémoire, l’équilibre sont les principaux thèmes du triptyque et sont des thèmes que l’on retrouvera dans Green Class.
Oui. Je suis sensible à tout ce qui se passe en ce moment, à la destruction de la planète qui a lieu et à celle d’espèces vivantes.
Quand on voit que la vie a mis des milliards d'années pour arriver à la diversité écologique que l'on connaît aujourd'hui et que l'homme en l'espace de quelques dizaines d'années est en train de faire tout simplement disparaître ces codes génétiques.
On arrive à concevoir des vaches laitières qui vont vont produire beaucoup plus de lait. On peut transformer des pastèques pour qu’elles soient carrées et tiennent dans des caisses. Mais tout ça, c’est du bidouillage. On est incapable de créer de nouvelles espèces animales en mixant une girafe avec une gazelle ou un éléphant.
On constate que l'homme, pour des fins économiques, n'a aucun scrupule à détruire la planète. Le problème est le même avec la culture des OGM. On créée des graines stériles pour balancer des pesticides et avoir des récoltes plus facilement. Je trouve ça complètement effroyable. Cela me parle de traiter ce sujet et d’exposer pourquoi la situation est dramatique. L’âme de la nature est la source de la vie.
.jpg)
© Soleil
Comment deux auteurs quasi-inconnus se retrouvent dans un collectif sur le Marsupilami chez Dupuis ?
Dupuis nous a contacté quand il y a eu cette histoire de Marsupilami pour savoir si ça pouvait nous intéresser d'y participer. Bien sûr, on a dit oui. Déjà à l'époque, on était en train de travailler sur Green class. Ça nous a vraiment plu de parler du Marsupilami avec l’état d'esprit qu'on avait sur notre nouvelle série, c'est-à-dire faire un traitement assez réaliste des choses. Notre postulat de base partait du fait qu’on fait du Marsupilami un être évidemment très rigolo. qui est juste une force de la nature, l'espèce la plus haut placé dans la hiérarchie, dans la pyramide alimentaire. En fin de compte, on s'est intéressé au passé. On s’est demandé comment la vie avait pu arriver à cet être, pourquoi était-il aussi fort. Et si les Marsupilamis étaient simplement des supers guerriers hyper puissants ? On a inventé ce passé à ce personnage-là, un passé qui le rattrape qui nous a amené à parler du cycle très triste de la guerre où deux peuples, deux clans, deux ethnies peuvent être amené à se combattre de générations en générations. On devient déconnecté de la réalité et on entre dans un cycle de la haine.
.jpg)
© Dupuis
On doit être dans la peau d’un gamin à qui on a prêté un jouet et qui prend garde à ne pas l'abîmer.
Oui bien sûr évidemment. Notre éditrice Laurence Van Tricht nous a fait vraiment confiance, elle nous a laissé libre de raconter l'histoire comme on voulait. C'était vraiment génial. On a eu toute la latitude pour le faire. On n’a jamais été censurés et il y a eu validation du scénario par Dupuis.
.jpg)
© Dupuis
Emma et Capucine est ton projet le plus féminin. Le public des jeunes filles est plus difficile à amener à la bande dessinée que celui des garçons. Comment s’y prend-on ?
Ce qui est important pour moi c'est de parler de choses qui me touchent. En fait, si quelque chose ne me touche pas, j'ai l’impression de n’avoir aucune légitimité à en parler.
Ma fille Anaë qui a 10 ans est passionnée de danse classique depuis qu'elle est toute petite. Elle a commencé vers l'âge de 3 ou 4 ans. Je la voyais le soir enfiler son tutu. Elle se regardait devant le miroir en position de danseuse. Ce qui m'intéressait était de découvrir ce qu'il y avait derrière ce rêve-là, de questionner, du côté des jeunes filles, ce que l'on y associait et que je voyais dans ses yeux avec autant de paillettes d'éclats de rêve. Qu'y avait-il derrière tout ça ?
Et en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait quand son enfant est passionné par un rêve ? Pour moi, un rêve, c'est une illusion quelque part. On se projette dans quelque chose sans savoir ce que cela représente.
On parle en fait aux jeunes filles en se parlant à soi de choses qui sont vraies, de l'aspect humain, c'est-à-dire l'aspect transgénérationnel où chaque être humain peut se retrouver dans une histoire d’amour, dans un personnage qui a des rêves. Il faut parler des choses de manière universelle pour que les gens puissent s’y retrouver.
.jpg)
© Dargaud
Le monde de la danse ne serait-il pas plus cruel et dangereux que la région infestée de Green Class ?
Il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles. Il y a très peu d'élues. Le milieu de la danse professionnelle est un milieu très dur, comme tous les milieux où les gens font des sacrifices pour y arriver. Avoir des rêves, c’est beau, mais ce n’est peut-être pas toujours l’idéal de les réaliser. Le rêve étant une projection, une illusion, lorsque l’illusion devient réalité, qu’est-ce ? Les jeunes filles qui rêvent de devenir danseuses en auraient-elles toujours envie si elles s’apercevaient des réalités du métier ?
J’ai passé beaucoup de temps à l’école de danse de l’opéra de Paris pour rencontrer ces jeunes danseurs, voir leurs vies, leurs parcours.
.jpg)
© Dargaud
Ambiance conte Steampunk avec Dreams Factory. C’est un peu comme si Jules Verne pénétrait dans l’univers d’Andersen ou vice versa. En 2019, peut-on écrire de nouveaux contes traditionnels ?
C’est la question qu’on s’est posée. À la base, on a voulu partir d’Hansel et Gretel. A l'époque, quand des familles ne pouvaient plus nourrir leur progéniture, il y avait des enfants qu’on abandonnait, qu’on plaçait, des enfants à qui on disait qu’il était maintenant temps de voler de leurs propres ailes. Toutes ces histoires où les enfants se retrouvaient seuls abandonnés étaient des récits qui pouvaient leur parler parce que c’était dans l'air du temps, ça parlait de quelque chose de réel. Aujourd'hui, clairement, ce genre de récit n'a pas de résonance, sauf si on veut aller voir en profondeur. J'ai l'impression que ça parle moins aux enfants. J'ai voulu voir comment on pouvait transposer ces contes aujourd'hui.
Il y avait deux thématiques qui s’opposent complètement. La première est la société de consommation : les enfants sont des consommateurs. Le fondement même de notre société repose sur la consommation. On y prend du plaisir, mais de façon souvent passive. La deuxième thématique est le fait qu’à l'autre bout du monde, il y a des enfants qui participent à ça. Le travail des enfants a quelque chose de commun. Des gamins vont passer leur jeunesse à trimer dans des mauvaises conditions, à devoir travailler pour que leurs familles survivent, pour survivre eux-mêmes. C'est un système de vases communicants. Des enfants vont donner leur jeunesse pour que d'autres aient des paillettes dans les yeux en consommant les jouets qu’ils ont fabriqués.
J’ai voulu parler du travail des enfants. Dans notre société, dans les fermes, ils travaillaient il n’y a pas si longtemps que ça. Mon histoire n’est pas une critique de ces systèmes-là, ni de leurs parents qui les laissent travailler. C’est un constat.
J’ai aussi souhaité revisiter l’archétype de la sorcière, avec le personnage de Cathleen Sachs qui a certains côtés de la sorcière classique mais avec un enrobage assez lisse, un charisme que l’on met en avant dans notre société, où avec des beaux sourires et des belles manières on arrive à faire des choses assez horribles.
.jpg)
© Soleil
Dreams Factory est prévu pour être un diptyque. Pourquoi l’album n’a-t-il pas été publié sous forme de one shot ?
Non, on a toujours voulu en faire un diptyque. On s’est donné les moyens d'écrire une histoire et de pouvoir la raconter bien, dans un laps de temps donné. Le dessinateur ne voulait pas avoir l’impression de s’investir pendant trop d’années dans un projet. On l’a conçue comme un diptyque en fonction de ça aussi.
.jpg)
© Soleil
Quelles sont les nouveautés signées Hamon qui sont en préparation ?
Je souhaite vraiment m'investir dans la suite de Green class, bien développer les personnages sur le long terme. Pareil pour Emma et Capucine dont j'ai vraiment envie de développer l'univers. J'ai aussi la suite de Dreams Factory, avec Suheb Zako et une histoire sur la thématique du Skateboard, avec Matteo Simonacci. Ensuite, j'ai quelques histoires qui sont en parallèle que j'essaie de monter doucement, mais rien de définitif et concret pour l’instant.
Merci Jérôme.
Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

Une nouvelle génération de scénaristes débarque depuis quelques années sur la planète BD. Entre autres, Carbone, Kid Toussaint ou Thierry Gloris développent des univers divers et variés. Dans ce nouveau souffle, il y a le très prometteur Jérôme Hamon dont la nouvelle série Green Class est un des événements de ce début d’année 2019. BD-Best l’a rencontré pour vous.
Bonjour Jérôme, alors comme ça, on est parti en classe verte quand on était petit et on n’en garde pas que des bons souvenirs ?
Même pas. Je n'en ai que des bons souvenirs. C'est plutôt mon cerveau qui a fonctionné en se disant : “ Et si ça s'était mal passé ? “.
Green Class raconte l’histoire de six adolescents canadiens coincés en Louisiane à cause d’un virus mortel transformant les humains en monstres végétaux. Pourquoi la Louisiane et pourquoi un « Survival » ?
Les spécificités du lieu nous parlent beaucoup, avec les mangroves entre autres. Mais il y a d'autres raisons que l'on découvrira au tome 2. Quand j'écris des histoires, j'aime bien voyager et sortir de mon quotidien. J'habite en Bretagne, j'adore la Bretagne, mais j'aurais eu moins cette impression de dépaysement. En la projetant aux États-Unis, c'est une façon de rêver. Si j'arrive à me laisser transporter par l'histoire, il y a des chances que le lecteur aussi.
Chacun des 6 élèves du groupe a un caractère bien déterminé. Noah, infecté par le virus, est un Quasimodo qui essaye de maîtriser sa condition de monstre.
Comme tout le monde, quand on a une attaque extérieure, on essaie de rétablir l'équilibre. Avant de maîtriser quoi que ce soit, il essaye de ne pas souffrir, de rester lui.
Sa sœur Naïa se découvre une âme de leader. Elle va prendre les choses en main et endosser un rôle à la Rick Grimes (The Walking Dead).
Oui. Ce qui nous paraissait intéressant, c'était de ne pas aller vers les personnages trop caricaturaux, trop manichéen, de ne pas tomber dans le cliché. On a essayé de garder un côté hyper réaliste dans les personnages. Quand j'étais adolescent, tous les gamins réagissaient un peu pareil. Si on avait vu un zombie sortir d'un cimetière, on se serait tous barrés en courant. Personne n’aurait osé l'affronter.
Comme dans beaucoup de groupes, il y a les leaders nés et ceux qui le deviennent. On s’est demandé tout au long de l'histoire pourquoi et comment les gens changent, quel impact ça sur eux, et quel impact ça a sur les autres.
.jpg)
© Hamon, Tako – Le Lombard
Linda reste par amour. Mais est-elle pour autant une ingénue ?
Quand on a créé nos personnages, on avait un attachement particulier à chacun d'entre eux. Ils nous étaient tous vraiment chers. Pour certains d'entre, et notamment Linda, on s'est aperçu que les gens à qui on faisait lire la BD, et en particulier nos éditeurs, n'avaient pas la même vision que nous du personnage. Ça m'a choqué. C'est vrai qu'au début c'était la plus caricaturale, un peu précieuse, la fille mignonne, superficielle. Mais nous, on savait qu'on ne voulait pas rester sur cette vision là. Ça nous a fait nous poser beaucoup de questions. Et c'est là qu'on a commencé à faire changer le personnage.
On ne pouvait pas mettre tous les personnages en avant au début. Chaque fois que l'on mettait l'un des personnages en avant, il tirait la couverture à lui. On a dû à chaque fois rééquilibrer les choses en réorientant l’histoire. C'était ainsi que les personnages se sont enrichis les uns les autres, au fur et à mesure des réécritures. C’est ainsi que dans l'une des dernières réécritures Linda a pris les choses en mains. Il fallait qu'elle ait une vraie raison pour le faire.En tant que scénariste, il est toujours intéressant d'avoir cette liberté de pouvoir faire évoluer les choses et de se surprendre soi-même. Il est toujours important de ne jamais se contenter de ce que l'on a.
Sato & Lucas forment le duo Action & Réflexion. Si le premier est un fonceur, l’autre, au QI de 145, est plus cérébral.
Oui. Encore une fois, on a voulu leur donner à tous les deux des caractéristiques communes et leur donner des petites subtilités. L’un est vraiment intellectuel, l'autre est beaucoup plus intuitif. Des raisons vont faire que, à un moment, l’un va foncer plus que l'autre. Il est vraiment intéressant de voir en quoi ils se différencient.
Ça ne l’empêchera pas d’avoir du mal à se justifier dans une scène où ses camarades retrouvent Lucas un fusil dans les mains face à Noah.
Quand on a des personnages qui ne sont pas caricaturaux, il faut trouver un moyen de casser la dynamique du groupe. On s’est demandé ce qui pourrait créer une vraie rupture au sein du groupe et qui reste crédible. Au début de l'album, ils sont vraiment soudés. Ils restent pour aider leur pote. Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné la donne va changer ? Comment va-t-on faire évoluer le groupe qui n'a pas de raison objective de voler en éclats ?
Le plus intéressant n'était pas la rupture du groupe, mais de pousser les personnages dans leurs derniers retranchements, de chercher les raisons intrinsèques pour lesquelles les personnages étaient différents les uns des autres. On a voulu se laisser surprendre par les personnages, créer des personnages les plus riches possible, que le lecteur passe vraiment un bon moment. Pour que eux soient surpris, il fallait que nous on le soit aussi. C'est cela qu'on a cherché à faire en travaillant les personnages, en se demandant comment un personnage d’apparence superficielle comme Linda pouvait prendre les choses en main, ou comment un leader comme Noah peut se retirer.
Beth est plus spectatrice et commentatrice. C’est peut-être celle du groupe à qui le lecteur peut le plus s’assimiler.
Au début de l'histoire, Beth est celle qui paraît la plus ordinaire. Je me sens proche de ce personnage là. On se demande ce qu'on ferait à sa place.
.jpg)
© Hamon, Tako – Le Lombard
Graphiquement, on peut supposer qu’il y a eu plusieurs versions des infectés ayant muté. A quel moment, avec Tako, vous êtes-vous dit : « Là, on y est. On tient leur apparence. » ?
David a rapidement trouvé leur apparence. On le voit dans le cahier graphique en fin d'album. Une des premières recherches qu'il a faite sur les infectés a été la bonne. Quand on a commencé à aller un peu en profondeur dans l'histoire, comment notre histoire se différencie des autres histoires de zombies classique, on est assez rapidement arrivé à cet aspect végétal des choses.
Il y a dans l’album une ellipse de 34 jours. Est-ce que des choses importantes que l’on apprendra par flash-backs se sont passés pendant cette période.
Oui bien sûr. En tant que scénariste, des périodes m'intéressent vraiment, d'autres m'intéressent moins. Plutôt que de diluer les scènes, on a préféré insister sur des moments clés. On a voulu présenter assez rapidement au lecteur une situation figée. On a voulu présenter aux lecteurs un récit assez frais, où ils se sentent surpris. On n'a pas voulu faire comme dans Walking Dead où la pandémie est un postulat de départ.
Au départ, on présente le groupe. Puis, on voit comment la situation dégénère. On a cherché le traitement le plus réaliste possible d'une situation de pandémie.
Dans un univers à la Walking dead, ce qui intéresse les créateurs c'est de présenter les zombies tout de suite. Dans un autre type de récit, l'important n'est pas le zombie en soi mais la contagion, comment elle se répand dans le monde. Les infectés sont juste des gens qui meurent. On a voulu se positionner entre les deux, décrire de façon réaliste comment une sorte de zombie arriverait sur Terre.
La dernière scène est digne d’un grand blockbuster hollywoodien. As-tu conçu ton scénario comme un film ?
Oui. J'aime bien construire chaque tome de mes histoires comme étant une histoire à part entière, avec un début, une fin, et une succession de complications qui font l'histoire.
Le cliffhanger final laisse augurer d’un deuxième épisode dans lequel nos héros seront au cœur du danger.
Dans le tome 1, on a voulu plonger les lecteurs dans la même situation que les protagonistes qui découvrent la pandémie. Quand le tome 2 démarre, la pandémie est installée depuis une quarantaine de jours. Ça va être une autre paire de manches.
.jpg)
© Hamon, Tako – Le Lombard
Comme dans tout « survival », le récit n’est qu’un prétexte à l’analyse des rapports humains. Au fond, on n’est pas loin d’une histoire romantique.
Je suis quelqu'un de très nostalgique. David aussi. Nous sommes dans une histoire où l'humanité est très importante. Nous ne voulions pas d'un récit d'action caricatural. Ce qui nous intéressait, c'était de mettre en avant des personnages et de les faire vivre.
La zone infectée se trouve barricadée par un mur infranchissable. Inévitablement, on pense à Donald Trump. As-tu voulu inscrire délibérément ton récit dans l’Amérique de Trump ?
Oui. Lorsque nous avons eu l'idée de murer les zones, notre éditeur nous a suggéré de rendre cela crédible. Et nous avons implanté notre récit là-dedans.
Evidemment, on a envie de ranger Green Class dans sa bibliothèque à côté de « Seuls ». Cette série fait-elle partie de tes influences ?
Oui, elle fait partie de nos influences, et notamment pour s'en éloigner. En tant qu'auteur, j'ai envie de raconter des choses, mais je n'ai pas envie de raconter des choses qui ont été déjà faites. Évidemment, la série “Seuls” a été une de nos références dans le genre, et nous avons essayé de nous en démarquer. Une fois que nous avons choisi notre thématique et notre univers, nous nous sommes demandés ce qui existait déjà, quelles pourraient être les références du lecteur. On a alors essayé de le surprendre en cherchant ce qu'on avait de nouveau à raconter dans le thème.
Côté littérature, cinéma et télévision, quelles ont été tes sources ?
On a plutôt cherché nos sources en termes de narration et d'écriture. Depuis quelques années, les formes de narration des séries télévisées ont énormément évolué. On a voulu s'inspirer de cela.On a cherché à créer un récit intimiste de grande ampleur avec des moyens de blockbuster. On a voulu rester à une petite échelle, et ne pas lorgner vers les Marvel. On voulait que les lecteurs vivent l'histoire à côté des personnages. On s'est intéressé à la structure du récit, la façon de présenter les choses, de faire évoluer les personnages.
Quand les séries télévisées sont redevenues à la mode, j'étais un peu réticent sur le fait qu'il soit intéressant de suivre des personnages pendant plusieurs saisons et des dizaines d'épisodes. C'est colossal. Mais à partir du moment où les situations sont bien exploitées, ce genre de narration est naturel. On a voulu s'autoriser à faire ça avec Green Class.
Une fois qu'on s’habitue aux séries télés, lorsque l'on regarde un film, on a l'impression de rester sur sa faim.
Lorsque l'on regarde en film l'adaptation d'un livre que l'on a lu, on est déçu, parce qu'au cinéma on est obligé d'être très elliptique.
Les séries permettent de retrouver les bases des histoires, des espaces d'expression assez grands sur lesquels en tant que créateurs on à la place de raconter des choses, comme au temps des feuilletonistes dans les journaux à la fin du 19e siècle.
Aujourd'hui, raconter une histoire en trois tomes est un peu frustrant. Je l'ai fait, mais lorsque l'on développe un univers, c’est (synonyme de frustrant).
.jpg)
© Hamon, Tako – Le Lombard
Il y aurait même un côté enfants perdus de Peter Pan dans Green Class.
Il y a un peu de ça.
On a voulu se laisser happer par ce milieu dans lequel on a grandi sans cacher nos influences. En tant que scénariste, j'ai envie d’écrire des histoires que j'aimerais lire en tant que lecteur.
La couverture et la maquette sont exceptionnelles. Peux-tu nous en raconter la genèse ?
À la base, David s'était lancé dans l'aventure Inktober (mois d’octobre où chaque participant publie un dessin par jour sur Instagram). Il avait développé la panoplie de personnages de Green Class que l'on connaît. À ce moment-là, il avait déjà imaginé cette idée de couverture avec ce crâne et les personnages. Avec le temps, on s’en est lassé. Elle avait perdu son côté novateur. L'éditeur a demandé à David d'essayer autre chose. Il en a fait une autre très réussie mais qui parlait moins que la précédente. David a donc repris le visuel la première couverture. Pour le vernis sélectif et la texture de la couverture, c'est Rébekah Paulovich du Lombard qui a travaillé dessus. Elle a fait un boulot de dingue. Elle a réalisé une maquette incroyable. .
Pour le premier album d’une série, « Pandémie » est long et dense. 64 planches, c’est une générosité assez rare de la part d’un éditeur.
L'éditeur Gautier Van Meerbeeck nous a toujours suivi. Il a fait ce qu'il fallait pour la qualité de la série. On s'est aperçu que l'histoire que l'on voulait raconter dans le premier tome était très dense. On est passé de 46 à 57 planches, puis on a trouvé dommage de ne pas avoir quelques pages de plus encore. On a essayé de trouver des solutions. Puis l'éditeur nous a suivi, pour que le lecteur soit embarqué dans l'histoire.
Le découpage est dynamique. Il n’y a pas de longueur. Le lecteur a de quoi lire. Bien qu’en étant graphiquement éloigné, « Green Class » est la définition du manga adapté au format franco-belge.
C'est exactement ça. On ne se cache pas de l'influence que le manga a eu sur nous. On a voulu raconter une histoire un peu à la façon dont les mangakas écrivent les leurs. Green Class est un hybride. Dans le nombre de pages, on est plus proche du franco-belge. Du point de vue de l'histoire, on a voulu un côté intimiste comme il y a plus souvent dans les mangas que dans les BD de chez nous. On a voulu passer du temps avec nos personnages, rester proche d'eux. On n'a pas voulu écourter les scènes d'actions. On a voulu que les lecteurs vivent l'aventure à côté de nos protagonistes.
.jpg)
© Hamon, Tako – Le Lombard
Pourtant le trait de David serait plus proche du Comics.
On est à la confluence des trois genres. Mais ça n'a jamais été une volonté de notre part. On a pris ce qu'il y avait de meilleur dans nos lectures et nos sources. Quelqu'un comme Sean Murphy dans le Comics dont on admire le travail a apporté sa pierre à l'édifice. Quand on arrive derrière lui ou Urasawa dans le manga, on ne peut pas faire comme si on n’avait pas eu ces influences, comme si on n'avait pas été marqués par ces lectures.
Est-ce que par conséquent vous allez nous proposer un rythme de parution rapide ?
Pour l'instant, on se lance sur un album par an. Le deuxième album fera 54 planches. On voudrait bien aller plus vite mais cela impliquerait une organisation complètement différente.
A suivre dans la deuxième partie de l’interview sur les autres travaux de Jérôme.
Laurent Lafourcade

Hommage Collateral est, comme son titre l'indique déjà, un recueil d'hommages, de parodies et de pastiches réalisé avec un profond respect des personnages originaux Natacha et Rubine. Voici donc la deuxième partie de l'interview consacrée à François Walthery s'attardant quelques-peu sur le sujet.
Bonjour François, Natacha est revenue avec brio, prouvant à quel point les lecteurs aiment toujours autant ce personnage. Tellement qu'on retrouve votre hôtesse de l'air dans beaucoup d'objets dérivés mais aussi des parodies. Aujourd'hui, c'est à travers des fausses-couvertures que vos complices Gilson et Dragan de Lazare repoussent les frontières de genres. Pour emmener Natacha dans diverses aventures qu'elle n'a jamais connue.
C’est exact. Mais ils sont plusieurs. Il y a aussi Daniel Kox et Louis-Michel Carpentier. Le projet a été initié par Dragan de Lazare. J'en ai vu quelques-unes qui m'ont fait beaucoup rire. Le projet est le leur. Il s'agit de parodies et hommages, c'est bien marqué. L'album doit sortir fin mars.
Et puis, des dessins à deux pour rigoler, on en fait toujours. Et pour tout dire, ma collaboration à cet album est très minime, deux ou trois dessins. Dont cette image de Natacha derrière un canon sur un sous-marin. Ils me l'ont subtilisée, celle-là (rires). Pour le reste, je les laisse faire, ils sont plutôt doués. Mais il est important, aux yeux de la loi, que cet album soit bien authentifié comme parodie, comme hommage. J'ai vu quelques-uns de leurs dessins, c'est bien fait, c'est comique. Il ne faut pas jouer en eaux troubles, il faut que l'aspect hommage ou parodie se distingue bien des albums originaux.

Rubine © De Lazare (extrait de l'album Hommage Collateral)
Ça doit faire plaisir d'être parodié de la sorte ?
C’est souriant, c'est marrant. Ils ne sont pas tombés dans le vulgaire.
Aucun doute à avoir ici. Il-y-a-t-il pour autant des limites que vous mettez ?
La parodie, c'est une bonne manière de rigoler avec les personnages. Mais je ne veux pas que ce soit gênant. Pas d'humour pipi-caca. Pas un truc de cul, non plus, encore moins des coucheries entre filles parce que c'est de bon ton. Le cul, l'érotisme, ça a déjà été fait, plutôt bien d'ailleurs. Au temps où c'était une mode. Aujourd'hui, il y a bien d'autres moyens de rigoler. Cela dit, ça me pendait au nez. Comme disait ma mère, si j'avais fait les aventures d'une locomotive, à vapeur je précise, ça ne serait pas arrivé. Mais il y avait aussi un peu de provocation là-dessous. Comme me l'a dit Renaud : Natacha n'a pas fait couler que de l'encre.
On ne voit pas de quoi il pouvait bien parler (rires). Vous apparaissez aussi caricaturé !
Ah oui, si je me moque des autres, je dois me moquer de moi, aussi. J'ai déjà une idée du personnage que j'incarnerai dans le prochain album. Une petite idée de running gag, un gars pas drôle au début mais qui à force de venir emmerder les personnages le devient. Forcément, il sera question de bières.

Parodie et caricature par Gilson pour l'album Hommage Collateral
Natacha et Rubine, deux de vos personnages emblématiques. Vous avez déjà réfléchi à leur donner une aventure commune ?
Ah non ! Ce sont deux univers différents. Quand Le Lombard m'a demandé de leur créer une série - qui allait devenir Rubine -, ça n'avait aucun intérêt de faire une deuxième Natacha. J'ai trouvé le moyen de m'en éloigner en créant cette policière avec Mythic, alias Jean-Claude Smit, et Dragan. Puis Di Sano. Il se remet à faire de la bande dessinée, d'ailleurs, après s'être consacré à la réalisation de cartes postales.
Donc Rubine et Natacha dans un même album, ça n'aurait pas fait sens. Mais rien ne les empêchait de se croiser dans un avion, en guise de clin d’œil, pour la blague.
De ces deux héroïnes, laquelle choisissez-vous ?
Natacha sans hésiter ! C'est à elle que j'ai le plus donné, j'ai fait les décors moi-même, la rythmique.
Pour les albums classiques, les auteurs ont l’habitude de faire beaucoup de tests et croquis pour arriver à la « bonne » couverture qui va attirer le regard.
Je prends énormément de temps à trouver mes couvertures. Impossible d'en créer une en amont de l'album, de l'histoire.
C'est elle qui est centrale. Et, à un moment de l'album, on se dit que telle case, telle ambiance pourrait faire une bonne couverture?
Moi, je n'ai pas d'ordinateur. Je travaille toujours à la plume, à la main, à la gomme. Et au fax !
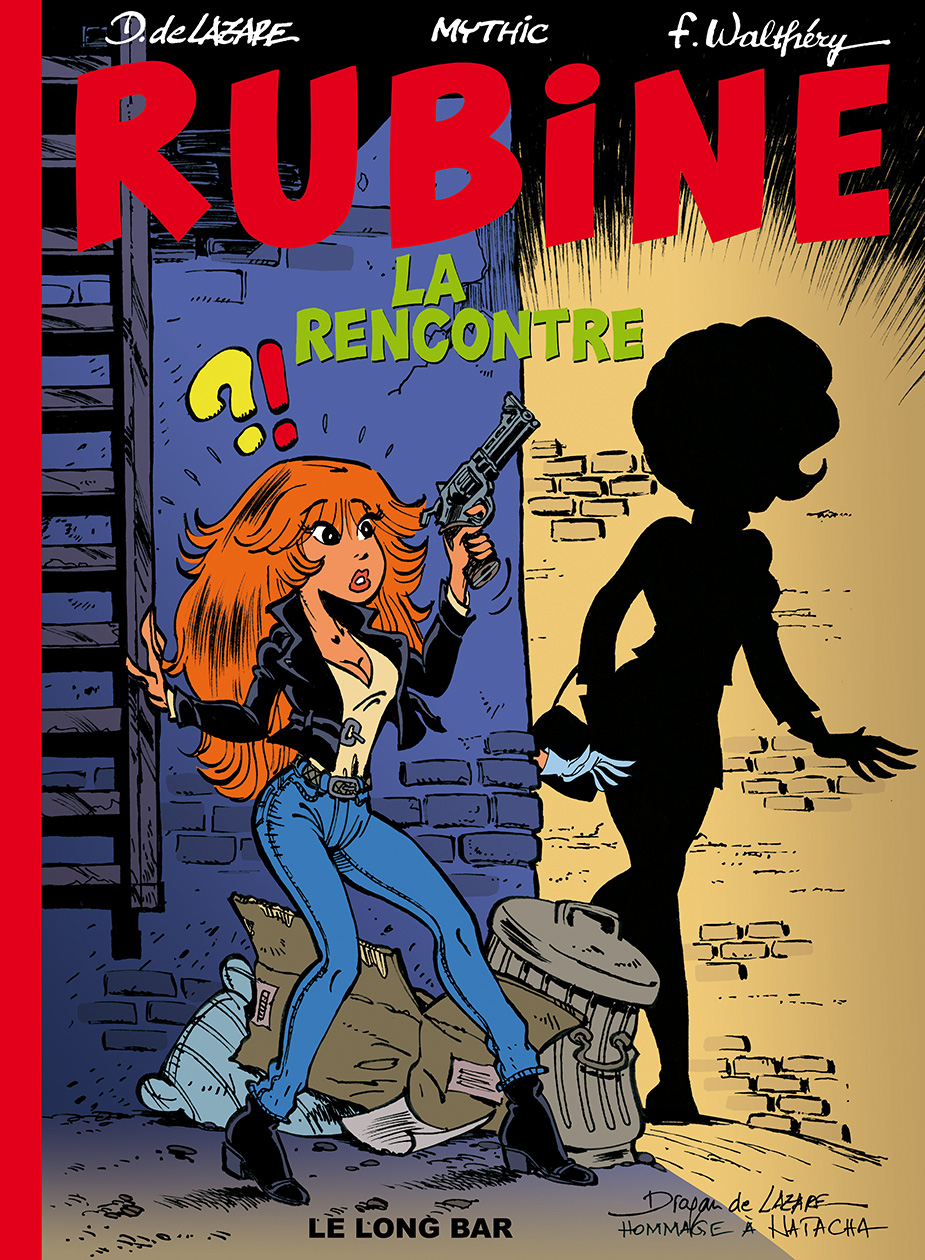
Extrait de l'album Hommage Collateral © De Lazare
Votre couverture préférée ?
Oh, il y en a quelques-unes. Chaque couverture, au moment où je la réalise, est toujours ma préférée.
Qu'est-ce qui fait l'ADN de Natacha? Elle s'est retrouvée dans plein de genres différents, l'aventure, proche de l'horreur ou de la science-fiction.
Oui, mais il ne faut jamais oublié cet invariable : elle est hôtesse de l'air, sa vie se passe dans les avions et il ne faut pas s'en éloigner. Il faut trouver des prétextes pour l'embarquer dans des aventures. Autre que la sempiternelle machine à remonter le temps dont on amuse un peu trop souvent en BD.
En ce moment, je fais quelque chose d'inédit. Toujours en réadaptant Sirius, je compose le troisième et dernier épisode de la saga de l'Épervier Bleu. Je n'avais jamais été plus loin qu'un diptyque. Mine de rien, un album me prend un an et demi de travail, à raison d'une planche tous les trois-quatre jours. Et entre six heures et douze heures par jour. En moyenne, depuis 56 ans. C'est un métier de chien, mais on est privilégié quand on arrive à en vivre.
Natacha a tout du personnage intemporel. Elle ne vieillit pas et a ce côté vintage vers lequel beaucoup aiment se retrouver.
Le journal de Spirou court peut-être un peu trop après la mode. À coups de hashtags, de tweets et de smartphones. Des choses qui, je pense, passeront très vite de mode. Comme mon copain Jannin qui en a été victime. Avec Germain et nous, le temps des walkmans, etc. a été rapidement dépassé. Patatra. Fred a dû arrêter : ce n'était plus ce que les ados de l'époque voulaient trouver dans Spirou, ça ne leur ressemblait pas.
Bien sûr, je ne m'interdis pas d'utiliser un portable mais je ne vais pas en mettre à tous les coins d'images. Ce n'est pas essentiel.
Tintin, aussi, est très intemporel, ça continue à bien fonctionner. Mais force est de constater que c'est compliqué de rendre un héros intemporel. Ou alors, il faut faire du genre, du western par exemple.
Sans suivre les modes, donc ?
Moi pas, en tout cas. Je suis dans le vintage. Il y a peu, on m'a volé mon vieux vélo, un Peugeot, une vieille bécane que j'enfourchais régulièrement pour me déplacer. Je râlais ! Non, je ne cours pas après cette mode qui veut forcer les gens à acheter, à consommer à outrance. Je suis issu d'une époque où tout n'était pas à portée de main. La première fois que j'ai vu la mer, j'avais 21 ans, j'étais parti à Knokke avec Peyo. Bon, je l'ai revue quelques fois depuis.

Sherlock, une des séries préférées de Walthery en ce moment.
Après, j'ai aussi une partie de matériel moderne et je regarde pas mal la télé. Je suis en quête d'émissions intelligentes par la télé des connards, en début de soirée. Parfois, on tombe sur de très bons films. Jamais de série pour moi. Quoique... Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Ils sont arrivés à moderniser tout en restant très fidèle aux récits de Conan Doyle. Puis, il y a eu Six Feet Under, l'histoire de deux croque-morts ! Dans un autre genre, j'adore le Grand Cactus. On me dit qu'il n'y a rien ! Mais si, il y a toujours quelque chose. Il faut chercher. Bon, c'est parfois très tard, je l'accorde. Ça ne me gêne pas, je vis la nuit depuis des années. Une habitude prise avec Peyo. Parce que c'est plus calme. Ainsi, je vais me coucher à 5h du matin.
Mais en BD, si on veut rester un peu, c'est dangereux d'être à la mode. Peyo me l'avait dit.
Vous avez mis un peu plus de temps pour publier votre dernier album, non ?
Non, les planches terminées ont dormi chez Dupuis pendant un an et demi. Ils les avaient oubliées dans une armoire. D'ailleurs, en bas des planches, il est bien indiqué 2016. Ils m'auront tout fait, ceux-là ! (rires)
Y'a-t-il une histoire que vous regrettez de ne pas (encore) avoir fait !
Non, pas de regret. J'ai toujours une histoire de Tillieux dans un tiroir, je la ferai un jour, peut-être. C'est une vieille histoire de Félix, parue dans Héroïc Album. Dans la série des Natacha, il y a eu quelques remakes tout de même: L'ange blond, La mer des rochers... J'avais eu l'accord de Tillieux ou de Peyo pour les faire. Et de sa famille. Franquin m'a un jour raconté certains de ces projets. Il devait avoir la quarantaine et racontait magnifiquement ce qu'il aurait bien aimé faire. Bon, il a eu Spirou, Gaston, certains projets n'ont jamais été concrétisé. C'est comme ça, on ne sait pas tout faire. Tant qu'on ne s'emmerde pas. C'est inhérent, si on n'a pas de projets, un métier pareil, c'est dangereux.

Tirage de tête chez Khani
Gilson, De Lazare reprennent vos personnages. Et vous, un personnage que vous aimeriez reprendre ?
J'en ai déjà fait, des reprises. J'ai repris Benoît Brisefer avec Peyo. Et j'étais sur une liste, parmi une vingtaine d'auteurs, pour reprendre Spirou quand Franquin a voulu passer le flambeau. C'est Fournier qui en a hérité, à sa grande stupéfaction. Franquin m'a barré sur cette liste, il avait vu les premières planches de Natacha et savait que si je reprenais Spirou, je n'aurais jamais le temps de prêter vie à mon hôtesse. Merci saint André ! Bon, j'aurais peut-être pu gagner plus en faisant quelques albums de Spirou. Mais créer mon propre personnage, pour l’ego, c'était mieux. (Il sourit)
Puis, Natacha, c'était mettre une femme au pouvoir ! Ouvrir la voie ?
Ça a permis la féminisation des héros. C'est l'avis des Pissavy-Yvernault et de certains journalistes. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est un hasard. Et si 67-68 était une période de changements, il ne faut pas les voir partout. Moi, je voulais un duo, comme Tif et Tondu, Tintin et Milou. C'est ainsi qu'il y a eu Natacha et Walter. Avant eux, j'avais assisté l'Atelier Peyo, aidé Franquin à la découpe. Je n'ai pas eu que des mauvais profs !
Natacha, je la vois comme un personnage qui revisite l'ancien costume du groom. Son costume d'hôtesse va lui permettre d'avoir un rôle d'ouverture sur le monde, sur l'aventure. Bon, je n'ai pas le même talent que Franquin, il ne faut pas exagérer. Peyo et Tillieux étaient des monstres sacrés et Franquin, encore au-dessus d'eux.
Gilson, De Lazare, ce sont en quelques sortes des héritiers ?
Pourquoi pas ! Ce sont deux bons dessinateurs, il faut qu'ils fassent leurs trucs. Je les aime bien, ce sont des amis.
En parlant des Pissavy-Yvernault, il y a un sacré beau livre - monographie qui sort bientôt !
Une grosse brique, je l'ai vue, ça vaut le coup. Bon, faudra pas la lire au lit, sinon vous allez mourir étouffer !

Extrait de l'album Hommage Collateral © De Lazarre
Et les projets restés sans fin ? Johanna, L'Aviatrice...
Johanna, c'était avec Jean-Claude De La Royère, et c'était pour faire travailler des copains qui n'avaient pas de boulot. Comme George Van Linthout et Bruno Di Sano. Il y a eu quatre tomes. Puis, L'aviatrice aussi est abandonnée, à regret.
Et Rubine ?
On y travaille avec Mythic et Di Sano. On va reprendre la série là où on l'avait laissée. Je ne sais pas où ça paraîtra. Et ils n'ont pas besoin de moi, ils savent y faire.
Propos recueillis par Alexis Seny

Titre : Hommage Collateral
Auteurs : Walthery, De Lazare, Gilson
Auteurs invités : Di Sano, Kox, Carpentier, Bojan Vukic
Nombre de pages : 56 en couleurs
Prix : 20 €
Sortie : le 28 mars 2019
ISBN : 978-2-9600-3939-9

Première partie d'une interview consacrée à François Walthery.
Un beau-livre dédié à l’art de la bande dessinée selon Walthéry et le dernier tome de Natacha paru fin 2018 marquent le retour depuis l'épervier bleu d'un des plus emblématiques auteurs de la maison Dupuis.
Une vie en dessins, ce premier beau-livre dédié à François Walthéry inaugure la collection « Une vie en dessins ». Il présente plus de 200 fac-similés de planches originales scannées et reproduites avec soin.
En vedette, Natacha, mais aussi les Schtroumpfs (Walthéry fut un des premiers collaborateurs de Peyo), Benoît Brisefer, le P’tit Bout d’chique et tous les autres personnages de Walthéry. Le triomphe du dessin via couvertures, séquences légendaires, originaux alternant castagne et mystère et, agrandissements de cases. Parce que Walthéry est devenu un « classique » de la bande dessinée, qu’il a connu tous les « Grands Anciens » et travaillé avec eux, et que son trait, reproduit avec soin, est somptueux. Mais surtout, voici enfin un vrai beau-livre pour mettre en avant le génie de ce baroudeur du dessin. Un nouveau regard sur l’art de Walthery.
La parution de cet imposant recueil de 352 pages et d' "à la poursuite de l'épervier bleu" est l'occasion rêvée en cette première partie d'interview pour notre stakhanoviste de la chronique BD, Laurent Lafourcade (la seconde sera effectuée par Alexis Seny) de partir à la rencontre du maître et de recueillir son regard sur une carrière bien remplie et qui est visiblement loin d'être terminée !
Depuis 2 épisodes, Natacha a effectué son grand retour dans le journal de Spirou. Heureux d’être rentré à la maison ?
Natacha ne l'a jamais vraiment quittée. Marsu Productions était quand même une sous-marque de Dupuis. Mêmes traducteurs, mêmes coloristes, même imprimeur, même distributeur.
L’épervier bleu et sa suite sont l’adaptation d’un scénario de Sirius. Comment cette histoire, déjà dessinée avec d’autres héros dans les années 40, est-elle devenue une aventure de Natacha ?
C'est un excellent scénario. J'étais en vacances chez Max Mayeu, dit Sirius, en 1977 avec Maurice Tillieux. J'avais dit à Max que j'aimerais bien la retransposer. Ça a été assez simple à transformer en scénario de Natacha. Je l'ai réalisé en deux parties au lieu d’une seule car ça aurait fait un album d'une centaine de pages. C'est une aventure qui me plaisait.
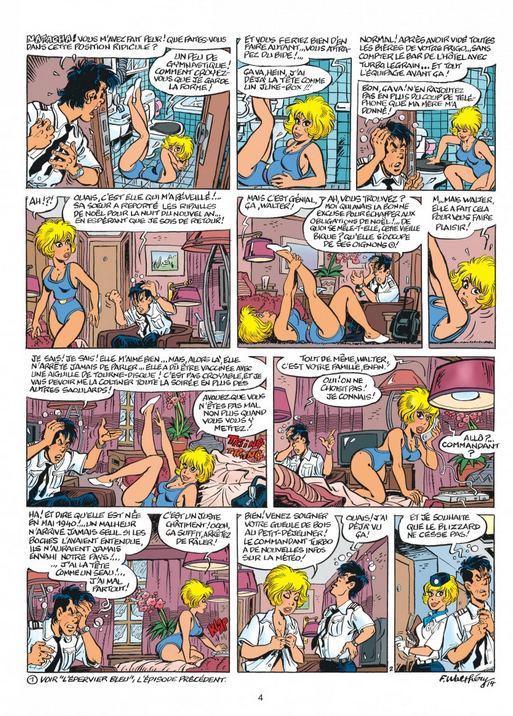
© Sirius - Walthery - Dupuis 2018
Il n'y a actuellement plus de scénariste qui font des aventures. On dirait que ça leur casse les pieds ou que c'est trop long. Ils n’y croient plus, c'est dommage. Une bonne histoire est toujours une bonne histoire. Travailler avec quelqu'un comme Sirius était formidable. Les gens comme lui sont de grands raconteurs d'histoires. Ça manque cruellement dans la bande-dessinée de nos jours.
Les histoires ont tendance à être très “mangatisées”. Ça me déplaît souverainement. Je trouve ça moche. En général, il y a une pauvreté de dialogues. Sirius était un intellectuel qui savait écrire des textes off remarquables. Certains appellent ça désuet, moi j'appelle ça formidablement bien écrit. Les personnages parlaient naturellement et se moquaient d’eux-mêmes. Chez Sirius, l'humour est surtout verbal. Ses personnages étaient très réalistes, mais pour de l'humoristique ça convient très bien.
Tout comme Maurice Tillieux ou Peyo, Sirius était un raconteur d'histoires. Il a fait des choses poétiques, comme Bouldaldar, et des récits à la Mark Twain et Jack London avec L'épervier. Il excellait dans tous les sens. Ces trucs-là m'intéressent plus que tout ce qui se fait maintenant, sur des thèmes comme le football ou des âneries du genre.
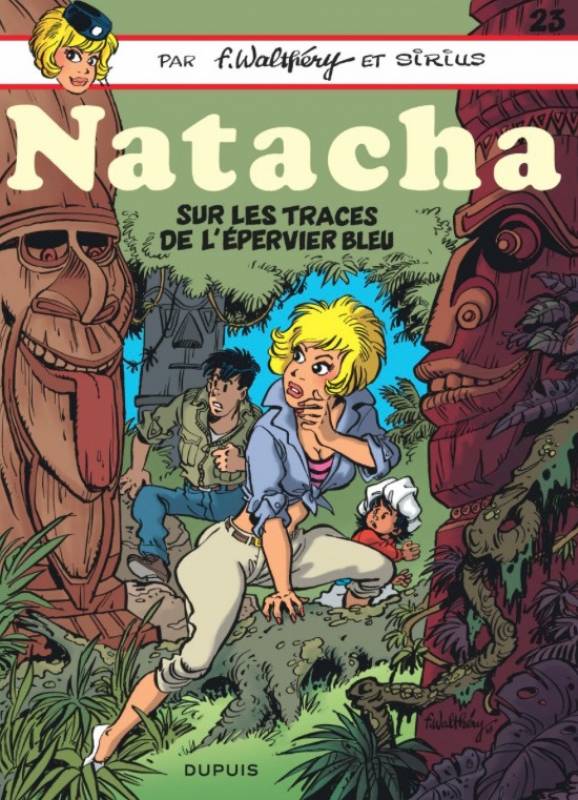
© Sirius - Walthery - Dupuis 2018
Dans la scène d’ouverture, très drôle, Natacha se retrouve dans les couloirs d’un l’hôtel en tenue d’Eve. Une telle séquence aurait-elle été possible il y a quelques années ?
Oui, à condition de faire toutes les cases en noir. Moi, j'ai fait ça dans l'ombre. C'est une grosse blague. On voit ça, mais on ne voit rien. Dans les années 60, c'était plus difficile à cause de la commission de contrôle. Ils ont fait interdire des albums, comme Gil Jourdan. Ils ont fait changer une case dans Billy-the-Kid de Lucky Luke où Billy, dans son berceau, tête un revolver. Cette commission était une commission de censure française.
Les éditeurs étrangers belges, suisses ou autres devaient leur présenter des albums imprimés, édités, finis. Et eux décidaient si l'album passerait ou pas. Pour les éditeurs français, ils leur suffisaient de présenter des maquettes. Ça leur faisait moins d'investissements. Cela s'appelait du protectionnisme, ni plus ni moins. Maintenant, c'est toujours d'application. Mais il y a tellement de productions qu'ils ne savent plus où donner de la tête.
Natacha est une hôtesse de l’air. Pourtant nombreux sont les albums avec un décor maritime. Vous semblez prendre plaisir à dessiner la mer.
Oui, pourtant je ne suis pas un grand amateur. Quand on dessine des bateaux, il y a les vagues, les mouettes. Les oiseaux sont intéressants pour faire des avant-plans.
Il est bon de temps en temps de faire voyager Natacha autrement qu'en avion. Mais j'insiste à chaque début d'histoire sur le fait qu'elle est hôtesse.
Spirou est resté habillé en groom et jamais personne ne s'est étonné que Tintin garde son pantalon de golf.

© Walthery
Ça fait plusieurs albums que la grand-mère de Natacha est l’héroïne de l’histoire (L’hôtesse et Mona Lisa, Le grand pari, Les culottes de fer, Le regard du passé). Avez-vous envisagé un moment donné de lancer une série parallèle ?
Non, parce que ça ne sert à rien. Le système du spin-off m'embête plutôt. On ne sait plus où on en est finalement.
C'est la même série. J'adopte le principe de la machine à remonter le temps. Natacha n'ira pas plus loin. La grand-mère n'a pas vécu en 1840. Je ne ferai pas non plus l'arrière-grand-mère et l'arrière arrière-grand-mère.
Vous avez déclaré à un rédacteur en chef de Spirou : « Je dessine vite mais je travaille lentement. » Rassurez-nous, devrons-nous attendre moins de quatre ans pour le prochain Natacha ?
Si on compte bien, le Natacha actuel a pris 3 ans et 2 mois. Quand je signe les planches, je mets toujours l'année où ça a été fait. J'ai commencé en décembre 2014 et j’'ai terminé en janvier 2018. Je ne travaille pas tout le temps. J'ai fait d'autres albums entre-temps. Il y a eu L'aviatrice avec Di sano par exemple.

© Borgers - Walthery -Di Sano - Paquet
Sur quelques planches ou quelques cases, on pense à Vol 714 pour Sydney. Vous êtes issu de l’école de Marcinelle, mais Hergé fait-il aussi partie de vos influences ?
Bien entendu. Hergé, c’est Dieu le Père de la bande dessinée belge, et même internationale. Tandis que Jijé, comme disait Tibet, c'est notre père. La ligne claire de l'école de Bruxelles, c'est un peu ennuyeux pour ceux qui n'aiment pas faire ça. Je préfère l'école dite de Marcinelle de Jijé, Franquin et tous ces gens-là. Aux studios Hergé, il y a eu des gens comme l'excellent Bob de Moor, Jacques Martin, Roger Leloup, ainsi que Jo-El Azara qui n’est pourtant pas de ce style-là.
Aïcha ressemble à une lointaine cousine du P’tit bout d’chique.
Oui, évidemment c'était pour le plaisir de faire ce moutard avec eux. Dans la version de Sirius, il y avait le petit Sheba avec Éric et Larsen. Mêler un enfant à une histoire est toujours bon. Ça rend plus dramatique certaines séquences. Ici, au lieu d'un petit garçon, j'ai fait une petite fille pour ne pas copier Sirius.
Aïcha a des cheveux un peu plus longs que le p’tit bout d’chique. Habillée comme elle l’est, ça passe. De même, Jane ressemble un peu à Rubine.

© Walthery - Marsu Production
Le P’tit bout d’chique est une série qui pourrait un jour revenir ?
Pour l'instant non, mais il est question d'une intégrale chez Dupuis. Il y a une histoire de 46 planches méconnue dessinée par Mittéï du P’tit bout d’chique en vacances. Il est question de la regrouper avec les deux premiers albums. Mais pour l'instant, les éditions Dupuis ont ralenti le rythme de parution des intégrales. Pour des raisons commerciales, ils privilégient les séries qui se vendent à coup sûr. Mais il est certain qu’il y a une intégrale prévue pour Le p’tit bout d’chique.
Y a-t-il déjà eu des projets de dessins animés ou de séries en live avec Natacha ?
Pas de dessins animés. Il y a eu des options au cinéma. Il y a même des contrats audiovisuels qui ont été signés. Le problème dans cette affaire est qu'il faut du temps pour le faire. Il est hors de question que je participe au casting. Et quand on va sur le terrain des gens du cinéma, on les ennuie.
Neuf adaptations sur dix sont des ratages. On l'a vu ces derniers temps, malheureusement. Une adaptation assez réussie est celle des Taxis rouges de Benoît Brisefer. Gérard Jugnot a porté le projet à bout de bras. À part le début pour la présentation des personnages, quand on suit le film avec l'album sur les genoux, l’histoire est respectée. Le scénario est très vif, mais le film est assez lent parce qu’il n'est pas formaté pour le cinéma. Ils auraient pu l'adapter autrement, mais ils ont été honnêtes et ont suivi le scénario.
Lire un nouveau Natacha, c’est comme lire un nouveau Scrameustache, un nouveau Tuniques Bleues, … C’est une délicieuse madeleine qui revient en bouche. Avez-vous conscience, lors de séances de dédicaces par exemple, de l’effet que vous faites sur les lecteurs maintenant quadras ou quinquas ?
Je vois bien les gens qui aiment ça. Je suis allé cette année à Angoulême dans la bulle du Para BD, pas dans la bulle des professionnels avec des bandes de fous qui se battent pour avoir des dédicaces.
J’ai des lecteurs fidèles que je vois un peu partout. Ils viennent de plusieurs pays. Il y a des allemands, des autrichiens, des français, des belges, ... Ils connaissent tout de mon travail, plus que moi. C'est bien d'avoir un contact avec les gens. On peut parler avec eux pendant les séances de signature. Certains auteurs ne parlent pas en dédicaces, moi j'aime bien faire les deux à la fois. C'est plus amusant.

Photo © L. Meynsbrughen
Quand un nouveau Natacha sort, avec ou sans publicité, comme d’autres séries de l’école belgo-française, il y a un public qui saute dessus. Les libraires l'exposent en vitrine. On a la chance d'avoir une terrible longueur dans le métier, ce que malheureusement beaucoup de débutants n'ont pas. Les fidèles achètent, et parfois quelques nouveaux.
Vous avez eu la chance de bénéficier d'une époque où la presse était reine avant les albums, de travailler dans un journal et se faire la main.
La prépublication est toujours essentielle. Ceux qui lisent les journaux ou les revues n'achètent pas forcément les albums. Mais certains les achètent quand ils sortent après la prépublication, ou pendant, ce qui est maintenant souvent le cas.
Walter est fan de jazz. Walthéry aussi ?
Oui, évidemment. C'est souvent prétexte à discussion. Les fanatiques de jazz sont pointilleux. Ils aiment la musique mais pas les trucs que l'on nous impose à coup de matraquage.
On aime la musique. Point.

Walthery à l'harmonica (photo © Jean-Jacques Procureur)
Pourquoi les couvertures de Natacha et le Maharadjah et Un trône pour Natacha ont-elles été refaites ?
J'ai eu l'occasion de les refaire à l'occasion de leur passage en édition cartonnée.
Dans l'édition brochée de Natacha et le Maharadjah, Natacha était aussi grande que le Maharadjah, alors qu'il représente le danger dans l'histoire. En accord avec l'éditeur et Thierry Martens, lors de la réédition cartonnée, j'ai refait la couverture. Le Maharadjah est toujours aussi grand mais Natacha et Walter sont dessinés en tout petit en train de crever de soif dans le désert. C'était beaucoup plus dramatique avec ce personnage beaucoup plus imposant.
Dans le cas du Trône, j'avais commis l'erreur de faire une couverture qui ressemblait un peu trop à la première avec un fond rouge, classique, où Natacha fait son métier. On devine les personnages principaux derrière mais ce n'est pas très important. Les gens pouvaient penser que c'était le premier qu’ils avaient déjà. Les Danois, eux, avaient agrandi une case où l’on voit un revolver à l'avant-plan. J'ai repris cette couverture et l’ai refaite parce que le dessin était trop petit. À l'époque, on ne pouvait pas faire d'arme sur une couverture. Mais les rééditions ne passaient pas devant la commission de censure.
Que feriez-vous aujourd’hui si un de vos camarades de classe ne vous avait pas prêté ce numéro d’Héroïc Albums où vous avez découvert Félix de Tillieux ?
Sûrement le même métier. Je les aurais vues à droite ou à gauche de toute façon. C'était aux Beaux-Arts de Liège. À l'époque, j'ai racheté pour 8000 francs belges, ce qui n'était rien, l'ensemble de la collection Heroic albums venant d’une bibliothèque publique qui évacuait des collections de journaux.

Maurice Tillieux (© photo d'archives Walthery)
Maintenant, les éditions de l'Élan rééditent très proprement Félix. Ils font un beau travail et publient les 67 épisodes dans l'ordre. C'est une œuvre formidable qui était un peu laissée à l'abandon. Il y a eu plusieurs tentatives de rééditions mais le public ne suivait pas. Présenté par les éditions de l'Élan, ça se vend plutôt bien.
Vous avez travaillé avec une multitude de scénaristes. Est-ce un moyen de ne jamais se lasser ?
Oui, ça pourrait être ça. Mais il y a beaucoup de scénaristes aussi qui ont aimé travailler avec moi. Mon idée était de changer d'ambiance à chaque coup pour ne pas se répéter sans arrêt. J'ai quand même travaillé plusieurs fois avec Tillieux, Mitteï, Gos ou Sirius.
Sans faire de jaloux, y en a-t-il avec qui vous vous êtes senti plus en osmose ?
À peu près tous. Mais s'il fallait en choisir un, ce serait Tillieux. Avec Peyo aussi, c’était du beau travail. C’était un raconteur d’histoires aussi.
Mes scénaristes m'ont apporté des aventures avec des points de vue différents. J'ai toujours adapté mon dessin à l’ambiance du scénario. Avec Cauvin, le scénario était plus comique. Chez Sirius, on s'approche d'une forme de réalisme, mais pas trop quand même. J'ai tendance à faire différemment malgré tout.

Franquin, Walthery & Peyo ( © photo d'archives Walthery)
Comment est né l'album “Mambo à Buenos Aires” avec Renaud ?
Il est fan de Natacha. C'est un grand amateur de BD et de planches originales. On le voyait dans les séances de signatures. Il chantait quelque part et on le voyait abouler avec sa clique. On lui a demandé de venir chanter dessus. Il a accepté.
“Mambo à Buenos Aires” était un conte musical. Une BD avec un disque, ça ne se faisait pas à l'époque. Ni les libraires ni les disquaires ne savaient où le ranger. Mais on s'est bien amusé à le faire.
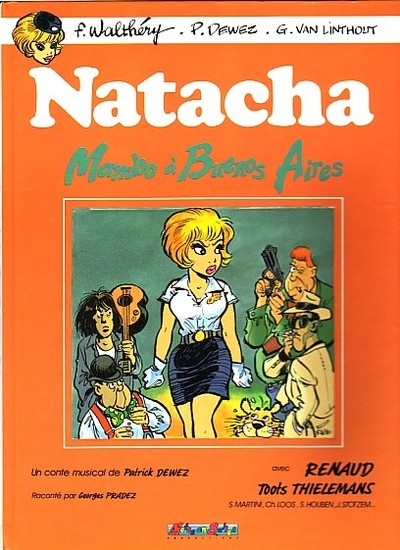
© Notes en Bulles
Il paraît que vous disposez encore dans vos tiroirs d'une troisième grande aventure de l'hôtesse de l'air signée Borgers "African Express".
Comme son nom l'indique, ça se passe en Afrique. C'est un futur scénario probable. C'est un original, ce n'est pas un remake.
Vous avez d'autres cartouches dans vos tiroirs ?
J'ai encore un Tillieux et un double de Dusart aussi. Mais le prochain que je fais est la fin de L'épervier bleu qui est en fait en trois albums. Je suis en train de le mettre en page.
Une monographie intitulée “François Walthéry, une vie en dessins” va paraître en Mars chez Dupuis-Champaka. En quoi cet album va-t-il être différent du Natacha & Co réalisé par Jean-Paul Tibéri en 1987 ?
C'est très différent. Une sélection de planches a été faite par Champaka. C'est un bouquin de près de 400 pages au format Aire Libre. Je vous conseille de ne pas le lire au lit, sinon vous avez mal au bras le lendemain. Ha, ha ! S’il vous tombe dessus, vous avez tout gagné. Ce sont des planches et des dessins chronologiquement classés que je commente, depuis mes débuts jusqu’à nos jours. Ils m'ont fait parler dessus.
Il y a une très belle préface de Christelle et Bertrand Pissavy-Yvernault. Quand je l'ai lue, je les ai appelés pour leur dire que je n'osais plus sortir de mon bureau parce que la porte était trop petite.
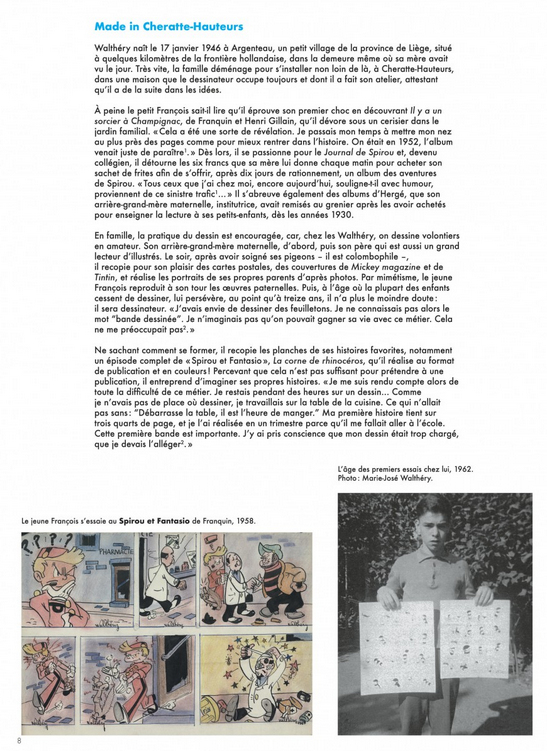
© Walthery - Champaka - Dupuis
Les studios IMPS ont participé également en fournissant beaucoup de matériel de ce que j'avais dessiné chez Peyo sur Benoît Brisefer et les Schtroumpf.
C’est un livre très complet où l’on trouve des extraits de tout ce que j'ai fait.

Photo © Réginald Muller
Merci Monsieur Walthéry.
Propos recueillis par Laurent Lafourcade

Une vie en dessin
Genre : Roman graphique
Collection : CHAMPAKA BRUSSELS
Pages : 384 en couleurs
Prix : 55 €
Dimensions : 235 x 320 mm
Sortie le 15 mars 2019
ISBN: 9782390410041
 |
©BD-Best v3.5 / 2025 |
|
Samedi 5 avril 2025 - 19:15:21
|