
 Flux RSS
Flux RSS

Quand Bruxelles a rayonné au firmament de la modernité mondiale de l’époque, il était déjà là, unissant ses neuf boules comme l’événement fédérait les peuples. Quand Bruxelles est tombée sous les coups haineux et déboussolés de terroristes, on s’en est servi plus que jamais comme d’un symbole, aux côtés du Manneken Pis. Le temps est passé, les décennies aussi, pourtant l’Atomium est toujours bien en place et n’a jamais perdu la boule, imposant et identitaire, même si les plus jeunes ont peut-être oublié ce que ce monstre d’acier représente. Le hasard, la passion et l’envie faisant souvent bien les choses, pile pour l’anniversaire, Patrick Weber et Baudouin Deville font revivre cette époque faste, quand Bruxelles brusselait, dans une oeuvre précise et documentée qui fait aussi figure de thriller d’espionnage bien rodé. Rencontre avec Baudouin Deville, un dessinateur passionné d’une ligne claire et néanmoins atomique. Inoxydable.
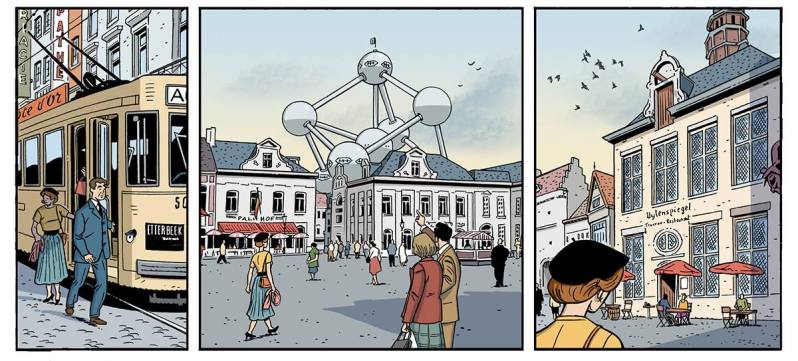
© Weber/Deville chez Anspach
Bonjour Baudouin, c’est un grand coup que vous avez réussi avec Patrick Weber et le nouveau venu dans l’édition (mais pas dans le monde de la BD) Nicolas Anspach : Sourire 58 qui fait revivre l’ambiance de l’exposition universelle bruxelloise de 58. Mais, dites donc, ce n’est pas la première fois que vous utilisez l’Atomium !
C’est vrai, il y avait eu Atomium 58, en 1984, autant dire au siècle passé. La vérité, c’est que monument m’a toujours fasciné. Encore aujourd’hui, quand je passe en dessous, écrasé par cette masse de métal suspendue, je me dis que c’est un bien beau rêve d’architecte.
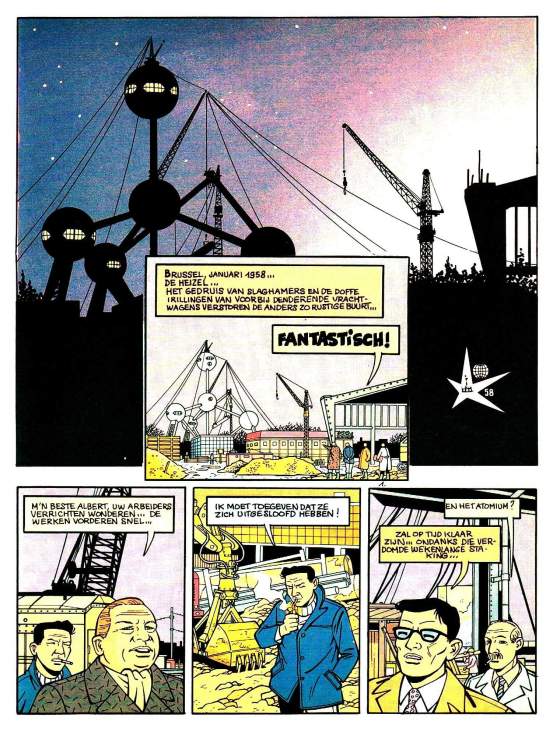
© Baudouin Deville

© Weber/Deville

© Weber/Deville chez Anspach
Si on pousse le jeu des comparaisons entre ces deux albums séparés de 35 ans, il est curieux de constater que tous deux commencent par des planches d’ouverture similaires : les travaux, l’ambiance crasseuse de la création et un goût de mystère, déjà, qui sera exploité de manières très différentes dans les deux histoires.
C’est vrai, je n’avais pas fait le rapprochement, jusqu’ici. En tout cas, je pense qu’il y a quelque part un héritage des films d’époque. Puis, si je suis fasciné par le monument terminé, il en va de même pour la vision, éphémère là, de sa construction. Avec ces câbles agrippés, cette toile d’araignée, ça a de quoi marquer ! Il y a quelque chose d’une atmosphère fantomatique, d’un zeste de science-fiction. Je regrette qu’avec Patrick Weber, on n’ait pas pu évoluer un peu plus au milieu de ces grands travaux.
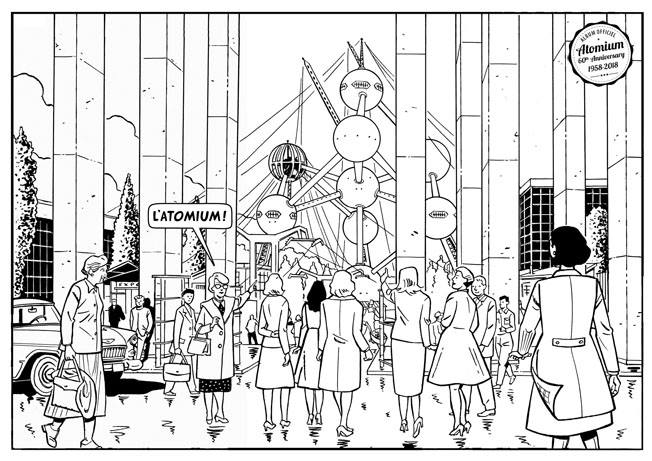
© Weber/Deville
Peut-être une prochaine fois, ne dit-on pas « jamais deux sans trois »?
La construction de l’Atomium fut fascinante. Il suffit de regarder le film n/b qui a été tourné à cette époque. À refaire, je consacrerais au moins un album là-dessus. Avec des ambiances nocturnes et un Atomium en partie construit, sorte de monstre de métal bardé de câbles en tous sens… J’aimerais y revenir, tout n’a pas été dit! Cela peut donner des ambiances terribles! Un polar noir…
Cela dit, l’Atomium ne vous a pas quitté d’une semelle !
En effet, graphiste de formation, cela fait des années que je travaille pour différentes entreprises (du print et du web) avec mon site http://www.traits.be. Un de mes clients est l’Atomium et son équipe m’a demandé de travailler sur une ligne de produits. J’ai dessiné un visuel qui a été appliqué sur une trentaine d’objets. Actuellement, je ne travaille plus pour eux. La collection est terminée.

© Baudouin Deville
Mais, de là est venue l’idée de faire une BD sur le sujet car en travaillant sur ces produits, je me suis rendu compte que, s’il y avait des livres, il manquait un album de bande dessinée s’intéressant à cette époque magique. J’ai mûri cette idée et c’est Nicolas Anspach qui m’a fait rencontrer un historien. En l’occurrence, Patrick Weber. Les discussions ont fait germer l’idée de cette histoire. Il n’y avait plus qu’à… sauf qu’un autre souci a bien vite surgi : l’exploitation de l’image de ce monument. Rien n’est gratuit mais on a trouvé un accord.
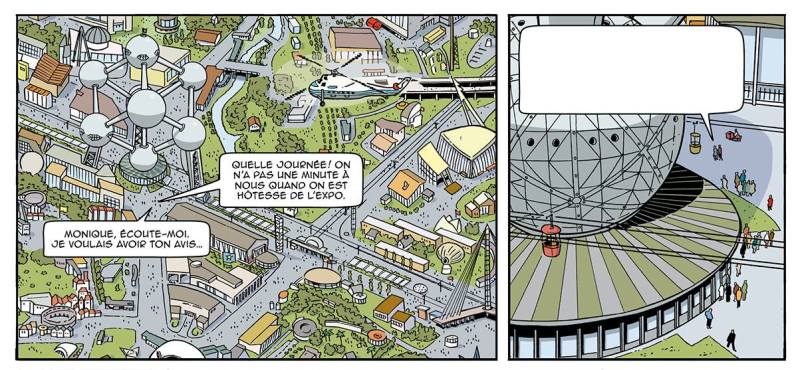
© Weber/Deville chez Anspach
La convention signée, on a pu se mettre au travail tout en mettant au point un plan pour que le bouquin sorte de l’anonymat et réunir les fonds nous permettant de sortir cet album. C’est ainsi que nous sommes partis sur l’idée du crowdfunding sur Sandawe. Et s’il a fallu quinze mois pour financer l’aventure, nous nous sommes rendu compte que l’engouement a été progressif, graduel, et que le budget de 25000€ qu’on espérait réunir a non seulement été financé mais également presque doublé! On a récolté 42 000€. Ça bouillonnait et si un petit tirage à 4000 exemplaires – ce qui n’est déjà pas mal – était envisagé au début, on a réfléchi à une solution pour tirer plus d’albums. C’est ainsi qu’on a mis sur pied une petite structure d’édition : Anspach.

© Weber/Deville chez Anspach
Les éditeurs ayant pignon sur rue n’ont pas répondu présents ?
Ils ont gardé la possibilité dans un coin de leur tête avant de se rendre compte que ça leur coûterait un bras de produire ça. Aujourd’hui, ils s’en mordent les doigts. Mais, comme par hasard, maintenant, ils reviennent à la charge avec plein de propositions. Pas de chance, je ne compte pas la lâcher cette petite structure. J’ai la liberté de choisir et j’en use et en abuse.

© Weber/Deville
Justement, vous nous parlez de l’homme sans qui rien n’aurait été possible, Nicolas Anspach ?
Il est redoutable, c’est le meilleur marketing manager que je connaisse. Pourtant ce n’est pas évident quand on n’a qu’un seul livre à défendre. Plein d’auteurs me contactent, viennent me voir en festival, et sont abasourdis par la petitesse de notre structure. « Comment faites-vous? » Disons qu’on n’est pas nés de la dernière pluie. Patrick est un expert des médias. Et avec Nicolas, comme les Beatles et tant d’autres, on s’est rencontrés au bon moment pour pouvoir réaliser quelque chose de pas mal.

© Weber/Deville chez Anspach
Restait à diffuser l’album, et la petite structure ne pouvait pas tout faire.
À ce moment-là, le noeud du problème n’était plus la création… mais la diffusion de cet album. On y a été au bluff et on a contacté le plus gros diffuseur en matière de BD pour le monde franco-belge : Média Diffusion. Des habitués de « gros projets » qui ont pourtant été convaincus par le nôtre et l’ont accepté.
Une bonne opportunité, quand même, les 60 ans de l’Atomium pointaient à l’horizon. Ils ne pouvaient pas ne pas y penser.
Eux l’avaient peut-être dans un coin de la tête, moi pas, en tout cas. Le projet a été mis en route il y a trois ans, on était encore loin de cet anniversaire célébré. Puis, tout d’un coup, Henri Simons, le directeur de l’ASBL Atomium, a vu le bouquin, a été séduit et a décidé de l’intégrer à la communication officielle de l’Atomium. Un raz-de-marée.

© Weber/Deville chez Anspach
Les astres s’alignaient !

© Weber/Deville chez Anspach
Oui ! Avec le surplus du crowdfunding, nous avons pu produire 12000 exemplaires en première édition. Mais tout restait à faire: il fallait les écouler au risque de se prendre une sacrée déculottée. Mais, chance une nouvelle fois, les libraires indépendants nous ont suivis : ils ne commandaient pas notre livre par 3 ou 4 mais par cent exemplaires, pour certains.
Et la presse, aussi.
Nous avons tenu des conférences de presse et celle-ci s’est emballée, énormément de titres de presse ont parlé du projet, des sites se sont habillés des couleurs de Sourire 58, les interviews se sont enchaînées. Cela dit, on ne s’y attendait pas et, pour une petite structure comme la nôtre, c’est assez épuisant.
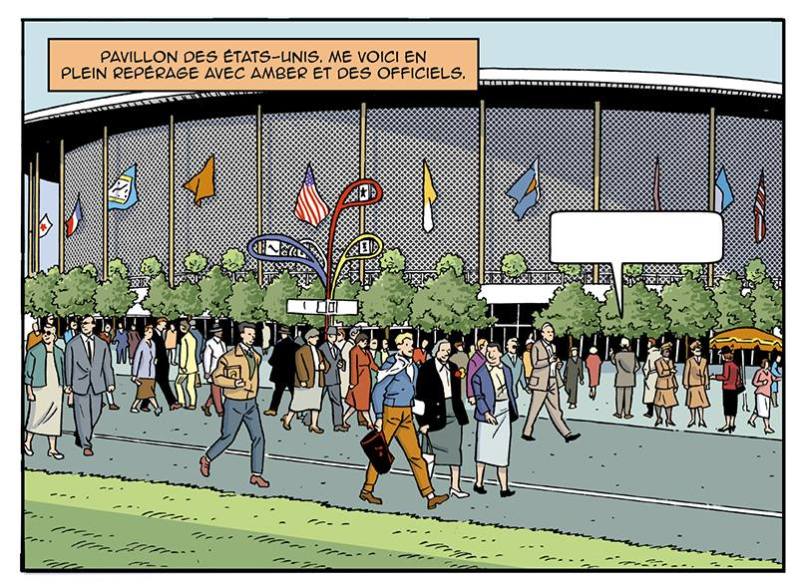
© Weber/Deville chez Anspach
Bref, aujourd’hui, nous sommes toujours au top des ventes, ça marche à fond, une deuxième impression vient d’avoir lieu, après un mois seulement. C’est inespéré. Aussi, une suite est en route, au Congo dans les années 60, ce ne sera pas une suite matérielle, nous avons envie d’aller plus loin.
Avant de parler du Congo, plongeons-nous un peu plus dans cette expo 58.
Comment ne pas être fasciné par cette période, visionnaire, dans un petit pays pourtant de rien du tout. Bruxelles, avant 1958, c’était une ville de province à gros pavés. La perspective de l’exposition 58 en a fait une ville internationale, une capitale. Avec des chamboulements architecturaux à la clé : des tunnels, de voies rapides, de la modernité…

© Weber/Deville chez Anspach
Je suis toujours autant interloqué devant l’audace des gens qui ont pensé et organisé ce qui allait faire office de métamorphose. Quel culot, quand même : la Belgique allait recevoir le monde entier au Heysel. Et quand on dit le monde, ça n’a rien d’une extrapolation : l’Expo Universelle a permis d’accueillir 42 000 000 de visiteurs. C’est fou. Et ça relativise les choses quand, à l’heure actuelle, on n’est même pas capable de mettre en projet un stade national. Les différents niveaux de pouvoir sont incapables de s’associer, de fédérer. Là voilà notre ambition comme si rêver appartenait désormais résolument à une autre époque.
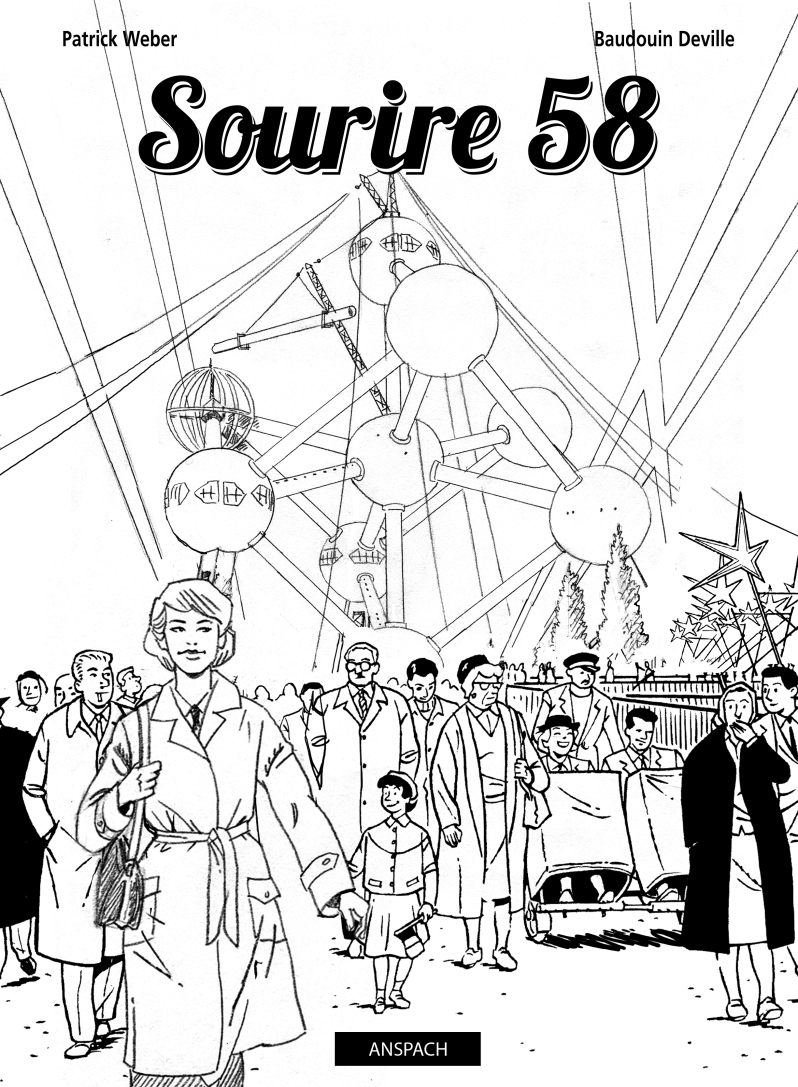
Projet de couverture © Weber/Deville chez Anspach
Alors que tout est possible ?
Rien n’est impossible en tout cas. L’organisation de ce moment historique a développé une formidable énergie. Qui perdure dans sons souvenir. En faisant la promo de cet album, là où je m’attendais à ne rencontrer que des septuagénaires, je me suis rendu compte que cette thématique touchait un public beaucoup plus large : ceux qui ont connu l’époque et en ont des souvenirs vivaces, ceux qui avaient 4 ou 5 ans et n’ont gardé que quelques flashs, les plus vieux qui achètent l’album pour leurs enfants et petits-enfants. Sourire 58, de par sa thématique, dépasse le simple monde de la BD, fait office de carte de visite…
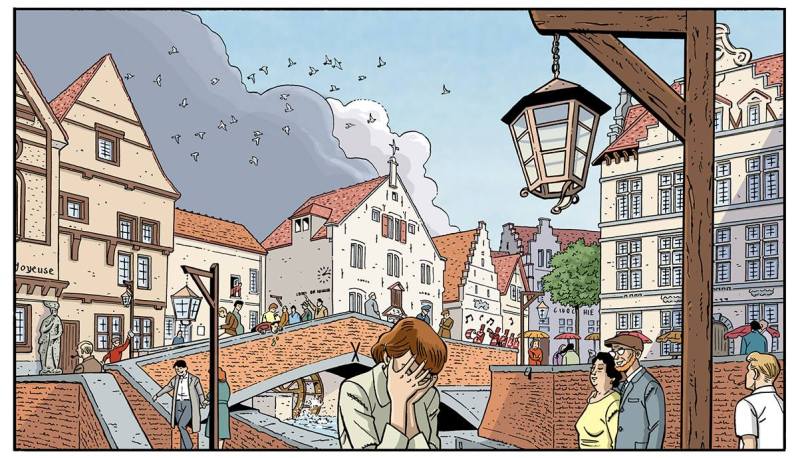
© Weber/Deville chez Anspach
… d’une ville qui a fortement changé, vous l’avez dit, et qu’il a fallu reconstituer.
Bref, trois années de recherches durant lesquelles tout n’a pas toujours été à portée de main malgré la proximité de l’époque investiguée. Mais j’ai pu compter sur des archives et, grâce à des experts, j’ai pu exhumer des trucs qui, sans doute, n’étaient jamais sortis des greniers.

© Weber/Deville chez Anspach
Cela dit, ça n’empêche pas de faire des bêtises, malgré le nombre de relectures consciencieuses avant publication. Par exemple, il y a cette lettre envoyée dans l’album. En entête, j’ai mis 1160 – Bruxelles. Un réflexe naïf. Alors que, bien sûr que non, l’invention du code postal est postérieure à l’Atomium. Voilà qui sera corrigé mais jusqu’ici, personne ne l’a remarqué. Ouf !
Au-delà de ça, j’ai dû redessinner toute la place De Brouckère qui a bien changé – surtout ces derniers temps avec le cafouillage du piétonnier qui devait être apaisant et ne l’est absolument pas. La circulation, le décor, il a fallu oublier l’image du De Brouckère des années 2000.
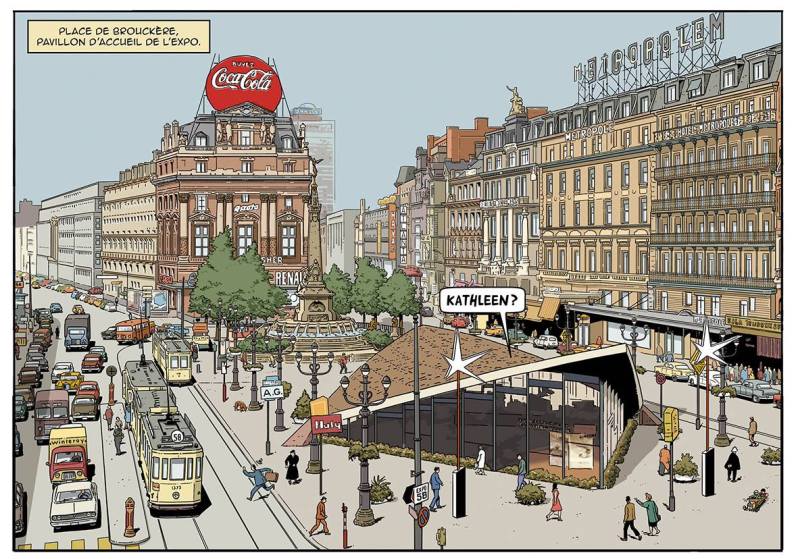
© Weber/Deville chez Anspach
Dans ce retour vers le passé, il allait aussi être question d’engins motorisés de toutes sortes. Mon petit doigt me dit que ce n’était pas pour vous déplaire ?
C’est vrai qu’il y a de tout en matière de véhicules. Des cas, des voitures, des side-cars. C’est un e passion pour moi. Encore plus quand il s’agit de motos anciennes, comme sur mes précédents albums. Avec Jean-Luc Delvaux, lui aussi fondu des mécaniques, on a beaucoup discuté. Il n’y a pas à dire, les voitures d’hier sont bien plus amusantes à dessiner que les bagnoles de maintenant.
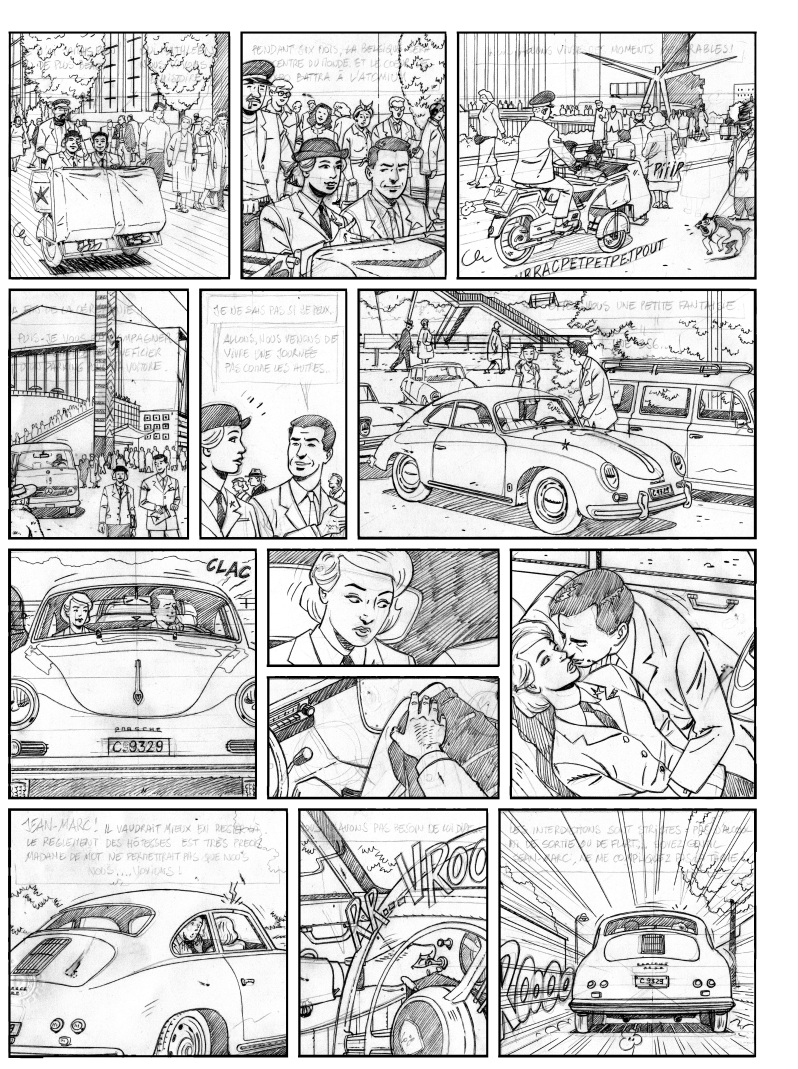
© Weber/Deville chez Anspach
Et ce vol aller vers 1958, c’est via une hôtesse, Kathleen, que vous nous l’offrez.
Une idée de Patrick. On voulait éviter le côté chiant et trouver une petite souris qui nous permettrait de prendre place dans ce rendez-vous mondial. On voulait y entrer par un côté plus singulier. Avec une femme, c’était encore mieux.

© Weber/Deville chez Anspach
Une femme comme héroïne, par les temps qui courent, c’est important, non ? Avez-vous très vite déterminé que le héros de cette histoire serait une héroïne ? Y’a-t-il des femmes du réel ou de fictions qui vous ont inspiré dans sa création ?
La création de l’héroïne est vraiment une idée de Patrick Weber. L’éditeur et moi-même avons tout de suite été enthousiastes. Ce qui paraissait intéressant était de montrer une jeune femme dans les années 50, un peu cruche, très réservée et de la voir progressivement s’affirmer. On sent qu’elle vient d’un milieu protégé, bourgeois sans doute. Le père est absent mais il apparaîtra sûrement plus tard dans la suite. Il est peut-être au Congo (hein, Patrick?). Bref, une héroïne un peu naïve, de son temps. Cela me surprenait un peu au début quand je reçus les premières pages de scénario. Je disais à Patrick : « elle n’est pas un peu trop cruche? » Il me répondait que nous étions en 1958 et que le rôle de la femme, à cette époque, était celui-là et que la conquête de l’égalité des droits homme-femme avait encore du chemin à faire!

© Weber/Deville chez Anspach
Je n’ai pas pensé à une femme précise pour la création de Kathleen. Je me suis inspiré, graphiquement parlant, d’une femme jouant dans une série anglaise « Call the midwife » mais aussi d’autres modèles. Mon éditeur me dit que je me suis inspiré de ma fille, une grande brunette! Bref, un peu de tout.

© Weber/Deville chez Anspach
Et des personnages bien connus des bédéphiles.
Je m’amuse et comme l’exposition accueillait la grande foule, c’était l’occasion de replacer plein de petites choses, des personnages connus ou moins connus que je suis le seul à savoir où ils se trouvent. J’ai toujours fait ça. Ainsi, vous retrouverez dans Sourire 58, l’Inspecteur-chef Kendall de Blake & Mortimer, le Maharadjah de Tintin ou même Patrick Weber. Ça ne dénote pas, ce sont des clins d’oeil.

© Weber/Deville chez Anspach
Beaucoup de personnages de la Ligne claire, la voie que vous avez choisie.
Je sais que je dois améliorer fortement ma ligne claire pour le tome 2. Il n’y a pas de miracle, j’admirais Ted Benoît. Lui prenait cinq ans pour sortir un album. Sans doute le temps nécessaire à approcher la perfection. Moi, j’ai réalisé Atomium 58 en un an et demi. Je dois continuer à développer ça, à passer des paliers, tout en veillant à ce que ça reste amusant.

© Weber/Deville chez Anspach
Puis, il y a la couverture.
Là, j’ai souffert, je dois avoir réalisé 28 projets et en avoir terminé deux ou trois. Jusqu’au jour où Média-Diffusion m’a arrêté net. « Ne touchez plus à rien, on a trouvé ». Ils ont gardé l’idée la plus simple : notre personnage s’avançant avec l’Atomium dans le dos et la belle typographie d’Anne Gérard. Elle a été fabuleuse. Tout comme Bérengère Marquebreucq qui a donné de belles couleurs à cette couverture. J’en suis très content.
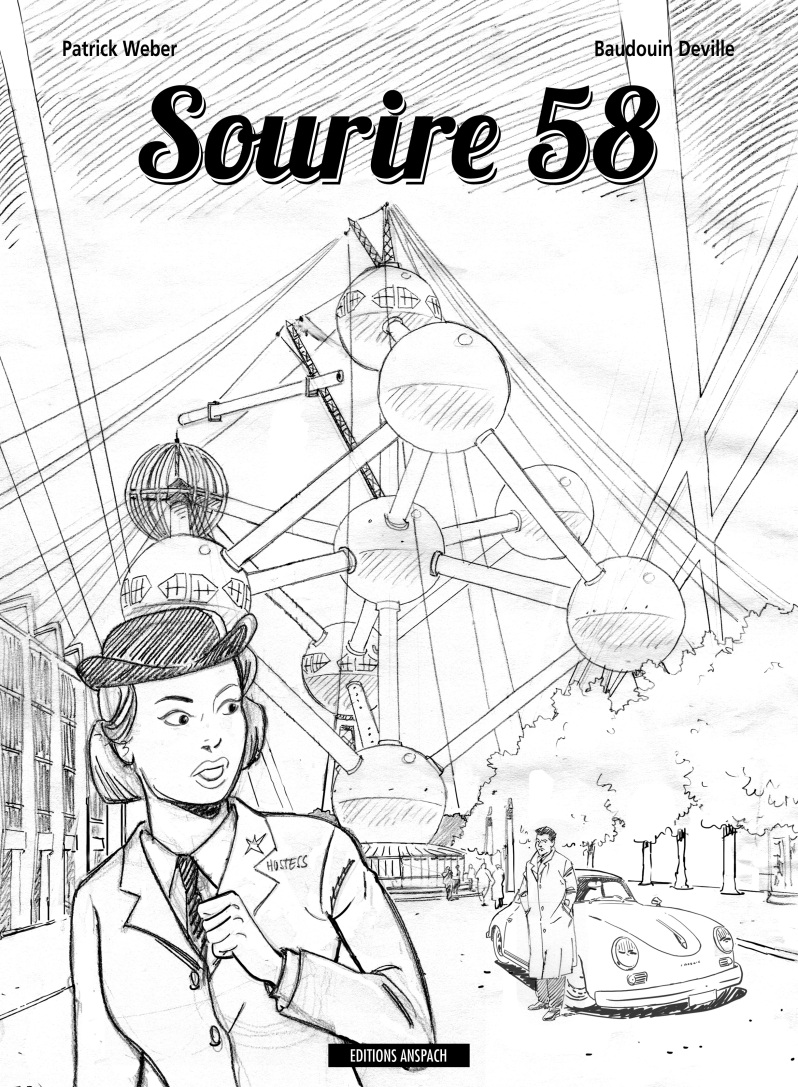
Recherche de couverture © Weber/Deville chez Anspach
On pourrait se dire qu’il manque le son, quand même, non ?
Mais on l’aura peut-être. Une grosse société audiovisuelle est intéressée par l’adaptation de notre album en série télé. Cela nécessiterait d’étendre l’écriture du scénario mais c’est une chouette aventure en coproduction internationale qui pourrait être lancée. On verra.

© Weber/Deville chez Anspach
Ce regain d’intérêt est raccord avec ce retour au vintage si présent dans beaucoup de récits dans des médias très variés comme le steampunk etc.
Dans un monde troublé, je pense qu’on a besoin de se rassurer et on a tendance à chercher dans le passé quelque chose de stable et rassurant. En apparence, bien sûr, car les années 50’s n’étaient pas non plus toutes roses, il y avait la Guerre Froide, les missiles à Cuba. Mais quand on y met la distance, on a tendance à ne voir que le bon côté des choses. Moi, j’aime beaucoup me plonger dans le passé, y implanter mes histoires.

© Weber/Deville chez Anspach
Avec Sourire 58, nous avons mis au point une fiction qui possède ses aspects didactiques, qui permet d’expliquer aux plus jeunes les traces de ce grand événement. Beaucoup de personnes de la tranche d’âge 20-30 ans ne savaient pas ce que ça représentait vraiment l’Atomium. Mais ça reste un symbole inconscient et collectif. Chaque année, 500 000 personnes visitent l’Atomium. C’est dingue parce que quand on est touriste et qu’on va à Bruxelles, l’Atomium est quand même vachement excentré. On pourrait faire l’impasse. Mais ce n’est pas le cas. On revient à cette fascination pour sa grandeur, sa taille, cette réussite du design qui n’a pas d’équivalent et reste gravé.
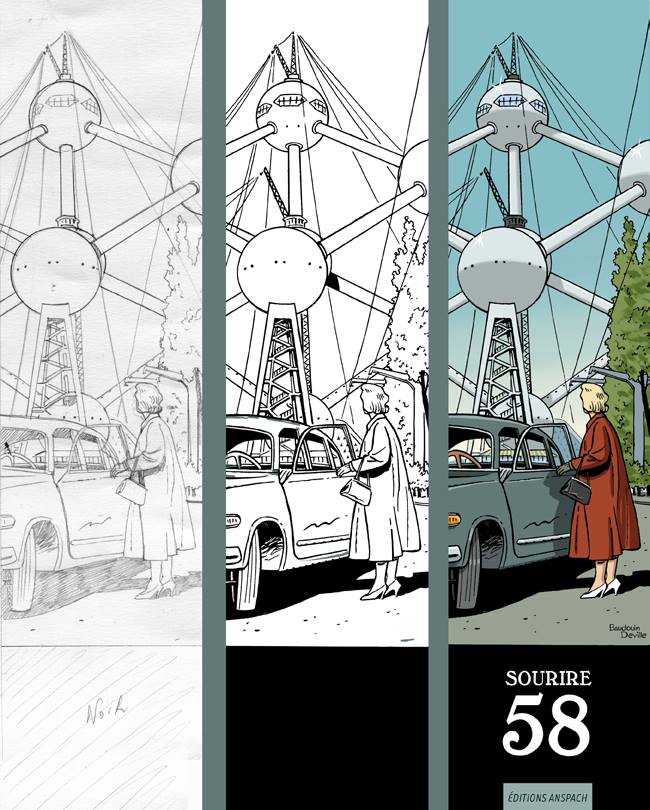
© Weber/Deville chez Anspach
Après, nous, on reste modestes, on est juste contents. Vous savez, il y a beaucoup de gens aigris dans le monde de la BD, la production pléthorique actuelle n’y est pas étrangère. Alors, on se dit qu’on a une chance de pendu. Si le temps m’a permis d’engranger de l’expérience et des acquis, je n’ai pas dessiné le meilleur bouquin du monde mais le résultat me convient.
La suite alors ? Sans spoiler, on peut dire que votre personnage survit à l’Expo universelle et à sa cheffe tyrannique. On va la retrouver au Congo, alors ?
Léopoldville 60. J’ai déjà entamé l’album (2 planches terminées). Kathleen est engagée à la Sabena et assure, entre autres, le service sur des long-courriers à destination de l’Afrique. Sa première vision de l’Afrique est Léopoldville (Kinshasa). Elle n’y arrive vraiment pas au meilleur moment! Les premières échauffourées ont eu lieu, le Congo bouillonne. Elle va être servie, au niveau aventure ! Patrick prépare un redoutable scénario et sa grande connaissance et son point de vue d’historien des événements congolais vont être très intéressants à illustrer. je me réjouis! Et puis cette fine équipe éditeur-auteurs fonctionne bien. Pas de raison de l’arrêter et il faut dire que les bons résultats de Sourire 58 nous encouragent à remettre le couvert. Rebelote, pour se documenter, donc. (Il rit).

© Weber/Deville chez Anspach
Dans la même veine d’espionnage ?
Non, il y aura un côté plus politique, un regard sur la colonisation. Et dieu sait que ce n’est pas simple d’aborder le sujet tant on risque soit de passer pour un néo-colonialiste, soit pour l’inverse. Mais je fais confiance à la justesse et à l’éclairage de Patrick Weber. Sinon, Sourire 58 pourrait bien avoir une édition anglaise. La belle histoire continue ! Sinon, oui j’ai d’autres projets mais il faut trouver du temps pour les faire. Un album de 52 planches comme Sourire 58 me demande un an et demi de travail!

© Weber/Deville chez Anspach
Au boulot, alors, merci de vous être prêté à nos questions !
Propos recueuillis par Alexis Seny
Titre : Sourire 58
Récit complet
Scénario : Patrick Weber (Page Fb)
Dessin et couleurs : Baudouin Deville
Genre : Espionnage, Histoire, Polar
Éditeur : Anspach
Nbre de pages : 52
Prix : 14,50€

S’il tourne aux quatre coins du monde à travers des films, des romans, des bandes dessinées, le courant d’air de l’aventure revient encore et toujours à la charge dans de nouvelles propositions d’ailleurs. Et peut-être encore plus du côté de la jeunesse qui a le vent en poupe et se prête décidément bien à la perte de repères et à la débrouillardise. Seuls, la dernière adaptation de Deux ans de vacances, Le Labyrinthe ou, désormais, Island, nous invite à nous échouer et à retrouver le système D. Interview avec Sébastien Mao, grand orchestrateur de ce retour à la nature sauvage… ou presque.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Bonjour Sébastien, après avoir oeuvré dans la BD plutôt didactique, vous nous emmenez sur une île « déserte », comment l’idée de ce voyage, sans retour ?, vous est-elle venue ?
Cela fait un moment que j’avais envie de faire une histoire d’aventure qui soit la plus surprenante possible en reprenant l’univers des robinsonades et des enfants qui doivent s’organiser. Ma référence ultime étant Sa majesté des mouches. Je ne voulais pas que ce soit cousu de fil blanc, pas une simple île déserte, tout en alliant à cette expérience un côté didactique. Il fallait que les stratagèmes et inventions utilisées par nos héros soient réalisables.
Du coup, dès le début, vous saviez que vous alliez travailler « avec » des enfants, et vous adresser à un public jeunesse ?
Que ce soit enfantin, c’est un choix raccord à des lectures plus personnelles. Sa majesté des mouches, comme je le disais. Après, je ne m’arrête pas à la classe d’âge. J’aime me dire que cet album, j’aurais pu le lire moi-même. Ce n’est pas un groupe d’adulte mais l’ingénuité permet de nous sentir entre rêve et réalité. Avec la possibilité d’avoir peur.
Pour agir sur un groupe, j’imagine que, comme dans un film, il faut un bon casting ?
L’idée est que chaque enfant donne une facette du groupe. Chacun apporte quelque chose, comme Charly et son côté Pierre Richard, l’héroïne qui est très proche de ma meilleure amie. Puis il y a aussi un aspect plus grave amené avec le harcèlement scolaire. Une problématique qui va se vivre loin des bancs de l’école et des réseaux sociaux, en situation de survie.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Et le souffre-douleur de s’affirmer en tant que leader.
Ce n’est pas toujours aussi positif, dans la réalité, malheureusement, mais oui, il va s’imposer dans un domaine dans lequel il ne pensait pas possible d’y arriver.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Cela grâce à son fidèle guide de survie !
Testé et approuvé ! J’en avais un, le guide des Castors Juniors, dans ma jeunesse. Sans doute, une des sources d’inspiration inconsciente de ce récit. À l’époque, je n’avais pas internet. Je m’amusais à refaire tout ce que je voyais à la télé et que je prenais au premier degré. Comme dans les épisodes de MacGyver. Après, j’étais bien évidemment frustré de ne pas y arriver.
À la fin de ce premier tome, vous trouverez une sorte de fac similé de fiches d’un manuel de survie. Avec la possibilité de survivre à 1001 catastrophes. Comme je le disais, je ne voulais pas donner des trucs qui n’étaient pas réalisables. J’ai tout testé… sauf peut-être le combat de crocodile. Mais, faire du feu à l’aide d’une canette de coca et d’une barre de chocolat, ça peut paraître fou mais ça fonctionne.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Finalement, on observe un certain retour à ces récits types robinsonnades où des enfants se retrouvent à devoir agir en groupe dans des univers plus ou moins hostiles. Il y a Seuls, Labyrinthe, l’adaptation de Deux ans de vacances ou encore Les enfants de la résistance dans un autre genre. Il est tentant de faire le parallèle entre ces histoires et nos sociétés dans lesquelles les enfants sont livrés à eux-mêmes, non ?
C’est vrai, pas mal de récits traitent cette idée de survivre sans aide extérieure. Après, je n’ai aucune volonté de distiller un message politique. Moi, je suis enfant unique et quand j’étais petit, j’inventais des histoires, je devais survivre à 1001 choses, dans une nature hostile… un peu en opposition avec le décor de la Creuse où j’ai passé mon enfance. Mais j’y avais trouvé une forêt, et c’est là que je testais mes bricolages.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Concernant mes lectures, si j’ai adoré Seuls, je me suis vraiment inspiré de romans que j’ai pu lire. Je voulais mettre des images, des représentations visuelles sur ce que j’avais pu ressentir à la lecture de ces oeuvres qui avaient fait jouer mon imagination plein tube.
Et justement, les enfants d’aujourd’hui n’ont-ils pas un peu perdu de cette capacité à faire travailler leur imagination, à vivre « sauvagement » ?
En fait, il est important de s’ennuyer quand on est enfant. Ça va paraître vieillot que je dise ça, mais je n’avais pas de DVD, pas de tablette. Parfois, je regardais la tv, les dessins animés de Dorothée mais le reste du temps, je jouais avec des légos, je bricolais, je m’inventais des histoires. Lors des vacances dans La Creuse, je créais des cabanes pour combler l’ennui par du concret, la possibilité de vivre dans la nature. J’ai plus appris que si on avait cherché à m’occuper. Je pense qu’il est important que les enfants se réapprivoisent les objets. C’est non seulement instructif mais ça favorise la créativité.
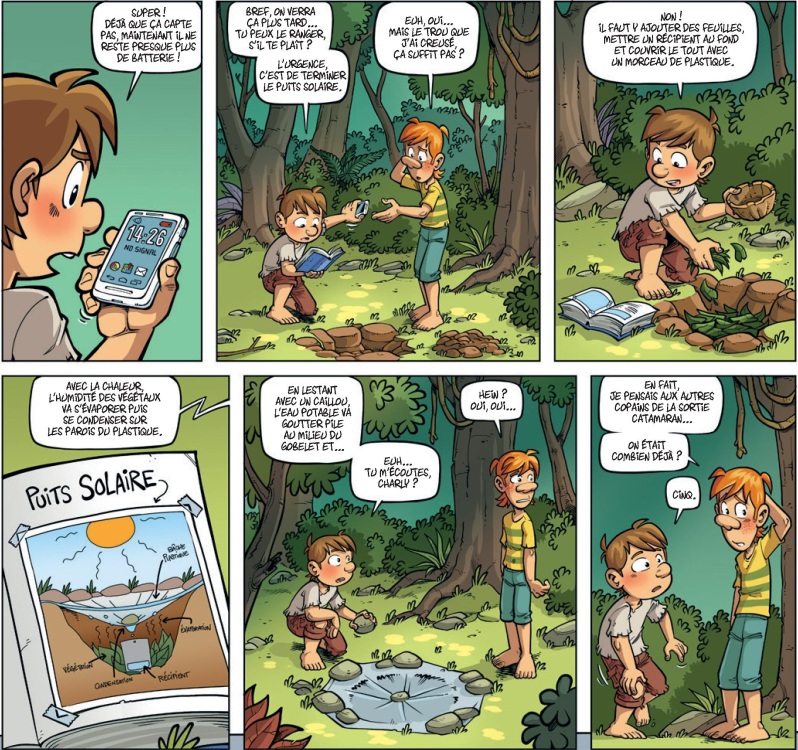
© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Et vous, si vous étiez sur une île déserte, y’aurait-il des choses que vous ne voudriez absolument pas vivre ? Des phobies ?
Je pars du principe que si je m’en sors, c’est déjà très bien. (il réfléchit). Je dois admettre que je ne suis pas fan des insectes. Sinon, j’aime les sports un peu extrêmes, comme le canyoning… même si je me fais vite peur. Au-delà de ça, c’est assez jubilatoire de faire vivre ce genre de situations aux autres !
Et dans ce déroulé catastrophe, c’est un autre comparse que vous vous êtes trouvé, Waltch.
Cela fait plusieurs années que je travaille avec Duvignan. On a tous les deux eu envie de partir sur des projets un peu plus perso. Et ce nouveau couple que je forme avec Waltch a été arrangé par l’éditeur. Un bon choix quand je vois ces scènes de catastrophes et de survie emmenée par le dessin rond de Waltch, franco-belge, plus bonhomme et familier que ce qu’on peut parfois voir. Island, c’est une affaire de contrastes, et le dessin de Pierre permet de basculer vers quelque chose de plus complexe, quelque chose d’agréable à regarder tout en se rendant compte que les épreuves subies par nos héros sont cruelles. Vous le verrez dans le tome 2.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Mais au-delà du duo, c’est un trio bienveillant que nous formons avec Sandrine Cordurié qui a livré un formidable travail sur les ambiances, entre le jour et la nuit, le brouillard. Si le dessin en noir et blanc donnait bien, la couleur apporte tellement une dimension supplémentaire. C’est la première fois que je me rends compte à quel point la couleur impacte un album que je crée.
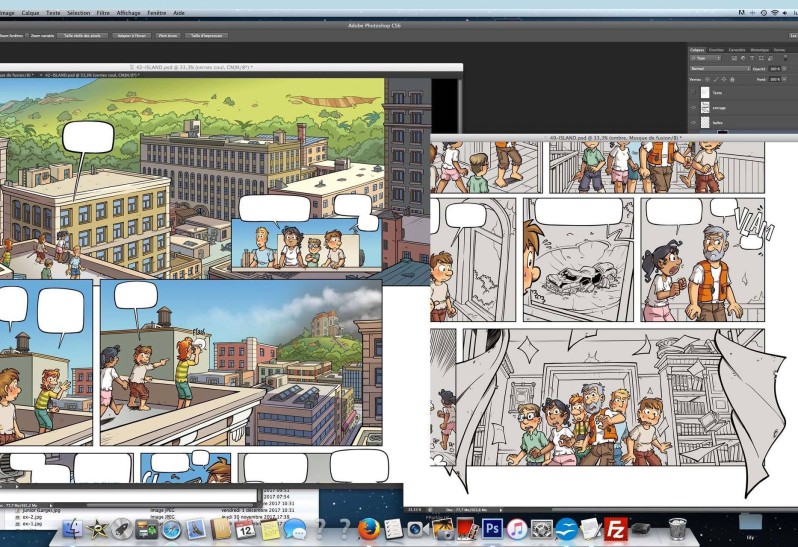
© Mao/Waltch/Cordurié
Il y a quelques années, vous publiiez un guide sur Paris. Mine de rien, toutes proportions gardées, ça doit aider quand on crée un monde dans lequel on doit se repérer… comme cette île déserte.
Pour certains, Paris, c’est une vraie île déserte totalement hostile, une jungle. Si la métaphore n’est pas tout à fait usurpée, ce n’est pas vraiment transposable. Après, si la topographie joue un rôle important et prend de la place dans l’album, le fait d’avoir réalisé ce guide parisien auparavant m’a surtout permis de gérer les distances. Celles-là même qui sont encore plus décuplées pour les enfants. Cela m’a permis de mieux assimiler la gestion des déplacements.

© Mao/Duvignan chez Bamboo
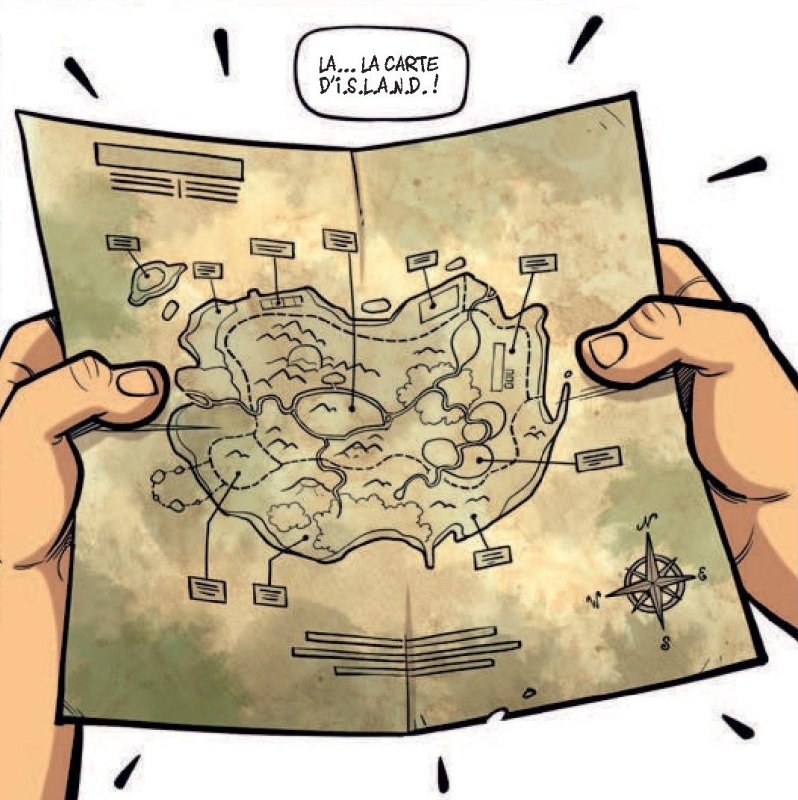
© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Dans ce premier tome, vous nous embarquez directement dans le feu de l’action avec une scène d’ouverture dont le déroulé n’apparaîtra finalement que 30 planches plus loin.
J’aime l’idée d’une scène d’action en ouverture, une scène-clé qui apporte des mystères avant un lot de réponses plus loin. Ça permet de déconstruire, de semer le doute avant d’amener les explications.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Cette envie de plonger directement dans une scène forte avant de reprendre depuis le début, je la dois sans nul doute à ma passion pour les séries. Comme le début d’un épisode de Breaking Bad, on n’a pas le temps de respirer, on y est. C’est le grand huit, ça démarre très fort tout en restant sur les rails, sans créer la frustration même si on reviendra en arrière, qu’il faut perdre pour mieux retrouver. C’est la méthode que j’ai essayé d’appliquer.
Et 62 planches, ça en laisse le temps !
Pour ça, l’éditeur est très respectueux. En écrivant l’histoire, j’ai tâché de faire monter le mystère progressivement… comme la pagination passée de 48 à 50 puis 55 et finalement 62. J’espère que ça tient la route, je ne voulais pas prendre de raccourci et oublier certains passages, rester sur ma faim. J’ai voulu être le plus exigent possible, de développer l’action au maximum.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Votre récit est aussi plein de références, de James Bond à Robinson en passant par le Capitaine Némo.
Toutes les semaines, je vais deux ou trois fois au cinéma, depuis des années. Ça m’a permis de me constituer une banque de souvenirs dans laquelle je peux puiser et me remémorer des sensations. Il y a du Spielberg, Hitchcock ou Shyamalan. On part vers une destination précise pour, au final, se retrouver ailleurs à se demander où on se trouve, dans quel univers. Je voulais rendre hommage à cet art qui crée des souvenirs et, j’en suis sûr, fait évoluer.
Par ailleurs, le cinéma est encore plus présent que cela. Un cinéma fait avec de vrais gens face à des situations surprenantes voire horrifiantes. Le Septième Art a-t-il déjà poussé le concept dans ces extrémités-là ? En mode caméra caché, recherchant la sincérité des émotions.
À ce point, je ne pense pas. J’aime beaucoup Borat ou Brüno malgré leur caractère très violent, homophobe. Je pense que le cinéma recherche toujours la sincérité. Après, je pense tirer plus mon inspiration d’expériences psychosociales. J’ai d’ailleurs repris des études de psychologie, à un moment. Cela permet d’interroger la logique d’un personnage lambda face à une situation difficile.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
Il y a la magie du cinéma et la magie tout court. Comme celle de Gérard Majax que vous remerciez.
C’est devenu un de mes meilleurs amis. Il a bercé mon enfance. Et quand je vois le nombre de personnes qui viennent près de lui lorsque nous déjeunons ensemble, je ne dois pas être le seul. Ce sont les hasards de la vie professionnelle qui nous ont amenés à travailler ensemble (ndlr. sur ENIG’MAJAX, série co-écrite avec le magicien et dessinée par Tase dans les pages d’Enigma). Comme Island était ma BD la plus personnelle et que son univers touchait à la magie, c’était l’occasion rêvée pour le remercier.
Finalement, qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la magie à votre manière, en BD ?
Comme j’étais fils unique, je lisais beaucoup de BD. Toutes les semaines, j’avais Spirou, Mickey… Mais, je me suis rendu compte très tard qu’on pouvait en faire sa vie. J’ai toujours écrit mais j’avais tellement peur de montrer mes manuscrits aux éditeurs. Puis, un jour, j’ai passé le cap. Par chance, je suis tombé sur Bamboo, leur bienveillance, leur humanisme. C’est pour ça que je n’éprouve aucun besoin de leur être infidèle.
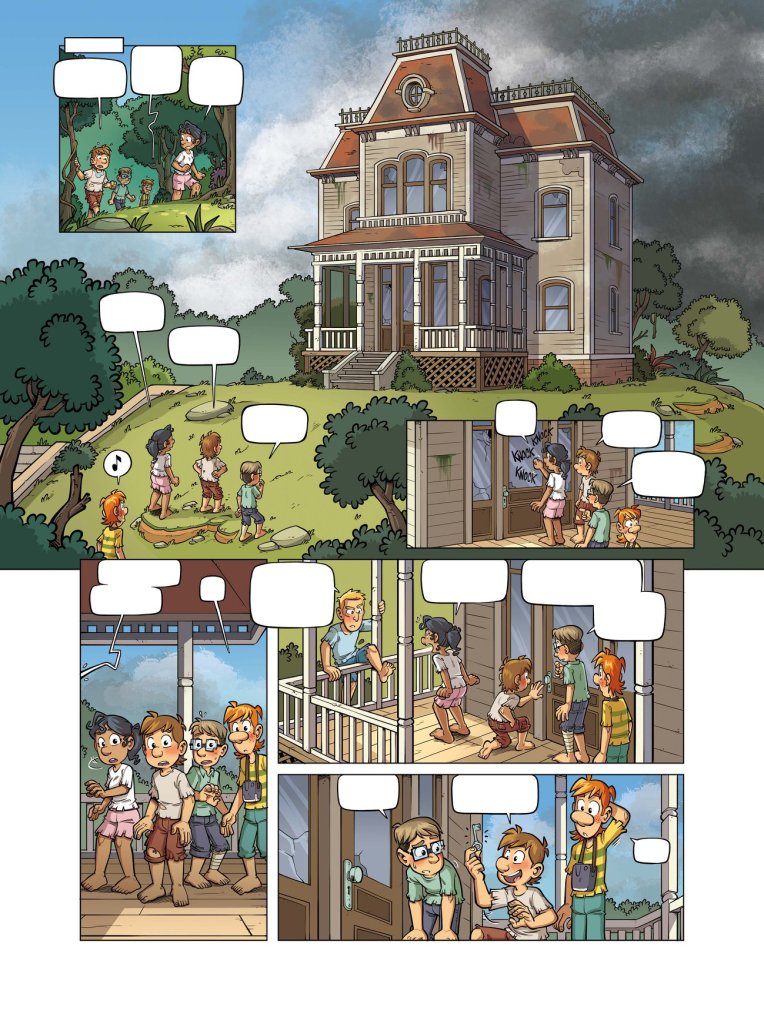
© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo
La suite ?
Je suis à fond sur le tome 2, la première trame est bien avancée. Même si nous donnons déjà beaucoup de réponses à la fin de ce premier album, nous aimerions sortir la suite le plus rapidement possible… tout en ne se précipitant pas. Chaque scène doit être imbriquée pour avancer sans oublier des choses. Le moindre détail, un petit dialogue a son impact. Ce fut le souci sur le tome 1: des petits passages avaient un gros impact et risquaient de créer des incohérences. J’ai donc dû revoir ma copie.
Island pourrait bien s’étendre sur plusieurs cycles, je ne manque pas d’idée. La fin d’un album pouvant être le début de quelque chose d’autre, permettant d’aller plus loin. Il y a un côté complotiste que je voudrais travailler tout en restant sur les rails. Bien sûr, le rêve serait de faire le plus de tomes possible pour développer au maximum cet univers. En réalité, ça dépendra de la manière dont la série est reçue. Mais l’envie est là de faire subir plein de catastrophes à notre équipe.
Après, j’ai d’autres envies. Comme une BD historique sur Paris et ses illuminations. Là encore, il y a un côté magique mais aussi lyrique.
Propos recueuillis par Alexis Seny
Série : Island
Tome : 1 – Deus Ex Machina
Scénario : Mao
Dessin : Waltch (Page Fb)
Couleurs : Sandrine Cordurié (Page Fb)
Genre : Aventure
Éditeur : Bamboo
Nbre de pages : 80
Prix : 14,90€

À ciel ouvert du web depuis quelques années, la Comic Art Factory a trouvé quatre murs, un toit et de belles baies vitrée dans la chaussée de Wavre à Bruxelles. Pour fêter ça, c’est dans l’univers délicat et tellement porteur de Renaud Dillies que cette galerie qui entend faire parler la passion avant le pognon, s’est glissée. Derrière elle, on trouve d’ailleurs un amoureux de la BD, et plus largement des arts et de la culture : Frédéric Lorge. Rencontre.

Renaud Dillies et Frédéric Lorge
Bonjour Frédéric, dans quelques heures, vous ouvrirez les portes de ce nouveau temple de l’original, la Comics Art Factory. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé ?
En 2014, lorsque j’ai pris l’initiative de contacter moi-même des auteurs et illustrateurs, comme Quentin Gréban ou Isabelle Dethan, leur demandant s’ils n’avaient pas envie de vendre quelques oeuvres. Une envie qui me trottait dans la tête depuis un bout de temps. Tout en pensant que ça arriverait plus tard, en 2019 ou 2020. Et ça arrive maintenant. Mais devenir galeriste, ça ne relevait pas d’un but, ni même d’un fantasme. Il fallait que cela arrive en faisant concorder lieu, espace, bail pas trop cher, etc.
Une chose était certaine, je ne voulais pas d’un couloir comme on en voit trop souvent dans les galeries. Du coup, la Comics Art Factory ressemble un peu à un personnage des Îles de paix avec un petit couloir bordé de pièces et avec une mezzanine et des grandes baies vitrées.

En vitrine, non pas des planches, mais des cases !
Je voulais pouvoir proposer en vitrine un agrandissement de l’une ou l’autre case de l’artiste exposé (ici, en l’occurrence, Renaud Dillies). Il m’importait de varier la présentation, d’aller au-delà de cet aspect très « brocante » de l’éternelle planche présentée comme un tableau sur un chevalet. Maintenant, peut-être qu’un jour, j’y reviendrai. Mais j’essaie de jouer avec le côté graphique, d’exploser et explorer la taille d’une case ou d’une succession de cases. Pour le moment, c’est une séquence entre Abélard et Gaston et la deuxième case de la première planche de Saveur Coco.



Bon, à l’intérieur, le visiteur retrouvera les planches exposées de manière plus classique. Dans le futur, je tenterai peut-être des choses plus acrobatiques.
Mais ce goût de la BD, d’où vous vient-il ?
Mon papa m’a appris à lire avec les publications de comics de LUg, les Strange, les Nova. Après, sont venus Lucky Luke, Gaston, le Spirou de Tome et Janry avant les autres. Mais pas les magazines Tintin ou Spirou, je ne supportais pas que ma lecture soit fragmentée.
Ce n’est que bien plus tard que j’ai commencé à collectionner. Des planches américaines, dans un premier temps, puis du Franco-Belge, qui n’était pas plus facile à acheter.
Et sur le plan professionnel ?
J’ai fait des études de communication à l’Ipsma, j’ai fait quelques piges avant de devenir journaliste BD dans Belgique N°1, le Vlan de Charleroi. J’avais accès à un service presse et une totale liberté de m’exprimer entre le manga, les comics, le franco-belge. Sans viser uniquement le populaire. J’ai également fait des interviews BD pour un fanzine, Devor-Rock qui parlait autant de musique que de BD. Pendant une bonne dizaine d’années
J’ai le souvenir mémorable d’une interview surréaliste et croisée de Midam et Darasse à l’époque du Gang Mazda et de la sortie du premier Kid Paddle. Nous l’avions fait dans un café. Et malgré l’heure matinale, on avait eu l’impression que tout le monde était en état d’ébriété. Midam, dès le début, j’ai senti qu’il tenait quelque chose avec Kid Paddle. J’aime ses gags, sa maîtrise de l’absurde, ses strips. C’est l’un des plus grands gagmen de ces vingt dernières années.

Avant de devenir galeriste, parmi vos 1000 vies, vous avez aussi été chanteur, sous le nom de Deauville. Info ou intox ?
Vu les ventes de CD’s, confidentielles, peu de gens sont au courant. (il rit) Là encore, c’était une envie que j’avais depuis longtemps et qui, je le savais, prendrait vie un jour. Pour le coup, ce fut, entre mes 35 et 37 ans. J’ai concrétisé cette envie en chantant mes textes sur mes propres mélodies, en compagnie d’un arrangeur (ndlr. reconnu, quand même, puisqu’il s’agissait de Phil Delire). J’ai vécu cette expérience sincèrement tout en apprenant à être homme-à-tout-faire comme être mon propre attaché de presse . Ça forge le caractère !
Et déjà, sur vos pochettes, le dessin était bien présent !

Oui, si je me doutais que peu d’albums trouveraient acquéreurs, je voulais bien faire les choses. J’ai ainsi fait appel à Isabelle Dethan qui avait signé Le Roi Cyclope et avait emporté les contes et légendes bien loin des stéréotypes avec des couleurs qu’on n’avait pas l’habitude de voir. Mais aussi à Emmanuel Lepage qui est l’un des dessinateurs que j’admire le plus depuis La Terre sans mal. Il arrive tellement à dessiner les corps au naturel, sans les sexualiser. C’est tellement touchant, doux et tendre. J’ai été touché par sa candeur, son empathie. J’ai savouré cette collaboration qui m’a beaucoup touché.
Pour le coup, c’est un autre dessinateur très touchant auquel vous faites la part belle pour l’ouverture de votre galerie : Renaud Dillies. Et c’est la première fois qu’il vend ses originaux.
Notre rencontre remonte à cinq ans, lors de la parution de Saveur Coco. Je vais rarement en séances de dédicaces, mais cette fois-là, je n’ai pas pu m’en empêcher. J’avais envie de discuter avec lui… et de lui acheter une planche. Mais il ne vendait pas.
Du coup, à raison d’un ou deux mails par an, je le relançais. Jusqu’à ce que je le rencontre pour Loup à Angoulême et qu’il accepte enfin. Les étoiles se sont alignées délicatement.

© Renaud Dillies chez Dargaud
Renaud, prouve à chaque page son amour de la narration BD. C’est délicat mais pas m’as-tu-vu. Puis, son travail de lettrage est formidable. Dans Saveur Coco, chaque phylactère commençait par une couleur différente. Très frais. J’aime être surpris et ce que raconte Renaud, ce n’est pas linéaire. Je vais enfin pouvoir lui acheter une planche, je pense à une en particulier.
D’ailleurs, peut-on en savoir un peu plus sur votre collection ?
Une soixantaine de planches, dont une bonne partie se situe sans doute entre 150 et 200€. Il ne faut pas croire que toutes sont à 5000 ou 10 000€.
Le prochain artiste, ce sera Gilbert Shelton.
Je le connaissais très peu. Ses personnages sont de gros consommateurs de cannabis. Moi, je n’ai encore jamais fumé un pétard de ma vie. Donc j’étais totalement passé à côté de ses Freak Brothers. Sauf qu’ils ont un chat, Fat Freddy qui intervient dans des gags. Bien loin d’un Garfield – qui, s’il avait été humain, aurait été un pervers narcissique insupportable -, le chat des Freak Brothers est là, juste peinard, bien sympathique. J’y suis donc revenu avec des yeux neufs. Il y a une sorte de folie douce, de culture de l’absurde.
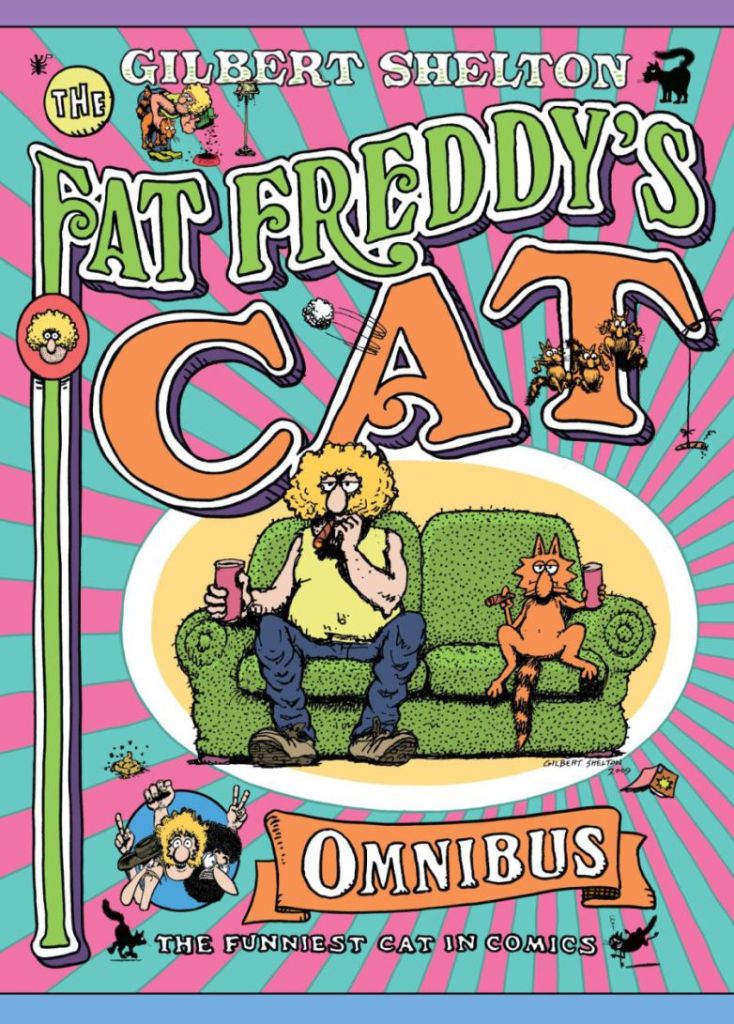
© Gilbert Shelton
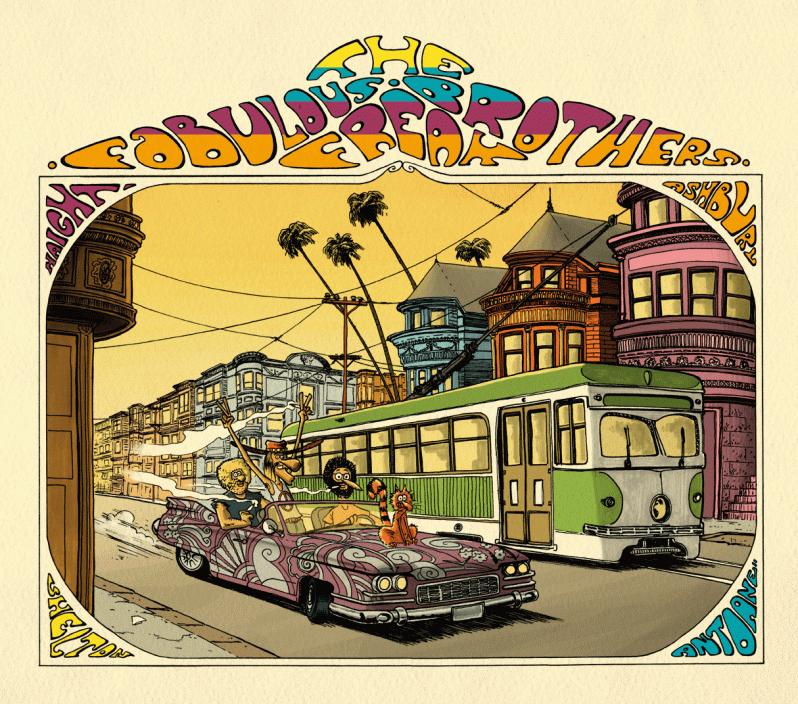
© Gilbert Shelton
Les deux premières expositions seront donc placées sous le signe des animaux. Hasard ou coïncidence ?
Je ne suis pas un fan de dessin animalier. Certains sont très communs. Mais pas ceux de Renaud. Lui, c’est un dessin animalier qui ne concerne pas uniquement que les enfants, c’est pour les petits et les grands. C’est de l’ordre du conte, universel. Ces animaux sont loin d’être communs. Dans le cas de Renaud, les scènes de ses albums seraient pathétiques, voire très tristes, si aux animaux se substituaient des humains. Les animaux permettent une empathie immédiate tout en abordant le deuil, l’amitié, le racisme. Sans être moralisateur parce que les animaux permettent de se distancier.

© Régis Hautière/Renaud Dillies
Dans un autre genre, j’aime beaucoup le Canardo de Sokal. Lui, s’il filmait ses histoires avec des acteurs, ce serait des épaves, tenues par la boisson et les dangereux extrêmes. Mais le trait de Sokal rend tout ça burlesque.
Quand on est un nouveau venu dans ce monde parfois décrié des galeristes, comment se fait-on une place ? Et comment convainc-on des auteurs de vous faire confiance ?
Les auteurs se parlent entre eux. Puis, je crois qu’ils ne sont pas dupes et voient très bien si quelqu’un aime ce qu’ils font. Les galeristes fonctionnent de manière différente en fonction de leurs objectifs. Certains ont une approche purement commerciale, ils savent qui ils veulent et comment le vendre. Moi, je me suis dit que ce n’était pas parce que j’aimais que je réussirais. Le tout était de permettre le risque tout en me modérant. C’est ainsi que nous nous sommes mis d’accord sur les prix avec Renaud Dillies. Un prix qui soit cohérent. Vous savez, dans l’ombre des best-seller, il y a beaucoup d’artistes qui se vendent à moins de 1000€. Il y a moyen de se faire plaisir pour tous les portefeuilles.
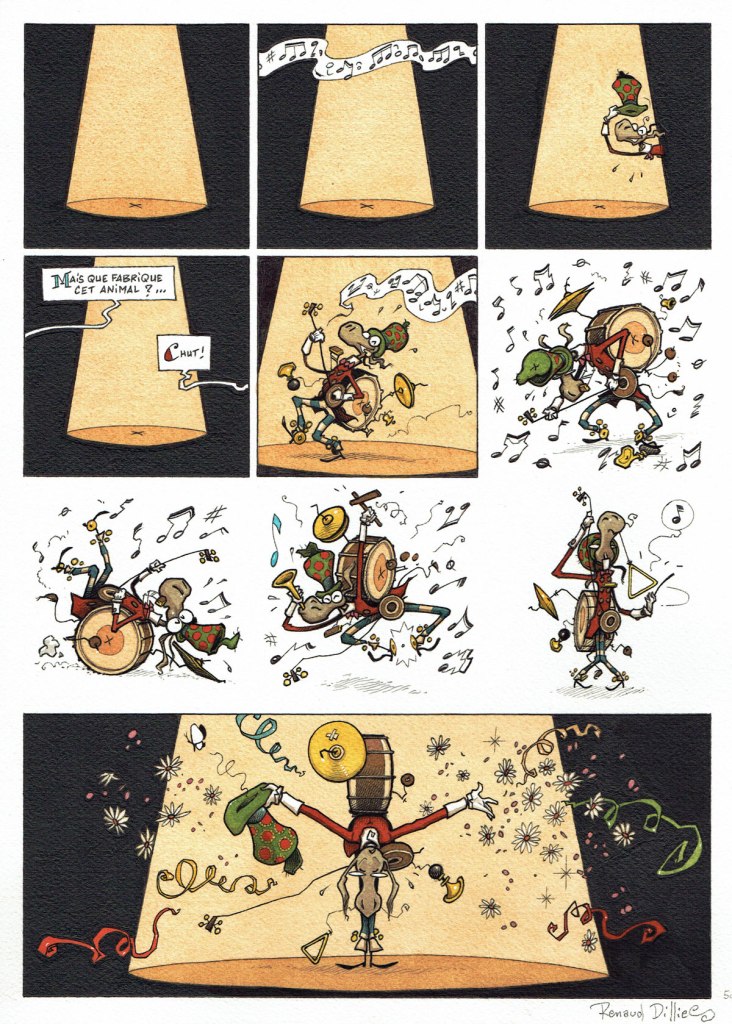
© Renaud Dillies chez Dargaud
Bon, dans un futur proche, j’aimerais aussi exposer et vendre des auteurs dont les travaux se monnaient entre 5000 et 10 000€. Mais je sais aussi que je ne travaillerai pas avec certains car ils souhaitent vendre leurs originaux trop chers.
Se faire plaisir quelle que soit notre bourse, vraiment ?
Certain ! S’il y a bien un monde de collectionneurs qui font monter les prix, qu’on parle d’Astérix, de Tintin, d’originaux vendus à des sommes records et qui sont autant de placements et investissements; il ne faut pas comparer un kilo de sucre et un kilo de sel. Je pense que tout est affaire de choix et que si quelqu’un veut se composer un portfolio ou décorer un mur chez lui avec quelque chose d’original, au-delà des vedettes, il n’y a rien d’impossible. Une oeuvre, on la choisit d’abord pour soi, pour l’émotion qu’elle procure. Ça doit être le moteur. Pour quelques centaines d’€ déjà, on peut s’offrir quelque chose qui nous séduit. Après, peut-être vous faudra-t-il choisir entre faire l’impasse sur une semaine de vacances à 500€ et une oeuvre qui vous fera plaisir et rayonnera dans une de vos pièces au quotidien.

© Kokor aussi à découvrir sur le site de Comic Art Factory
C’est dommage que les médias s’attachent tant aux records. Une collection se monte dans la durée. Moi, je ne me sens pas l’âme d’un gestionnaire financier ou d’une Madame Irma, je ne suis pas là pour rassurer le financier inquiet. Mon intérêt est dans le sens et l’émotion, et si elle peut être procurée à prix démocratique, c’est encore mieux. Regardez ce que fait une Nais Quin qui a publié Ramona, une histoire d’amour entre ados loin des clichés habituels, chez Vraoum. Vous pourrez repartir avec un original A4 au crayon, d’une grande maîtrise, pour 200 ou 250€. C’est raisonnable, tout en restant conscient que, oui, ça représente un demi-loyer.
Comme les tractations se passent-elles alors entre le galeriste et l’auteur ?
Il y a plusieurs cas de figure.
Celui qui n’a pas attaché à l’original et ne le considère que comme une étape. Il fixe le prix qu’il veut en obtenir ou le confie au galeriste qui en tire le prix qu’il estime. Soit par dépôt-vente ou alors le galeriste achète la planche à l’auteur et fixe un prix idéal pour ne pas être perdant.
Il y a l’auteur qui change d’avis un mois après vous avoir dit non. Il considère ses planches comme ses bébés, il y a une valeur sentimentale. Alors, c’est au galeriste de le convaincre, de lui expliquer pourquoi il a envie de collaborer avec lui et comment il compte les mettre en valeur. Ça passe si les deux parties sont à l’aise.
Enfin, il y a l’auteur qui est incapable de se séparer de son oeuvre, qui la considère comme personnelle et représentative d’un moment de leur vie.
Dans votre cas, avez-vous appris le métier de galeriste ?
Je considère ça comme une extension de mon amour pour la BD. Au fond, j’ai toujours travaillé en rapport avec le secteur culturel, en radio, comme journaliste ou comme animateur de centre culturel. Mais, cette fois, c’est vraiment la première fois que la culture représente un métier. Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais passé une semaine sans lire de BD. Encore aujourd’hui, je lis pas mal de comics via Comixology.
Pour être galeriste, je pense qu’il faut de la rigueur et de la transparence. Si je vais chez un auteur et que j’en repars avec 50, 60 voire 70 planches, comme je suis jeune dans le métier, je dois mettre tout en oeuvre pour qu’il me fasse confiance, de manière spontanée. Il faut aussi être soigneux. Vous le dites, je suis très jeune en tant que professionnel dans le milieu mais j’ai de l’expérience en tant que passionné de bandes dessinées. Je me souviens de rencontres lors de ventes aux enchères. Je repérais tout de suite les marchands, ils n’ont qu’une seule et unique question à la bouche : « L’artiste dont vous parlez est-il mort ou vivant? ». En réponse, il y avait un silence embarrassé auquel le marchand répondait systématiquement : « C’est beaucoup plus facile de travailler avec des morts ». Je suis contre cette logique, le mieux qu’on puisse faire est de permettre à l’artiste de bénéficier de la vente de leurs oeuvres de leur vivant.

Puis, quand il est trop tard, c’est vrai qu’il arrive que certains séduisent toujours plus le public et les acheteurs. Les grands anciens comme on les appelle. De tout temps, certains se sont approprié des choses de manière… disons… particulières. Après, chacun a sa conscience pour lui. Je ne suis pas là pour juger mes collègues. Ce qui est clair, c’est que je préfère collaborer et si je fais de l’expo-vente, j’aime que le visiteur lambda entre dans la galerie, intrigué par les cases mises en vitrine dont il ne connaît pas forcément l’auteur. Ça me donne l’opportunité de lui expliquer. Et s’il a le temps, une heure, je l’inviterai volontiers à s’asseoir dans le canapé et je lui passerai quelques albums.
Votre coup de coeur, actuellement ?
En ce moment, c’est un artiste que je redécouvre alors que je n’étais pas forcément branché sur les récits de guerre qu’il a pu concevoir : Joe Kubert. J’ai été bluffé par certaines planches que j’ai vues aux USA, par son découpage. Pour moi, c’est du même niveau que Will Eisner, une leçon de narration dans la manière dont il travaille les visages, les corps, le cadrage. Regarder son western, Firehair, c’est une claque. Il avait compris son médium et les choses que seule la BD permettait de réaliser. Depuis, je remonte le temps à la recherche d’histoires publiées dans des comics des années 70’s et qui n’ont jamais été republiées.
Les prochaines expositions ?
Pour juin, je prépare une exposition collective sur l’heroïc fantasy. Il y aura Cédric Fernandez (Les forêts d’Opale), Thibaud de Rochebrune (Michel Ange, La geste des chevaliers dragons)…
Et, à la rentrée, la galerie se mettra aux couleurs de Ninn du duo Darlot-Pirlet chez Kennes.
De chouettes moments en perspectives. Merci Frédéric et longue vie à la Comic Art Factory.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Comic Art Factory ou sa page Facebook. L’expo-vente de Renaud Dillies est à voir jusqu’au samedi 6 mai au n°237 de la Chaussée de Wavre à Bruxelles.

Il y a deux ans, presque tout pile, quand nous avons rencontré Dany, le septuagénaire à la jeunesse éclatante se mettait au travail sur autre chose que des planches de BD : des toiles à l’acrylique. Un monde assez nouveau pour le papa d’Olivier Rameau et tant de jolies filles de papiers (qu’elles soient de blagues coquines ou d’ailleurs) qui a superbement tiré son épingle du jeu avec frivolité, sexytude mais aussi une détermination à terrasser le politiquement correct avec une intenable, irrésistible et incompressible liberté. C’est à voir jusqu’au 21 avril à la galerie Daniel Maghen à Paris. Bienvenue en 1900 mais aussi en 2018. Nous avons rencontré Dany, en pleine préparation d’un voyage au Viêt Nam, pour parler de ses femmes mais aussi de ces projets de bande dessinée, entre Spirou, un projet qui promet dans la collection Aire Libre et… le retour d’Olivier Rameau ?

Bonjour Dany, la dernière fois, vous étiez en pleine élaboration de toiles et d’acryliques. Une activité assez neuve pour vous. Trois ans plus tard, les voilà enfin exposées et vendues dans la prestigieuse galerie Daniel Maghen à Paris. Ça a pris du temps, non ?
En effet. En y réfléchissant, J’aurais peut-être dû prendre six mois pour ne faire que ça. Au lieu de ça, j’ai réalisé des toiles pendant quinze jours, voire trois semaines, puis je faisais autre chose. J’aime me diversifier. Du coup, ces trois ans de travail représentent 24 toiles et une vingtaine d’acryliques sur papier. Si j’avais déjà réalisé, par le passé, l’une ou l’autre illustration, je n’avais pas approfondi cette technique. Mais elle m’intéressait, je ne savais juste pas ce que je pourrais raconter.

© Dany
Puis, Daniel Maghen a provoqué le déclic. En venant chez moi, il a repéré une illustration que j’avais réalisée sur le Centre Belge de la Bande Dessinée, ce bâtiment d’Art-Nouveau réalisé par Victor Horta et qu’on ne présente plus, qui fut l’écrin des magasins Waucquez. Plus tard, Guy Dessicy se battrait pour sauvegarder ce bâtiment et y abriter le grand musée qu’on connaît aujourd’hui.

© Dany
En voyant cette illustration, issue d’un portfolio réalisé avec d’autres artistes, Daniel Maghen m’a soumis cette idée. Pourquoi ne pas réaliser une série de toiles portant sur la fin des années 1800 et le début des années 1900, une période très décorative. J’ai été d’autant plus séduit que, en passionné d’histoire, je possédais beaucoup de documentation. Je me suis donc lancé.
Avec facilité ?
J’ai autant été fasciné que j’ai été piégé par toutes les possibilités que proposait la peinture. Jusqu’à l’hyperréalisme. « Tendre à la perfection à s’en crever les yeux », chantait Aznavour. Du coup, sur certaines toiles, je me retrouvais à venir et revenir sur des détails. L’arrondi d’un sein, par exemple. J’étais piégé. Alors que ce qui me plaisait, au départ, c’était l’impressionnisme. Ce n’est seulement que maintenant que j’appréhende mieux cet art. S’il y a une autre expo, je pense que ce sera un cran au-dessus, encore mieux. Mais, dans cette première exposition, on retrouve donc les deux facettes, impressionnisme et hyperréalisme.

© Dany
Naturellement, pour en arriver là, il y a eu des balbutiements. Avez-vous pris des cours, été chez des « maîtres »?
Non, ça me plaisait beaucoup de tester, d’expérimenter, de me débrouiller seul. Peut-être aurais-je dû demander conseil ? Mais, j’aime trop me diversifier. J’ai horreur de la routine, quel que soit le plaisir que je prends à traiter un sujet. Non pas que je m’ennuie mais que je suis porté par ce besoin de renouveler la routine. Je mets la barre plus haut. Ce n’est pas toujours confortable, c’est même parfois dangereux mais ça contribue sans aucun doute au fait que mon enthousiasme est intact.

© Dany
Ce qui aurait été beaucoup plus difficile, je crois, si j’avais fait carrière avec un seul personnage. D’ailleurs, elles sont de plus en plus rares, les séries au long cours. La tendance est désormais aux séries plus courtes.
Après, ma manière de travailler n’est en aucun cas liée à un insuccès. Dieu sait que des éditeurs m’ont proposé de faire et refaire des albums coquins à l’envi. Même si, des jolies femmes, il y en a toujours dans mes albums…

© Dany
… et vos toiles. Ce n’est pas pour rien que cette expo s’intitule : « Les femmes de Dany ».
En effet, des jolies filles, pas toujours très habillées. De quoi contraster avec la mode des années 1900, quand on n’avait pas peur de rajouter du tissu sur les vêtements. Comme les chapeaux: plus c’était grand, mieux c’était. Vous savez, l’époque victorienne, qui n’était pas réservée qu’à l’Angleterre mais a aussi pris ses quartiers en France et plus largement en Europe, c’était une époque assez coincée, engoncée dans des conventions et un politiquement correct qui n’empêchait toutefois pas les turpitudes. Je voulais donc la confronter à des jeunes femmes, nues, belles, flamboyantes et, par-dessus tout, libres. Capable de dire à cette société : « Je vous emmerde, je suis libre! »

© Dany
Ce pied de nez m’intéressait d’autant plus qu’il est aisé de faire le parallèle avec ce qu’on vit actuellement. Le politiquement correct a repris le pouvoir, on ne peut plus rien dire sur quoi que ce soit sous peine d’être accusé de tous les maux. L’idéologie rampante est devenue dominante. Et ça m’insupporte.

© Dany
Si elles ont pris leur élan pour se retrouver des planches aux toiles, on reconnaît bien là vos filles.
Ça me fait plaisir et en même temps, ça m’interroge. Yslaire, et d’autres dessinateurs qui sont venus me voir, m’ont également fait la remarque: « Arrête, on sait que c’est toi, t’as même pas besoin de signer ». On ne se refait pas, pourtant, j’ai l’impression d’avoir vraiment fait quelque chose de différent. En tout cas, j’essayerai d’y arriver un peu plus dans la prochaine expo. Je ne sais pas encore sur quoi elle portera, je ne sais pas encore sur quoi. Il m’importe d’avoir quelque chose à dire, pas n’importe quoi, et de le faire, de toute façon, par la séduction. C’est vrai que j’éprouve quelques difficultés à dessiner des moches. J’en parlais avec Loisel et il me disait de continuer tout en changeant de direction, en m’évadant des pin-up. On verra bien?

© Dany
Cela dit, j’avais réalisé cinq toiles avec des filles différentes de celles que je peux animer, en règle générale. Pour réaliser ces toiles, j’ai fait poser des modèles. Souvent, j’adaptais, j’interprétais… sauf pour ces cinq toiles dans lesquelles j’ai essayé d’être fidèle aux originales. Mais… Daniel Maghen ne les a pas retenues pour l’expo-vente. Pas assez sexy, peut-être un peu tristes, fatiguées. Des femmes plus toutes jeunes. Daniel, je le comprends, il est formidable, il sait ce qu’il veut. Ces tableaux, je les garde, je ne les ai pas détruites et je les utiliserai sans doute dans une autre exposition. Mais, au-delà de ces cinq tableaux, il y en a un autre qu’il a failli ne pas prendre, Miroir Noir, mais j’ai insisté.

Miroir noir © Dany
Vous parliez d’Yslaire. En cours de route, vous avez montré vos peintures à d’autres auteurs ?
Oui, bien sûr, au fur et à mesure. Olivier Grenson, Turk, Jean-François et Maryse Charles, Barly Baruti, Yves Sente. Quand il venait me rendre visite, forcément, ils savaient sur quel projet je travaillais alors ils voulaient jeter un coup d’oeil.

© Dany
Et, au vernissage de l’expo, que de (beau) monde !
Oui, avec Guarnido, Gibrat, Gauckler, en plus de ceux déjà cités. Ça m’a touché. En plus, il paraît que l’accueil est plutôt bon. Mais ça, je n’ose jamais le demander au galeriste.
Dans ces toiles, des femmes, on l’a dit, mais aussi des décors. Intimistes et minimalistes ou fourmillant de détails, comme ce voilier ou cette foule. Tout en variant la lumière.
La lumière, c’est le mot important. C’est Hermann qui m’a dit, un jour : Ne pense pas à la couleur, pense aux lumières. C’est ce que je mets en pratique depuis longtemps en jouant avec des double-éclairage, par exemple. Puis, il y a les visages, le regard. Il m’est crucial que ce regard interpelle le lecteur ou le spectateur, qu’il soit loquace et qu’un sens se dégage du regard, de l’ambiance de l’ensemble.

© Dany
Cela dit, quoiqu’on fasse, art ou pas, je suis convaincu de l’importance de créer l’émotion. Si on regarde une peinture comme une tapisserie, c’est perdu. Il faut parvenir à accrocher le regard.
Vous nous disiez, en début, d’interview, ne pas vous être concentré uniquement sur la réalisation de ces toiles. Qu’avez-vous fait d’autre ? De la BD ?
J’ai, en effet, deux albums en préparation. Un Spirou avec Yann, qui est bloqué depuis quelques mois. On n’est plus d’accord sur la fin, ça arrive et ça finira bien par se régler. Il devrait faire 62 planches.

© Yann/Dany chez Dupuis
Puis, il y a un autre projet que je réalise avec Denis Lapière. Un chouette album, dans un style très différent de ce que j’ai proposé jusqu’ici. Ce sera un cahier graphique à quatre mains en quelque sorte. Non pas que Denis se soit mis à dessiner mais nous nous sommes complètement impliqués tous les deux. Denis a écrit cet album en pensant à moi et il a tenu à ce que le personnage principal ait un air de famille avec moi. D’ailleurs, le titre ne vous étonnera pas le moins du monde : ce sera Femmes ! (il rit). Soixante-quatre planches qui se dérouleront sur deux périodes. Une partie au temps présent, dur, avec des ombres noires. Et une autre partie en flashback, l’aquarelle suscitera les souvenirs, qui seront sans doute un peu flous, lointains. Cela paraîtra chez Aire Libre.
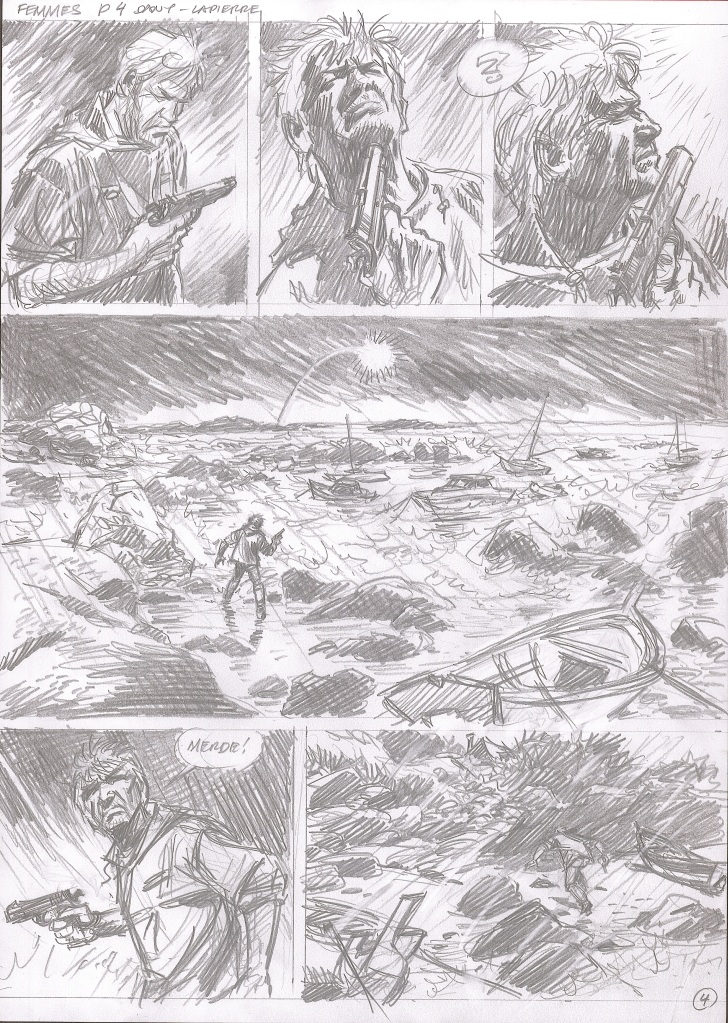
© Lapière/Dany

© Lapière/Dany
Autre actualité de ces derniers mois: Joker qui a mis la clé sous le paillasson.
C’est intéressant, aussi, ça. Ça fait longtemps que Thierry Taburiaux voulait vendre. Il n’était plus motivé comme on l’a été pendant vingt ans. Il avait désormais d’autres centres d’intérêt. Et l’occasion s’est présentée avec les éditions Kennes qui ont racheté une partie du catalogue de Joker. Et mes albums en font partie. Kennes est très dynamique et mes albums coquins vont être remaquettés. Tout en enlevant certains gags qui, aujourd’hui, m’enverraient en prison, ou pire… (rires). Avec la possibilité de nouveaux albums coquins. Étant donné que je me suis amusé comme un petit fou avec Erroc sur Ludivine, j’en ai touché un mot à Erroc, le scénariste. Refaire des blagues ensemble, ça pourrait être sympa !

© Erroc/Dany chez Glénat
Puis, Dimitri Kennes est preneur d’un nouveau… Olivier Rameau ! Ça me change de l’engourdissement bien compréhensible de Thierry. Olivier Rameau, c’est chez moi, j’y retourne avec grand plaisir et sans problème, il me permet de jouer et de me moquer du politiquement correct. Mais, encore une fois, le nerf de la guerre, c’est le temps. Mais, j’ai toujours un album inédit d’Olivier Rameau, Le pays des 1001 ennuis, écrit, dialogué, découpé. Il faut juste que je le retrouve. Il n’y a plus qu’à le dessiner, et comme j’aime résolument toutes les disciplines, du scénario à la couleur, je ne peux pas me résoudre à passer les rênes.

© Dany
En attendant, ça y est, vos valises sont prêtes pour partir au Viêt Nam ? Le plus intrigant est sans doute cette conférence que vous tiendrez à l’… Université de Hanoi !
La valise, pas encore, mais elle est prête en permanence. Mais oui, le Viêt Nam. Comme quoi la BD de cul, ça mène à tout ! (il se marre). Ce voyage a lieu dans le cadre d’un échange culturel mené par la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une attention pour la BD, notamment. Moi qui aime voyager, je ne pouvais pas refuser, même si, pendant ce temps-là, mes projets n’avancent pas. Puis, c’était l’occasion de revoir le Viêt Nam, de comparer ce que je vais voir avec mes souvenirs d’il y a quasiment vingt ans, quand j’y ai été la première fois.
Puis, il y a cette conférence. Elle me permettra d’insister sur le rôle primordial de la Belgique sur la bande dessinée. La BD belge est d’une importance capitale dans le Neuvième Art. Il est important de remettre les pendules à l’heure, surtout quand certains critiques se permettent, dans des bouquins sur la BD, de ne s’intéresser que pendant un chapitre à ce qu’ils appellent « La parenthèse belge ». Quelle insulte. Des journaux comme Tintin ou Spirou ont drainé tant de créateurs extraordinaires, de monstres sacrés. La Belgique a eu une influence énorme sur la Franco-Belge et même plus loin. Je pense que Giraud n’aurait pas existé de la même manière, s’il n’y avait pas eu Jijé.

© Dany chez Dupuis
Et on jure qu’il y en aura, des auteurs, qui vous devront aussi des choses, Dany. Un grand merci et bon voyage !
En attendant, voilà un aperçu de ce que le visiteur peut voir à la galerie Maghen, jusqu’au samedi 21 avril 2018.
Propos recueillis par Alexis Seny

Avec Ailefroide, c’est un grand coup de piolet, de longue haleine, que nous livre un Jean-Marc Rochette au sommet de sa forme et de son talent (enfin, bon, chaque fois, en escaladeur chevronné, il repousse ses limites graphiques, vous savez). Plongeant dans ses aventures d’ado, quand il apprenait à toucher le ciel avec un matériel de fortune mais une idée en tête qui germait et allait bientôt être aussi grande qu’une montagne; Jean-Marc Rochette (en compagnie d’Olivier Bocquet, en renfort scénaristique) nous fait découvrir la montagne comme jamais, avec un angle personnel, des notices professionnelles mais, surtout, un rendu et un propos universel qui vient nous chercher, qu’on ait la tête dans les nuages ou qu’on soit pris de vertige dès que nos pieds ne touchent plus le plancher des vaches. Un caillou a eu raison de son rêve de devenir guide de montagne. Pourtant, quarante ans plus tard, il l’est devenu. Par la force d’un Neuvième Art qui ne lui a pas brûlé ses ailes montagnardes. Passionnant de bout en bout, de bas en haut, tout en haut.
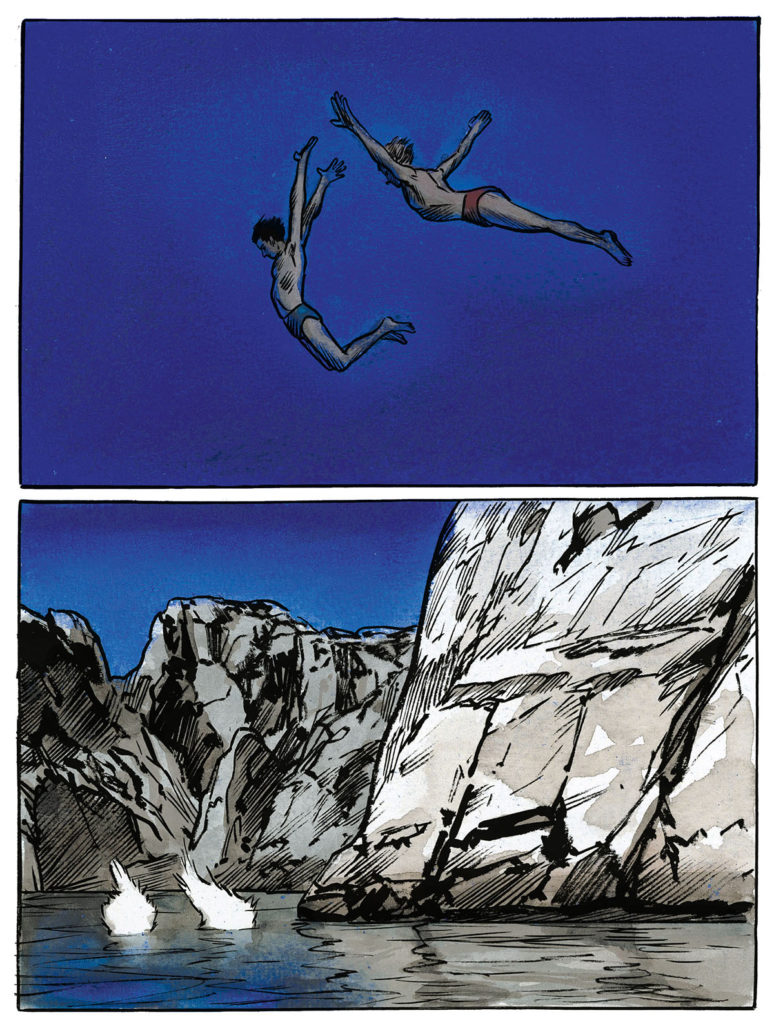
© Bocquet/Rochette chez Casterman
Bonjour Jean-Marc, j’ai l’impression que cette fois, même si c’est à retardement, vous l’êtes devenu ce guide de montagne que vous rêviez d’être ado?
Jean-Marc Rochette : C’est vrai, c’est un peu ça. Il y a même des sites spécialisés en montagne qui me demandent de leur dresser la liste de course du matériel idéal pour s’attaquer à une ascension.
Votre première ascension, elle date d’il y a quelques décennies. Comment se fait-il que vous l’ayez fait resurgir aujourd’hui ?
J’avais enterré, ça, c’est vrai. C’était une autre vie même si je suis resté extrêmement passionné par la montagne. Une fois, j’en ai parlé à mon éditrice et elle a été assez emballée. Mais, pour réaliser cet album, je devais trouver un axe qui aille vers le public, élargir le passage et dépasser le propos du simple spécialiste.
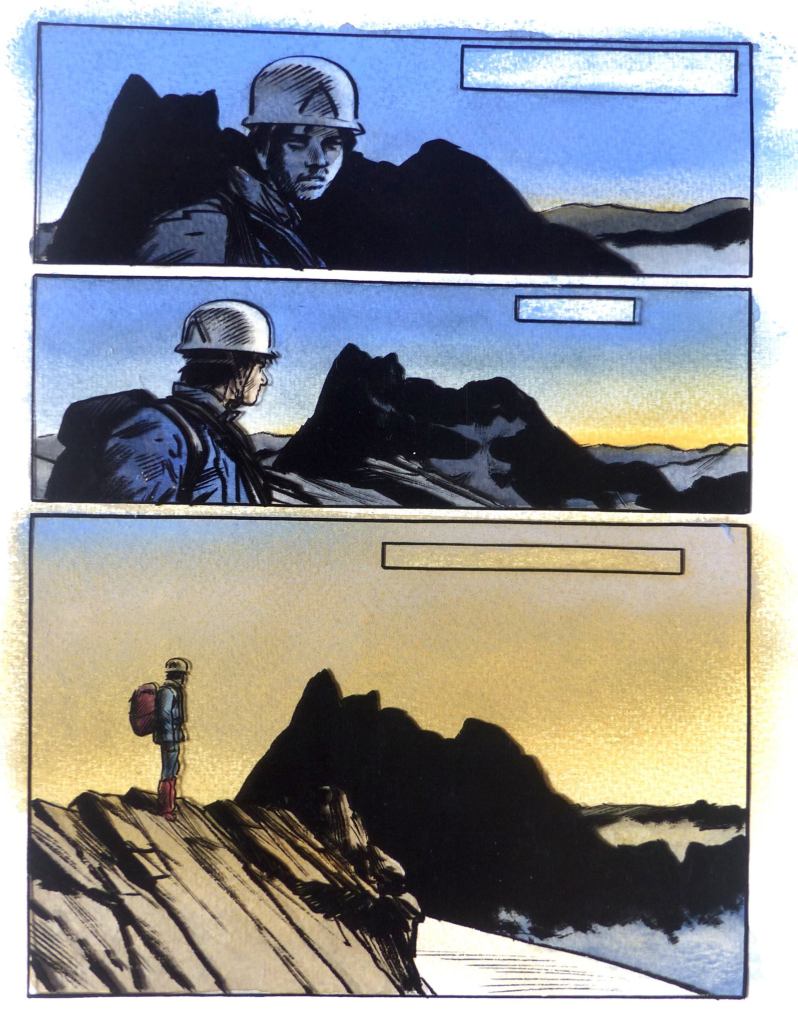
© Bocquet/Rochette chez Casterman
Vous avez cherché longtemps ?
Non, c’est venu assez vite, c’était ma vie, je n’avais rien à inventer. J’ai regroupé certaines scènes pour plus de cohésion. Mon éditrice m’a aussi fait des remarques face à ce que j’avais imaginé être un personnage de Mark Twain en liberté, seul ou presque dans la montagne. Elle n’avait pas tort, je devais parvenir à mettre en relation mon personnage. Au lycée, avec mes amis de l’époque et avec ma famille et, surtout, ma mère qui m’a élevé seul après la mort de mon père durant la guerre d’Algérie.

© Bocquet/Rochette chez Casterman
Avec l’intervention d’Olivier Bocquet, avec qui vous aviez travaillé sur le Terminus du Transperceneige.
Oui, même si j’ai beaucoup écrit, objectivement. Il m’a amené la distance, la fluidité du discours tout en évitant de se nombriliser. On y a gagné en temps !
Puis, dans l’histoire des oeuvres culturelles, travailler en coscénaristes, c’est important. Regardez Kubrick. Cela dit, je remarque que là où c’est presque une constante dans le cinéma, la BD associe moins deux co-scénaristes ou plus sur un même projet. Moi, je trouve que ça permet de discuter, de s’améliorer.

© Bocquet/Rochette

© Bocquet/Rochette chez Casterman
Cela dit, Olivier est venu en technicien du scénario. La montagne, il n’y connait rien, je ne sais même pas s’il y a déjà été. C’était son regard de candide qui m’intéressait. Il m’a aussi permis de tout tester, de me rendre compte que si ça fonctionnait sur lui, ça pouvait fonctionner sur tout le monde.
Autre regard, le vôtre sur la peinture. C’est la première chose qu’on voit dans cet album, avant même la montagne.
J’ai d’abord été attiré par la peinture avant la BD. Pour sa dramaturgie, son mystère… Après, je n’ai pas fait de peinture, car il n’y avait plus de maître sur lequel prendre exemple. C’est un monde curieux.

© Bocquet/Rochette chez Casterman
Mais aujourd’hui, dans votre BD, ne faites-vous pas plus de peinture qu’avant ? Votre trait n’est-il pas hybride ?
C’est vrai que je fais pas mal de peintures de paysage, puis j’utilise de portraits. Après, je reste assez loin de la peinture, finalement. Pour tout vous dire, je rêve de me retrouver un jour dans l’atelier de Goya et Poe qui se seraient unis pour faire une bande dessinée. Je ne sais pas ce que ça aurait donné mais ça aurait mis tout le monde d’accord. Je n’ai pas suffisamment de recul sur ce que je fais que pour savoir s’il est acceptable de me ranger parmi les peintres-dessinateurs.

© Bocquet/Rochette chez Casterman
Quoi qu’il en soit, l’ascension de cet album vers le lecteur a été fulgurante.
C’est très émouvant d’apprendre qu’au bout de deux semaines, l’ouvrage part en réédition, qu’il a trouvé les mains de personnes qui ne sont même pas de ma région, qui ne la connaissent pas.
Après, je pense que je suis parvenu à la rendre universelle, cette histoire. Mon ami Tardi, qui n’a rien à voir avec la montagne, m’a avoué avoir eu le vertige, s’être senti comme un enfant alors que c’est un géant. À ce moment, je me suis dit que j’avais marqué un point. Que j’avais réussi à faire passer ce sentiment d’immersion.

© Bocquet/Rochette
Un sentiment qui atteint son paroxysme lorsque tombe la pierre qui va changer votre vie et vous défigurer. Trois cases qui font basculer un jeune homme et ses projets.
Je voulais qu’on voit l’accident de loin, que ce ne soit pas frontal, que de l’alpiniste on ne distingue rien qu’une silhouette. Et une pierre qui se décroche, qui dégringole et vient s’exploser sur ma figure. J’ai laissé passer le temps, les planches avant de montrer le visage défiguré au lecteur.
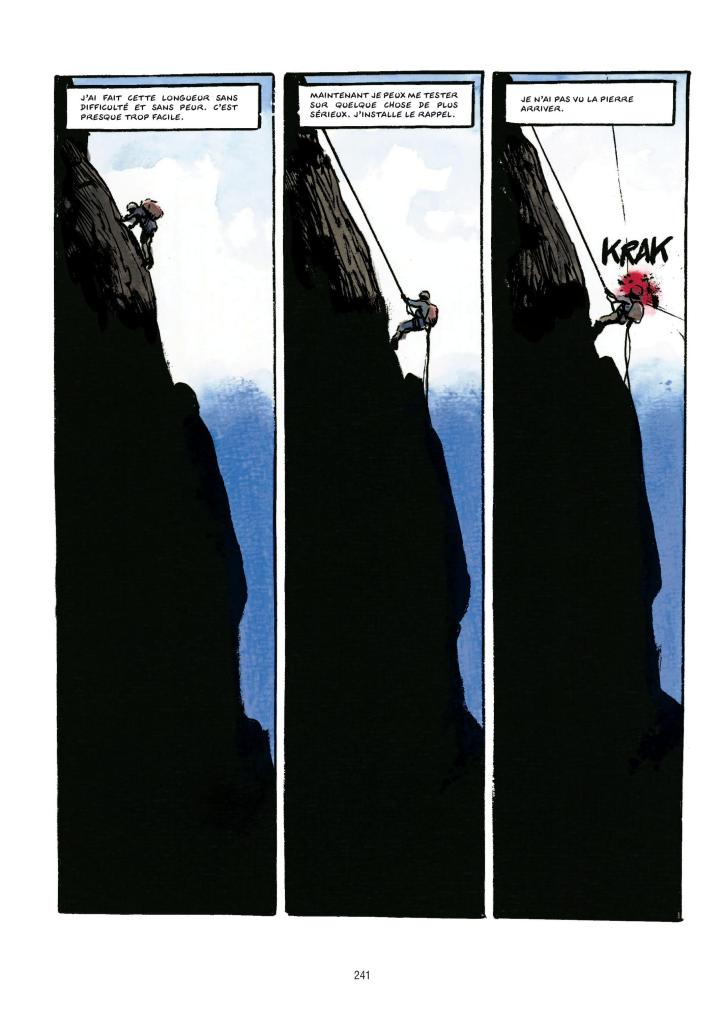
© Bocquet/Rochette chez Casterman
Ça passe d’abord par le regard avec, dedans, quelque chose d’un animal en souffrance. Ce n’est pas un hasard, je me suis inspiré d’une photo d’un chat qui avait eu le bas de la tête explosé. Après, je voulais me dégager du pathos, évoquer cette douleur, ce choc de manière artistique, durant la traversée jusqu’à l’hôpital… et, avant ça, l’embouteillage. Là, je n’ai pas eu d’autre choix que celui de sortir de la voiture et de montrer mon visage, de montrer l’urgence pour que les automobilistes nous laissent passer.
Que de frissons pendant cette séquence !
Je me suis interrogé sur comment rendre tout ça, sans cacher les choses. Je me suis retrouvé parfois sur le fil du rasoir lors de mes ascensions en montagne. Cette séquence qui va changer ma vie, elle arrive après un premier accident dans le couloir. Un accident après lequel le lecteur peut souffler, se dire que le pire est passé. Ouf, ça va aller mieux… Et là, boum, c’est le deuxième accident, qui vous saisit par surprise.

© Bocquet/Rochette
Pour un gars du plat pays qui est le mien, mais certainement pour d’autres qui ne se sont pas aventurés bien haut, une montagne, c’est une montagne. Qu’est-ce qui fait votre amour des Écrins, le principal décor de cette aventure, au final ?
C’est une histoire d’amour. Bien sûr, je suis monté dans d’autres régions, au Mali, à Chamonix, je n’ai jamais retrouvé le rapport au massif qui était les miens. Certains disent que c’est érotique. Il y a une texture. C’est une femme à laquelle on a aucune envie d’être infidèle (il sourit).
Mais, finalement, vous gardez cet amour pour la montagne malgré tout ce qu’elle vous a pris : une partie de votre visage, pas mal d’amis…
Oui, mais les choses graves ne se sont pas passées dans les Écrins. Dans le Vercors, par exemple. Dans l’Oisans, s’il y a eu des chutes de pierres, des orages, je n’ai jamais craint pour ma vie ou celle d’un compagnon de cordée. C’était sans conséquence véritable.

© Bocquet/Rochette
Saviez-vous en commençant que votre histoire ferait 280 planches ? Ce caillou dont on parlait est devenu un pavé !
Non, j’avais signé, et été payé pour 150 planches. Pour tout dire, j’ai coupé des séquences. Des histoires, j’en avais plein à raconter. Celle d’un copain qui voulait devenir prêtre. Mes ascensions au Mali. Mais c’était hors propos, ça ne tenait pas avec le fil narratif.
Une autre fois, peut-être ! Le fait que votre Transperceneige ait été adapté en film a-t-il changé votre regard sur votre art et ses capacités ?
D’un coup, la bande dessinée underground qu’était Le Transperceneige est devenue mainstream. J’ai pris confiance en ce que j’étais, de ce que la montagne cachait par rapport à moi qui me sentais un peu ridicule. Aujourd’hui, je m’accepte comme je suis, le cinéma m’a donné un éclairage sur mon art. Je peins, je fais de la sculpture. Ça rejoint la métaphore de l’arbre dans la canopée. Il peut rester des années à vivoter dans l’ombre, face à d’autres arbres bien plus grands. Puis, un jour, il va trouver la lumière, vite pousser et devenir luxuriant. Moi, à l’heure où d’autres se voient vieillissant, j’ai l’impression d’avoir acquis une maturité, une certaine jeunesse, à 60 ans. C’est sans doute grâce au film, donc, qui m’a ouvert les yeux sur ça et ce dont j’étais capable.
À l’écran, l’aventure du Transperceneige n’est pas finie, la série se prépare.
Oui, là aussi, ça peut être quelque chose de grand, nous faire franchir un cap supérieur. Bon, pour le même coup, ça sera un flop, un coup dans l’eau. Toujours est-il que j’ai rencontré quelqu’un qui avait vu un trailer et apparemment ça donnait bien. Moi, je suis dans l’attente. Tout ça me paraît bien mystérieux. Pour les éléments tangibles, c’est le scénariste-créateur d’Orphan Black, Graeme Manson, qui est à la tête du projet avec Jennifer Connely au casting (ndlr. et, notamment, Scott Derrickson, le réalisateur de Doctor Strange, à la réalisation). Ça a été commandé par la TNT, quand même, la Warner Bros est derrière. Après, je ne toucherai aucun droit mais il y a autre chose, comme le rayonnement de la série BD. En matière de séries BD franco-belge, outre Tintin, il ne doit pas y en avoir énormément qui ont atteint un succès mondial tel que Le Transperceneige.

© Lob/Rochette chez Casterman
Puis, s’il y a la série, Le Transperceneige en BD… ce n’est pas fini. C’est un scoop. Je travaille à un prequel avec Matz. Nous n’avons pas de titre, pour le moment, mais nous avions pensé à « Extinction ». Le but est de voir ce qui a mené à la catastrophe, le déclic qui a fait plonger la civilisation dans la barbarie.

© Rochette
C’est super-intéressant, le tout avec un scénario choral. Matz est très fort là-dedans. Nous serons sur un format plus court que Terminus, un format comme le Bug d’Enki Bilal. L’idée est d’y aller graduellement. Une exposition aura lieu en juin 2019. Pour le moment, j’ai trente planches. Mais avec la sortie d’Ailefroide, la promotion, les dédicaces, j’ai arrêté d’avancer, je bloque. J’ai besoin de calme, de rester dans mon histoire…
… qu’on a donc fort hâte de découvrir. Merci pour cette échappée en hauteur.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Ailefroide
Sous-titre : Altitude 3954
Récit complet
Scénario : Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette
Dessin et couleurs: Jean-Marc Rochette
Genre : Autobiographie, Drame, Aventure
Éditeur : Casterman
Nbre de pages : 296
Prix : 28€

Qu’ils sont difficiles les allers-retours entre le septième et le neuvième art. S’ils se sont intensifiés, force est de constater qu’ils n’ont pas mené à de formidables réussites. Alors, quand on nous annonce que sort une bande dessinée adaptée d’un film, on ne part pas confiant. Un quatuor flamboyant nous a prouvés le contraire, autour du film Spirou et Fantasio, en retournant l’exercice et en en faisant quelque chose de fun, créatif et bien plus percutant que ce que le cinéma a été capable de faire. Le triomphe de Zorglub, c’est une non-adaptation du film, une surprise savamment orchestrée par Olivier Bocquet, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Johann Corgié. Tout un petit monde que nous avons pris le temps de questionner dans une interview peut-être bien ultime, certainement utile !
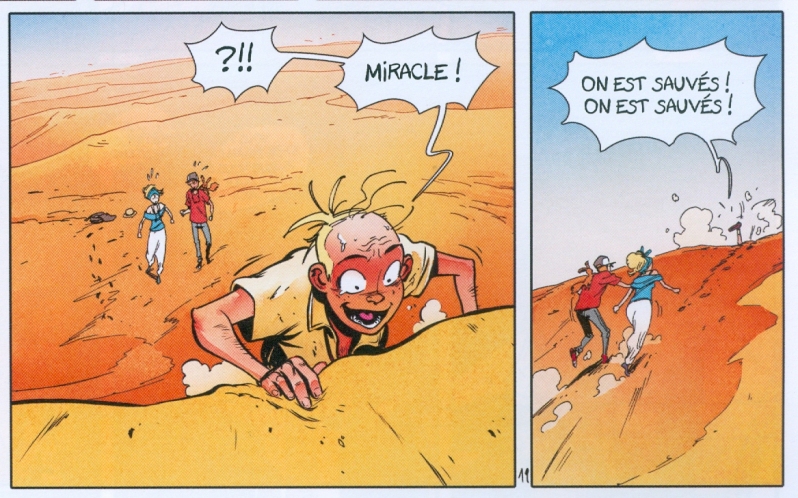
© Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Bonjour à tous. Pour une surprise, c’est une surprise. D’autant plus que cet album dérivé du film sans en être une adaptation a finalement été annoncé très tard.
Brice Cossu : C’est parti d’une demande de Dupuis. Si nous espérions bien faire un one shot Spirou vu par, à la base, nous n’avions pas l’intention de faire un album juste pour adapter le film. Ça n’avait pas d’intérêt. Mais, si nous pouvions l’emmener ailleurs, pourquoi pas ? Chez Dupuis, on nous a répondu qu’il serait compliqué de se dégager du film sauf s’il nous arrivait une idée de génie tout en intégrant le film.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié
Alexis Sentenac : D’autant plus qu’on avait lu la première version du scénario, nous n’étions pas emballés.
Brice : Puis, Olivier a eu cette idée de mise en abyme. S’il fallait prendre les acteurs du film, autant les opposer aux vrais héros qui se retrouveraient sur le plateau de tournage.
Alexis : S’il nous arrivait de faire un Spirou un jour, il fallait que ce soit notre aventure. Il nous appartenait sur cet album du film de faire le lien.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié dans le tirage de luxe aux Éditions Khani
En mettant les bouchées doubles. Olivier au scénario, Brice au crayonné, Alexis à l’encrage et Johann Corgié aux couleurs.
Brice : On a constitué une équipe, dès le départ, il fallait coller aux délais.
Alexis : Des délais qui convenaient à peu près, le film devait sortir en juin 2018. C’était avant qu’il soit ramené en février, avant le film Gaston. En plus de cet avancement de la sortie du film, la validation de notre script a pris du temps. On a stressé pendant que la production du film, elle, prenait son temps. Enfin, on connaît des gens qui ont attendu beaucoup plus longtemps. Notre chance, heureusement, c’était que dans l’équipe de ce Spirou, on se connaissait depuis longtemps. Ça nous a permis d’avancer deux fois plus vite, d’être plus dans l’intensité, d’y mettre de l’énergie.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Brice : Le faire pour mieux bâcler n’aurait eu aucun intérêt.
Johann : Pour ma part, travailler à ce rythme et dans ces conditions m’a permis de simplifier, d’aller à l’essentiel, de faire des choix. Contrairement à certains albums que j’ai pu faire et où je pouvais me perdre en réflexion, en détails. J’ai découvert le travail en équipe sur cet album et, du coup, tout va beaucoup plus vite, ils ont su m’orienter dès le début tout en me laissant complètement libre. Une super expérience.
Alexis : Puis, c’est l’album pour lequel je suis revenu au traditionnel. Jusqu’à présent, je réalisais mes albums en numérique. Je nourrissais l’envie de revenir au papier depuis un moment. Sur ce Spirou, j’ai franchi le pas, après 20 planches en numérique, sans transition. Il faut dire que ça m’aurait fait chier de m’attaquer à Spirou et de ne pas en avoir de traces physiques. Puis, il y a le marché original mais aussi le fait que j’ai pu offrir une planche à Olivier. Ce qu’en numérique, il est impossible de faire.
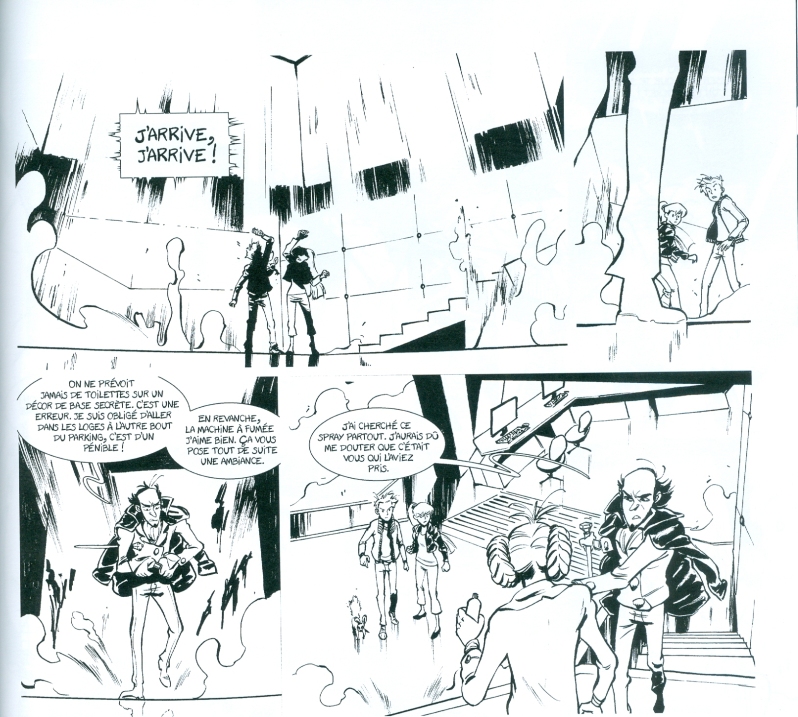
©Bocquet/Cossu/Sentenac
Au niveau de l’encrage, j’ai essayé de retrouver l’influence de Franquin. En tout, il m’a tellement inspiré. Enfant, c’est quand même Gaston que j’ai le plus souvent recopié.
Et vous Brice ?
Brice : Je suis resté au numérique, c’est ce qui fait mon énergie.
Alexis : Avec un aspect manga, aussi. Celui qui emmerde tellement le puriste. (Il ricane)
Brice : Mais c’est vrai que sur les trois premières planches, j’avais l’impression de me retenir. J’étais timide. Dupuis m’a rassuré, ils nous ont dit, n’hésitez pas à y aller. Du coup, on s’est dit, c’est bon, on lâche tout. Ce qui rend, je crois, le récit hyper-dynamique.
Alexis : On n’a pas perdu au change, c’est péchu.
Johann : Ahah les fameuses trois premières pages… elles nous auront tous bien fait galérer.
Johann, avec cet album, c’est un peu le temps des premières pour vous : Parution dans Spirou, Angoulême… Ça vous fait quoi ?
Alors en fait c’est ma deuxième parution dans le journal de Spirou, il y a 10 ans au tout début de ma carrière, j’avais fait une page couleur dessinée par Olivier Taduc pour le Spécial Benoît Brisefer, et la j’y reviens pour mon dernier album comme coloriste. La boucle est bouclée !
Et pour Angoulême, c’est juste énorme ! Les coloristes sont rarement invités sur les salons, alors y venir, qui plus est pour un Spirou, c’est que du bonheur. Énormément !
On aurait pu croire à une bande dessinée en pilote automatique. Pas du tout, on le constate très vite. Avec plein d’idées visuelles, de créativité. Comme sur ces trois cases où nos amis se rapprochent d’un 4X4.
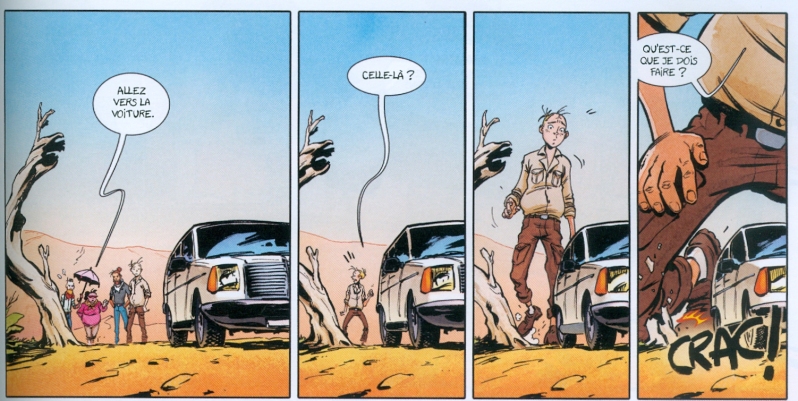
©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Alexis : C’est une idée d’Olivier, ça.
Brice : Et c’est un malade. Il y a cette séquence complètement folle dans laquelle le 4X4 part en tonneaux. Quelque chose de très cinématographique, sur lequel on s’arrache les cheveux en tant que dessinateur. C’est en général à ce moment que le story-board est collectif, que tout l’atelier y apporte sa touche.
Comme cette cascade acrobatique, sur le toit de l’hôtel. Dans la séquence, j’imagine la veste de Fantasio qui, dans l’action, s’enlève. C’est de la mise en scène pure.
Olivier : En ce qui me concerne, cette séquence — pages 40-41, si vous avez la curiosité d’y jeter un œil — est probablement, de toute ma carrière, ce que j’ai écrit de plus acrobatique en termes de gestion de l’espace. Et clairement, jamais je n’aurais écrit une séquence pareille si je ne connaissais pas aussi bien Brice et Alexis. Je savais qu’ils arriveraient à la garder lisible et dynamique. Les trois pages qui précèdent délivrent des informations sur l’intrigue, mais servent aussi de mise en place du décor. Le lecteur sait où il se trouve mais on n’appuie rien. Et dans cette double-page 40-41, on lâche les chevaux.
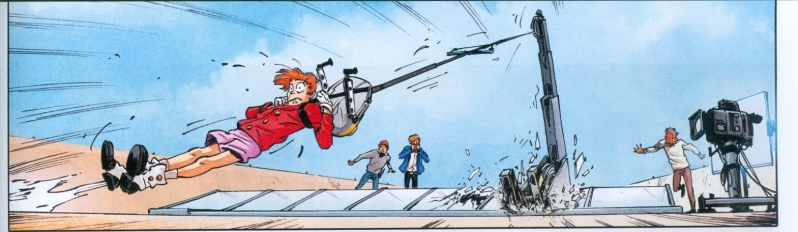
©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
À la première case, les deux personnages sont suspendus dans le vide à l’extérieur de l’hôtel, attachés l’un à l’autre uniquement par une paire de bretelles. Case suivante : les bretelles cèdent. Un personnage tombe tandis que l’autre monte… et pourtant, à la dernière case de la double-page, ils se retrouvent à nouveau ensemble, à nouveau au-dessus du vide, mais à l’intérieur de l’hôtel ! Ceci à l’issue d’un montage parallèle épique et — j’insiste là-dessus — que personne ne remarque ! C’est tellement fluide que le lecteur passe sur cette double page avec sans doute un petit sourire, en notant peut-être au passage que le vrai héros de la séquence est une héroïne, mais sans jamais se dire « woooooaw ! » Pour moi, c’est le signe qu’on a réussi notre coup. On a fait passer un truc hyper complexe comme si c’était parfaitement naturel. Je suis extrêmement fier de notre travail sur cette séquence.
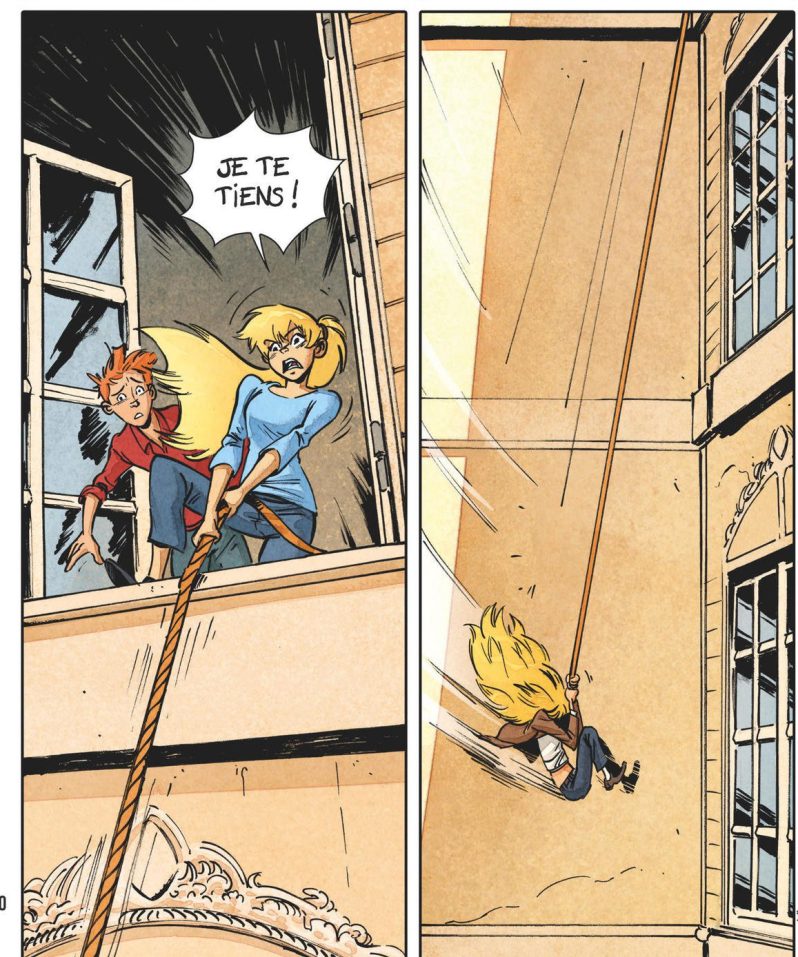
©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Johann : Quand j’ai reçu les pages de cette séquence, je me suis rendu compte que j’avais intégré une équipe de fous furieux. Ça bouge c’est drôle et c’est hyper-fluide et super-lisible. J’me suis dit un truc du genre: « Mais qu’est-ce que je fous là, moi ?!?» ahah !
Justement, quand on parle de couleurs en BD, qu’est-ce que cela vous évoque ?
Johann : La lumière, en premier! Chercher des ambiances, des gammes colorées qui colleront le plus possible aux ambiances des pages noir et blanc tout en laissant la part belle au dessin. Trouver le juste milieu. Ce n’est pas toujours évident mais c’est ce qui fait que c’est intéressant.
Spirou et Fantasio véhiculent-ils des codes de couleurs à respecter ?
Johann : Bien sûr, on peut difficilement y couper. Tout le monde sait que Spirou est habillé de rouge et que Fantasio porte sa veste bleue. Dans cet album, il fallait jouer légèrement avec ces codes sans trop s’en éloigner.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
La couleur aussi joue beaucoup au cinéma, la lumière. Du coup, vous êtes-vous inspiré des tons du film dans votre mise en couleur ? Le trait du dessinateur influence-t-il la manière de coloriser un album ?
Johann : Pour le film, pas tellement, j’avais quelques références, notamment pour la base de Zorglub, mais comme je n’avais pas accès à tout, j’ai dû prendre pas mal de liberté et faire mes propres ambiances et c’est tant mieux, sinon ça m’aurait bloqué.

Repérage du plateau de tournage par Olivier Bocquet
Le trait d’un dessinateur influence toujours mes couleurs, et particulièrement sur cet album. Je ne travaille pas de la même façon sur un dessin réaliste que sur un trait plus léger comme celui de Brice et Alexis. Là, j’ai dû apprendre à simplifier mes couleurs, mes ombres, ce qui n’était pas évident au début, car je n’avais jamais travaillé sur ce genre de dessin. Mais ils m’ont bien coaché et après une dizaine de pages j’ai commencé à me sentir plus à l’aise et à me faire plaisir.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Vous parliez de l’atelier. J’imagine que, quel que soit l’album, les planches circulent.
Alexis : Officiellement, on a collaboré de la même manière sur un tome de Carthago Adventures. On a aussi un polar Steampunk pour Glénat parmi nos projets. Mais, officieusement, les planches de chacun de nos albums ne sortent pas sans le coup d’œil de l’autre.
Brice : Ça fait dix ans que nous fonctionnons comme ça.
Alexis : J’ai encré un peu dans FRNCK, d’ailleurs !
Brice : Cet atelier, ce ne sont pas juste deux personnes qui font leur boulot, grâce au logiciel de conversation, on a une dizaine d’invités qui interviennent, comme Yoann Guillo ou Johann Corgié.
Johann : C’est d’ailleurs comme ça que je me suis retrouvé à intégrer l’aventure Spirou, entre 2-3 partages de pages sur le logiciel, ils me sortent innocemment un « on a un truc pour toi, tu peux pas dire non ! »… j’ai pas pu dire non!
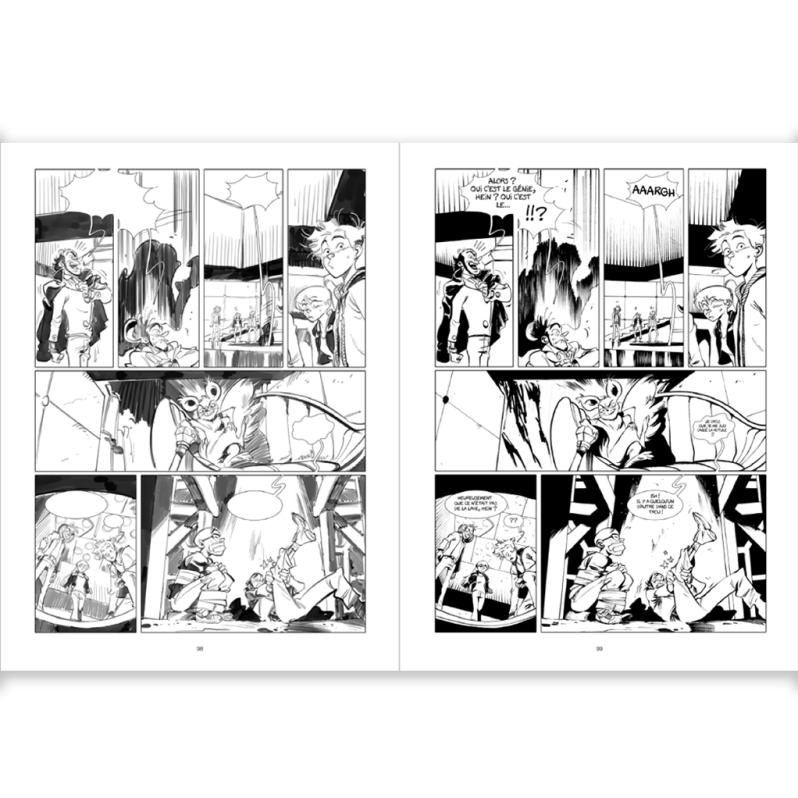
©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié dans le tirage de luxe aux Éditions Khani
En tant que coloriste mais aussi dessinateur, l’envie n’est-elle pas parfois forte de rajouter des détails ?
Johann : C’est tout le souci, et c’est frustrant par moments. Si j’en fais trop, ça charge le dessin et ce n’est pas forcément lisible. Tout est une question de choix et de sacrifices, mettre au premier plan l’information essentielle et suggérer le reste, guider le regard du lecteur. Le chemin est déjà bien balisé par la narration du/des dessinateur(s), il faut se débrouiller pour appuyer ça. Du coup j’essaye de compenser en travaillant mes ambiances et mes lumières, particulièrement sur les décors. C’est eux que je préfère mettre en couleurs.
Et pour vous, Brice et Alexis, N’y a-t-il pas des frustrations à fonctionner avec un qui crayonné, l’autre qui encre ?
Brice : Non, cela s’est fait en accord parfait.
Alexis : La frustration, pour moi, c’est peut-être de ne pas avoir eu le temps de storyboarder concrètement, en fait. Mais sinon, il n’y a pas d’égo.

©Bocquet/Cossu/Sentenac
Et finalement, Spirou, pour vous, c’est qui ?
Alexis : Sans hésiter, celui de Franquin.
Brice : Tome & Janry, de mon côté. Ce n’est qu’après que j’ai lu les autres auteurs de Spirou. Avec comme Graal, la couverture de Machine qui rêve qui m’avait fait une espèce de choc.
Johann : Tout pareil que Brice, Tome & Janry et Machine qui rêve qui m’a particulièrement marqué. Un album un peu à part.
Alexis : C’est vrai que Machine qui rêve, c’était quelque chose. Janry est d’ailleurs le seul auteur à qui j’ai baisé les pieds, un jour. Pendant qu’il jouait de la gratte.
Brice : J’ai les photos. Pour revenir à ce qu’on disait, les puristes diront que non mais quand un héros atteint les 80 ans, c’est important de le voir évoluer. Même si, pour le coup, ce qu’en a fait Franquin est extrêmement moderne. La manière dont la Turbotraction est documentée, la maison de Spirou et Fantasio. Et dire que tout ça a été inventé dans les années 50, nos parents venaient de naître !
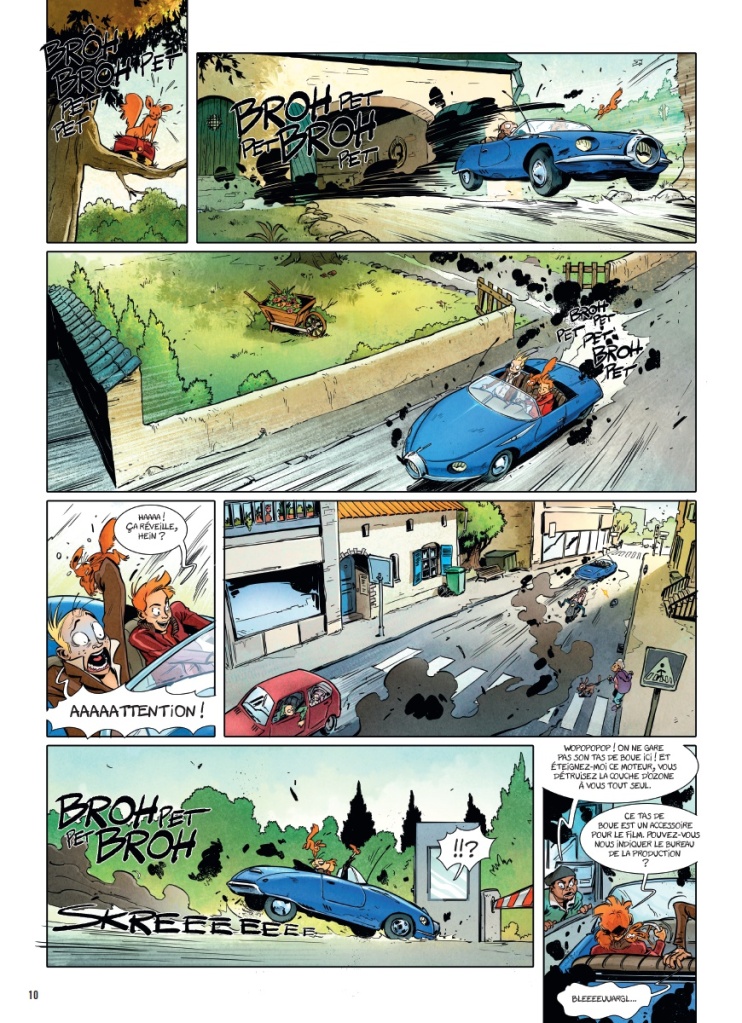
©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Alexis : Et pourtant, on n’a rien eu à changer pour coller à l’époque.
Brice : Je pense qu’on a dû rajouter un tapis.
Olivier : Je ne me prononcerai pas sur le dessin, mais d’un point de vue scénaristique — et même si je n’ai pas tout lu — je trouve que les albums de Tome & Janry sont extrêmement solides. On pourrait les sortir aujourd’hui sans problème alors que certains ont plus de 30 ans. Ce n’est pas le cas de la plupart des scénarios de l’époque Franquin, qui sont très bien « pour l’époque », mais qui aujourd’hui ont pris un coup de vieux. J’aime beaucoup le travail de Vehlmann aussi.
Et dans les auteurs plus récents, qui vous a marqués ?
Brice : Frank Pé et La lumière de Bornéo. C’est super de le voir apporter sa patte. Puis, Feroumont, aussi.
Johann : Celui d’Émile Bravo! Autant pour le dessin que pour l’histoire.
Alexis : Après, je trouve que certains ne racontent pas des histoires de Spirou. C’est moins intéressant de sortir Spirou de son univers pour raconter des histoires qui ne sont pas les siennes. Spirou, c’est de l’aventure, de l’humour, faut pas chercher à en faire autre chose. Ce n’est pas comme Mickey qui s’est baladé dans tous les genres et univers. Après, c’est vrai que Machine qui rêve a su amener un ton s-f, mais en restant dans l’univers Spirou. Quand on te prête un super-jouet comme Spirou, ce n’est pas pour lui mettre les bras de Goldorak.
Olivier : C’est un peu le cahier des charges que je me suis imposé. J’aurais pu me contenter de faire un album qui se passe sur le tournage du film, avec juste une suite de gags. Un truc uniquement sur les coulisses du cinéma, le star-system, les effets spéciaux… Mais ça n’aurait pas été un album de Spirou et Fantasio. Je voulais qu’il y ait quand même un parfum d’aventure, un sentiment de danger. D’où les cascades, la marche dans le désert, la course contre la montre à la fin… Moralité : j’ai des pages et des pages de notes sur des gags en rapport avec le cinéma qui ne m’ont pas servi. De quoi faire un album entier !
Et Zorglub alors ?
Brice : C’est un personnage hyperintéressant, si bien qu’il perd son rôle de méchant dans certaines aventures.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Alexis : Un mal-aimé. Mais c’est ce qui est chouette avec les personnages pas manichéens, pas parfait.
Brice : Le capitaine Haddock en est un. Il est bourru, peut taper. Il pourrait être un méchant en fait. Sinon, je suis vraiment fan de ce qu’en a fait Munuera. Et je peux vous dire qu’Olivier râle que Munuera ait eu cette idée (rires). Il aurait tant aimé. Mais, qui sait, peut-être dans un Zorglub vu par ? Tout se peut maintenant dans l’univers Spirou.
Olivier : Ah oui ! Travailler Zorglub en personnage principal, c’était la bonne idée ! Je suis très jaloux, mais je me dis que j’ai quand même fait trois albums sur Fantômas, donc ça va, question méchants mythiques je n’ai pas à me plaindre.

Repérage du plateau de tournage par Olivier Bocquet
Rayon amour, Fantasio et Seccotine s’embrassent.
Brice : En fait, on pensait que ça s’était déjà vu dans la série.
Olivier : Je n’étais pas sûr que ça n’était pas arrivé. Mais bon sang, c’est électrique depuis tellement longtemps entre ces deux personnages ! Donnez-nous enfin ce baiser !
Alexis : Résolument, Spirou ne pouvait pas faire ça.
Brice : Il est asexué, comme Tintin.
Alexis : Mais Olivier, ça ne fait pas si longtemps qu’il est dans la BD et je trouve qu’il a développé une finesse qui s’apparente à celle de Goscinny, capable de parler de thèmes contemporains comme la position de la femme, l’économie puis des dialogues adhoc, avec la force de la phrase-choc.
Olivier : Et puis bon, que raconte cet album ? Il y a une poignée de Gardiens Du Temple sur les forums BD qui pensent que, parce que c’est un travail de commande, on n’a rien à raconter et que l’album est « torché », tant au niveau du scénario que du dessin. Au passage, si des Gardiens du Temple lisent cette interview : je vous dis zut.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Mais il y a une vraie histoire dans cet album. C’est celle de Fantasio qui se trouve trop vieux et trop ringard et qui voudrait tellement être jeune et beau et cool. Il en souffre vraiment, c’est pour ça qu’il est si souvent en colère, jaloux, qu’il fait des conneries, par exemple avec ses cheveux ou en entraînant ses amis dans le désert pour se prouver qu’il est un aventurier. Je voulais montrer la trajectoire de ce personnage déprimé de ne pas être « à la hauteur » alors que, dans les faits, c’est un héros. Maladroit certes, mais un vrai héros. Et il fallait que quelqu’un lui dise à la fin de l’album, un peu au nom de tous les lecteurs : « On t’aime comme tu es. Tu es le meilleur Fantasio possible ». Je voulais que cette scène compte, autant pour le lecteur que pour Fantasio. Voilà le pourquoi de ce baiser.
Dans le même ordre d’idée, voilà Spirou qui se retrouve pickpocket pour les besoins du film.
Alexis : Oui, sur ça, j’étais assez dubitatif.
Brice : D’où l’idée de voir comme Spirou réagirait à ce synopsis, en étant gentiment moqueur du film…

Olivier : Pour moi ça a été le déclic pour le scénario. Comment ont-ils pu faire de Spirou autre chose qu’un groom ? Pour l’équipe du film c’est très clair et très assumé : au début c’est un mauvais garçon qui devient un gentil groom à la fin du film. Et franchement, dit comme ça, ça se tient. Mais du point de vue de l’accueil public, il y avait quelque chose de suicidaire à oser un truc pareil. Déjà que toute adaptation de BD franco-belge au cinéma se fait démolir au lance-flammes par principe, là c’était vraiment chercher les coups. Pour moi en tout cas, c’était un beau point de départ : mettre les personnages face au « scandale » de la façon dont ils sont traités par le cinéma.

Repérage du plateau de tournage par Olivier Bocquet
Brice : Et là, la production a été super, ce n’était pas si évident d’accepter notre projet.
Vous allez jusqu’à parodier les logos de célèbres studios cinématographiques.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Alexis : Moqueur du film mais aussi de l’industrie du cinéma.
Brice : Après, quand on fait un Spirou, il faut aussi gérer les à-côtés, la promo. Il faut des visuels. D’où les logos qui nous ont bien amusés. Une deuxième couverture aussi.
Brice : Et là, la production a été super, ce n’était pas si évident d’accepter notre projet.
Avec un cahier des charges ?
Alexis : Non, sinon le fait que le film soit intégré.

Repérage du plateau de tournage par Olivier Bocquet
Et dans le film, la possibilité d’utiliser la richesse de Franquin, de la Turbotraction au Fantacoptère.
Alexis : Mais je pense qu’Olivier n’a pas su dire tout ce qu’il voulait.
Brice : Il importait de faire le lien, de recouper les scènes pour qu’elles fassent écho au film, sans taper dessus non plus. Mais Olivier n’a pas pu s’empêcher de faire référence à certains éléments. Puis, on n’a pas su tenir les 54 planches, on en a fait… 55. Une de plus.
Alexis : Mais, sans date-butoir, je pense qu’on aurait fait 64 voire 72 planches ? Et là, ce serait devenu un Spirou à part entière.
Olivier : C’est sûr que si on avait eu plus de temps, on aurait développé certains trucs. Il y a des pans entiers de l’histoire que vous ne lirez jamais. Ça me donne quelques regrets, mais ça fait aussi un album vif, nerveux, tout le temps dans l’urgence… Au moins, on n’a pas le temps de s’ennuyer !
La différence entre le mythe et la réalité peut-être parfois bidesque… pour Fantasio. Pourquoi un tel bide ?
Olivier : C’était raccord avec l’histoire qu’on voulait raconter, et la question le dit très bien : le ventre de Fantasio, sa calvitie, la TurboTraction qui ne passerait pas le contrôle technique, c’est l’écart entre le mythe et la réalité. On n’a pas fait le classique « Ah je vous imaginais plus grand », parce que ce qui nous intéressait ce n’était pas le regard des autres mais le regard d’un personnage public sur lui-même.

© Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Évidemment qu’une star n’est pas aussi parfaite que ce qu’on perçoit d’elle. Ça doit être assez compliqué pour elle de se voir tous les jours dans le miroir si différente des affiches de film ou des pochettes de disque… Une meuf comme Beyoncé, qui se montre systématiquement vêtue de trucs immettables, surmaquillée, surcoiffée… Chacune de ses apparitions est calibrée au millimètre mais vous croyez qu’elle a quelle tête, au réveil ? Elle sait très bien qu’elle n’est pas l’elfe immortelle que tout le monde imagine, ni physiquement ni mentalement. Ça doit être super déprimant parfois, d’être aimée pour son image et pas pour ce qu’on est réellement. Je prends l’exemple de Beyoncé uniquement pour augmenter la visibilité de cette interview dans les moteurs de recherche, mais vous avez compris l’idée.
Par contre, un qui risque de maigrir, c’est FRNCK, dans le troisième album, ne deviendrait-il pas un peu végan sur les bords ?

© Bocquet/Cossu
Olivier : Carrément. Je sais que Franck n’est pas le seul personnage végétarien de la BD, mais je ne sais pas si on a déjà montré un omnivore devenir un végétarien, comme lui. Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur le personnage et sur ce que nous, fragiles occidentaux ultra-protégés, sommes prêts ou pas à accepter pour garder notre confortable mode de vie. Régulièrement, on se scandalise de ce qui se passe dans les abattoirs mais il y a une dissociation qui fait que la plupart d’entre nous continuent de manger de la viande. Comme si « l’abattoir que j’ai vu sur internet » était une exception. Mais comment voulez-vous tuer de façon « humaine » trois millions d’animaux par jour ? Relisez bien ce chiffre : trois millions d’animaux sont tués chaque jour, rien qu’en France, pour être mangés. Je suis prêt à parier que si, comme Franck, on devait tuer nous-mêmes chaque animal qu’on mange… eh bien on mangerait beaucoup moins de viande !
Frnck qui a retrouvé des voyelles. Pourquoi ? Le concept n’était pas viable ou trop redondant à long terme ?
Olivier : Le gag des voyelles qui manquent était une façon marrante de traiter le problème de communication qu’aurait un voyageur dans le temps s’il rencontrait des humains préhistoriques, mais sans que ce soit un handicap insurmontable. J’aime trop les dialogues pour m’en passer pendant toute une série. Et puis le fait que les préhistoriques maitrisent les voyelles ne signifie pas qu’ils maitrisent super bien notre langue. Ça peut donner lieu à des dialogues rigolos, comme des périphrases complexes pour dire des choses simples, ou des contresens… C’est beaucoup plus riche que de simplement retirer les voyelles !
Tiens, puisqu’on en parle, vous n’avez pas trop osé la zorglangue dans cet album ?
Olivier : Non, c’est vrai. Je trouve que c’est un gimmick marrant mais ça n’aurait rien apporté à l’histoire. Je ne voulais pas m’en servir que « parce qu’il faut le faire », il me fallait une bonne raison. Je n’en avais pas.
Sinon, vous préparez le terrain pour un autre film : FRNCK ? Il y a une affiche qui se promène dans votre Spirou.

© Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis
Brice : Ahahahah, on adorerait, c’est vrai, peut-être plus sous forme de dessin animé. Mais on a le temps, la série est encore jeune. Après, pour tout vous dire, cette affiche de FRNCK – la comédie musicale, c’est une blague de notre coloriste, Johann Corgié, qui, à notre insu, a ajouté ce clin d’œil. On l’a découvert à l’impression, ça nous a bien fait marrer.
Johann : Ils ont laissé plein de cadres vides dans l’album en me disant « mets ce que tu veux dedans ». C’était ça ou l’affiche de Teminator 32…
Olivier : Vous allez voir que ça va devenir réalité. Moi je verrais bien une franchise hollywoodienne. Steven, si tu nous lis…

© Bocquet/Cossu/Sentenac
Tant qu’à parler de cinéma, on peut parler de FRNCK mais aussi de La colère de Fantomas. Le projet d’adaptation tient toujours ? Et, en BD, la possibilité d’un préquel ?
Olivier : Pour l’adaptation cinéma, c’est toujours dans les tuyaux, mais c’est très incertain, très long, très complexe. Je ne suis pas sûr que ça se fera un jour. Et pour la BD, il n’y aura pas de prequel — en tout cas pas fait par Julie Rocheleau et moi — mais je garde l’espoir de faire la suite ! J’ai encore de quoi écrire deux autres cycles. Ça pourrait fort bien se faire une fois que Julie et moi aurons pris un peu de bouteille. Ça aurait plus de sens qu’il y a trois ans. On était débutants, personne ne nous attendait, la série n’excitait pas les lecteurs au point d’enchainer sur une suite. Mais si nos noms deviennent plus connus, ça pourrait créer une attente.
Finalement, avez-vous quand même l’impression d’avoir fait votre Spirou ?
Alexis : On a fait le nôtre oui, ensemble, mais ce n’est pas « le mien » 😉
Brice : La « Bocossengié » touch ouais je pense aussi.
Olivier : je n’avais aucun projet pour faire un Spirou, donc c’est tombé un peu par accident sur mon parcours. Je ne sais pas encore si c’est « notre » Spirou, mais je suis content du résultat.
Johann : Pareil, c’était la proposition qui sort de nulle part, et comment refuser ? Spirou quoi ! Et la possibilité de faire un vrai travail d’équipe. Donc oui, un Spirou « à nous »
Et si vous aviez une seconde opportunité, où l’emmèneriez-vous ?
Olivier : J’ai eu deux idées pour Spirou et Fantasio. L’une est en train d’être faite par quelqu’un d’autre et je ne peux absolument pas en parler. Et l’autre, j’aimerais peut-être la faire un jour mais je ne veux absolument pas en parler.
Brice : À la préhistoire ?? ( rires)
Johann : Le mien, je le ferais sans trait, avec uniquement de la couleur, c’est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. Un peu comme La boîte à musique qui vient de sortir chez Dupuis. Et pourquoi pas emmener Spirou et Fantasio dans une aventure pleine de cités perdues, d’anciennes civilisations et de mystères mystérieux… mais je m’égare.
Ah non, c’est plus qu’intéressant. Quels sont vos projets, prochains albums ?
Olivier : Après Transperceneige Terminus (2015), je sors ce mois-ci Ailefroide, un nouvel album avec Jean-Marc Rochette chez Casterman. Il s’agit d’une autobiographie de Rochette sur ses jeunes années d’alpiniste. Je l’ai écouté me raconter cette période passionnante de sa vie et j’ai mis tout ça en forme pour que ça devienne un vrai scénario de BD. Inutile de dire qu’il a mis tout son cœur et tout son talent dans cet album. Un très gros morceau, très personnel en ce qui le concerne mais aussi très universel, à mon avis. Le passage d’un ado à l’âge adulte… mais en risquant sa vie tous les jours.
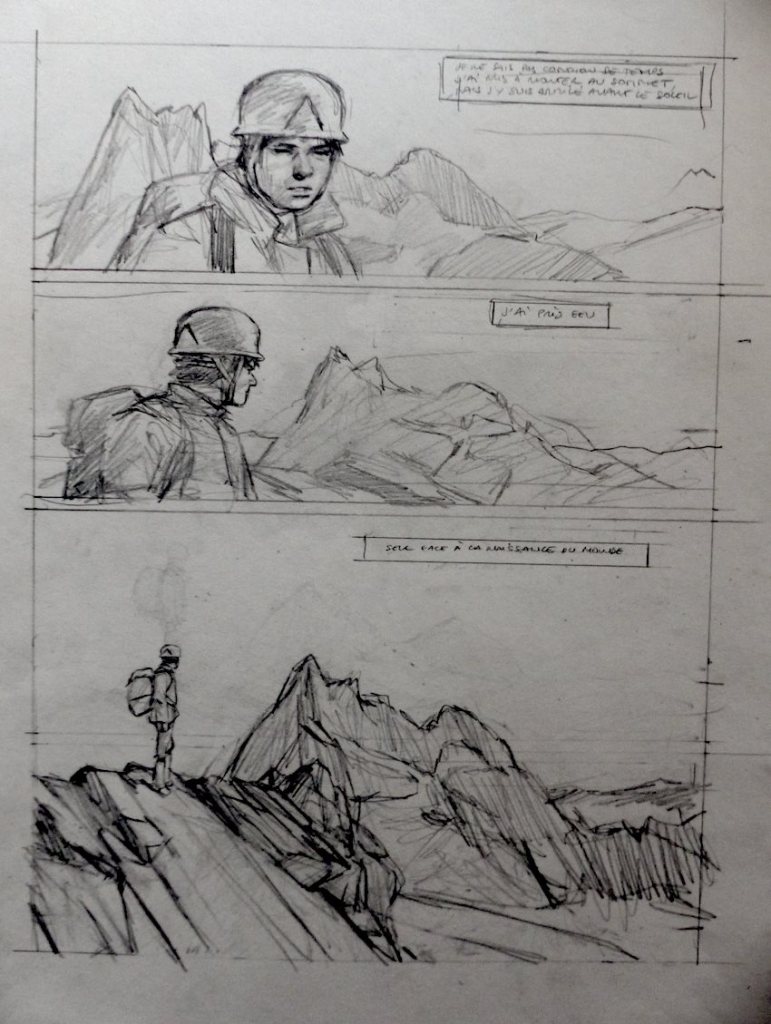
© Bocquet/Rochette
En mai sort Le Tailleur de Pierre chez Casterman, avec Léonie Bischoff au dessin. Notre troisième et dernière adaptation de Camilla Läckberg. L’album a plus d’un an de retard suite à des problèmes de coloristes, mais il devrait enfin sortir ! Mais ces deux albums ont été écrits en 2016. Depuis presque un an et demi, même s’il y a eu la parenthèse Spirou et Fantasio, je me consacre en priorité à Frnck. On est à plus de la moitié du tome 5 avec Brice et a priori on en a encore pour quelques années sur cette série !
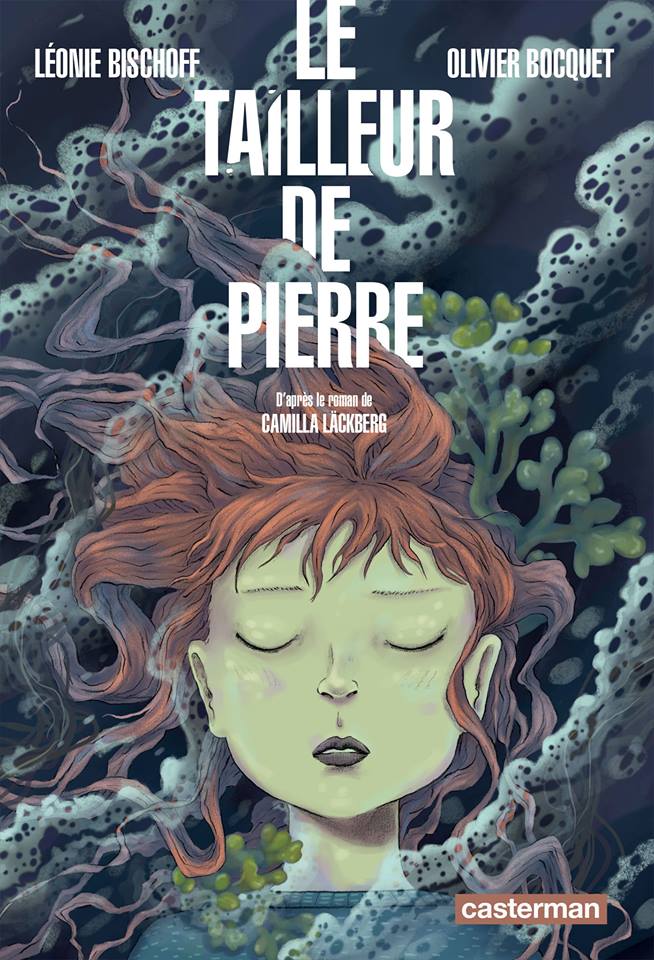
© Bocquet/Bischof chez Casterman
Alexis : je retourne dans la SF avec l’adaptation de NOÔ, un roman de Stefan Wul, scénarisé par Laurent Genefort.
Brice : Comme dit Olivier, je suis à fond sur FRNCK pour l’instant.
Johann : Je viens de finir mon premier album au dessin après des années à ne faire que de la couleur. « Les lumières de l’aérotrain » avec Aurelien Ducoudray au scénario, un one shot à paraître chez Bamboo Grand Angle, courant Juin. L’histoire d’une bande de jeunes dans un trou paumé qui font les 400 coups et qui vont voir leur quotidien de jeunes branleurs être bousculé par l’arrivée d’une nana. Et ça devient bien moins drôle.
Puis, une histoire courte horrifique chez Akileos pour le Free comics day. Et pour la suite… j’attends de voir si on me propose quelque chose.
Merci à tous, on attend tout ça avec impatience.
Propos recueuillis par Alexis Seny
Série : Spirou et Fantasio
Hors-série
Libre adaptation du film d’Alexandre Coffre
Titre : Le triomphe de Zorglub
Scénario : Olivier Bocquet
Dessin : Brice Cossu et Alexis Sentenac
Couleurs : Johann Corgié
Genre : Aventure, Humour
Éditeur : Dupuis (édition de luxe chez Khani)
Nbre de pages : 60
Prix : 12€

Au fil des pages du journal Spirou, on avait plongé dans son regard violet. Puis, dans un dernier clin d’oeil, les aventures de Violine s’étaient arrêtées net. Avec un goût de trop peu. D’autres héros l’avaient chassée de nos esprits mais son souvenir revenait à rythme régulier, culte oserait-on dire. À bon escient puisqu’elle comptait revenir, sous une autre forme graphique qui n’a en rien étouffé sa témérité. Nous avons rencontré son papa, Didier Tronchet qui anime désormais le destin de sa protégée toujours en danger avec le Baron Brumaire dans une série qui n’est plus éponyme mais porte le nom on ne peut plus équivoque : Le troisième Oeil. Allez, hop, on part en voyages.

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Bonjour Didier, c’est une sacrée surprise que vous nous faites là, on ne s’y attendait pas à ce retour de Violine, quasiment dix ans après le dernier épisode.
C’est difficile de résumer ce long chemin. J’étais parti avec Dupuis sur une série pour enfants. Chemin faisant, j’ai connu tous les aléas qu’on peut connaître en tant que scénariste d’une série. Le premier dessinateur s’est démotivé et a quitté le projet, il a fallu deux-trois ans pour qu’un nouvel album paraisse avec Krings aux commandes, dans son élément. Même si le temps était un ennemi, le principe fonctionnait et l’accueil était bon. Mes enfants mais aussi ceux de mes amis adoraient. Mais, alors que nous préparions le sixième album, Le Sommeil empoisonné, notre éditeur a décidé de stopper la série.

© Tronchet/Krings chez Dupuis

© Tronchet/Baron Brumaire chez Casterman
Et dix ans sont passés. Pourquoi teniez-vous tant à la faire renaître, différente tout de même car désormais adolescente, votre héroïne.
C’était mon engagement dans le monde du récit jeunesse. Moi, je ne suis pas réputé pour ça, on me définit plus volontiers comme corrosif, cynique, dans la dérision. La BD jeunesse, c’est un espace d’expression détaché de tout second degré, avec un public intéressant à toucher, un public encore en devenir, auquel on peut poser des questions, semer des petites choses pour favoriser un terreau d’ouverture d’esprit. Si la base est fun, nous avons une responsabilité en tant qu’auteurs. Les centres d’intérêt ont beau être volatiles, on peut concentrer les choses. La fiction rend le réel plus digeste en passant par l’émotionnel, le ludique aussi.

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Je pense notamment aux migrants dans nos pays. Si on en parle de manière dramatique avec des statistiques, de l’économie, comme le font les journaux, comment voulez-vous que les gens comprennent. Mais si on suit un migrant sur sa route, avec une capacité importante à s’y identifier, ça rend cela plus humain. Plus que de les voir de loin à la télé. Je crois beaucoup en ce mode de récit, en sa faculté à ne pas relâcher le lecteur indemne de sa lecture. Je suis atterré des outils scolaires déployés, par contre. Je ne comprends pas comment on peut raconter le mode avec des outils aussi datés.

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Alors, je tente que ça soit plus fructueux avec mes outils de narration. Modestement, hein, il faut se méfier des mots, des intentions. Je pense que chaque auteur a sa petite part de boulot mais si chacun réussit son coup…
Mais, si dix ans ont passé, n’avez-vous pas eu le réflexe, en écrivant cette suite, de revenir à la petite Violine des cinq premiers albums ?
Disons que ça m’a aidé d’avoir eu des enfants qui sont passé par cette phase. Comme ma fille qui a trente ans, aujourd’hui. Je voyais comme l’adolescence fonctionnait, je m’aide beaucoup de ma vie personnelle. Si je préfère l’imaginaire, je n’ai pas de souci à ce qu’il s’appuie sur des éléments concrets. À chaque fois que j’ai un doute, je me recentre sur ce que je vis, mon ressenti.

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Violine demeure votre seule série jeunesse, pourquoi ne pas lui avoir donné un frère ou une soeur, d’autres séries dirigées vers ce public ?
C’était compliqué, il y a déjà tellement de séries jeunesse. Puis, surtout, j’ai mis toute mon énergie dans le premier cycle, et maintenant le deuxième, de mon héroïne.
Cette fois, changement radical de style, mais, dites-moi, vous n’avez jamais pensé à la dessiner, Violine ?
J’en suis incapable, mon dessin n’est pas adapté, ni plaisant ni rassurant pour le public auquel Violine est consacrée. Il fallait un plus grand dépaysement et j’aurais été incapable de dessiner les décors indiens. Moi, je suis plus statique, il fallait qu’un autre dessinateur s’empare du sujet.

© Tronchet/Brumaire
Du coup, c’est le Baron Brumaire qui prête vie et traits à Violine.
On est très loin de Krings, c’est sûr. Mais c’est voulu, je voulais organiser une rupture par rapport à ce qui aurait pu être une vague reprise. Je voulais montrer qu’elle n’était plus l’enfant qu’elle était quand on l’a laissée en stand-by et arrêter le lien post-Spirou. Le Baron possède un grand dynamisme, une telle modernité, de la vigueur. C’était radical et il s’est imposé. Je l’avais rencontré du temps où j’étais rédacteur en chef de l’Écho des Savanes, je l’avais apprécié. Et quand on a réfléchi au deuxième cycle de Violine, il a fait quelques tests tellement excitants dans des décors indiens.
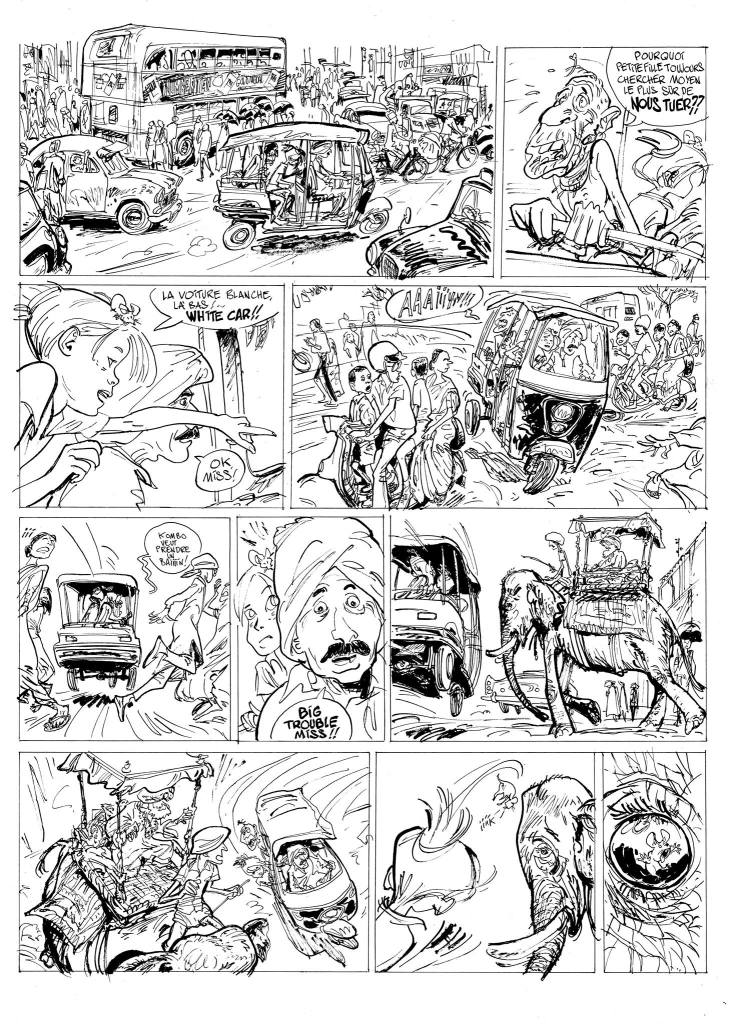
© Tronchet/Brumaire
Je trouve injuste qu’avec son art si personnel, il n’ait jamais eu vraiment l’espace pour l’exprimer au mieux ! Alors, j’espère que cette série le fera reconnaître.
Là, pour le coup, dans ce premier tome, on n’y est pas encore en Inde.
Attendez, vous allez voir ! Le Baron a un dessin très jeté, une énergie…
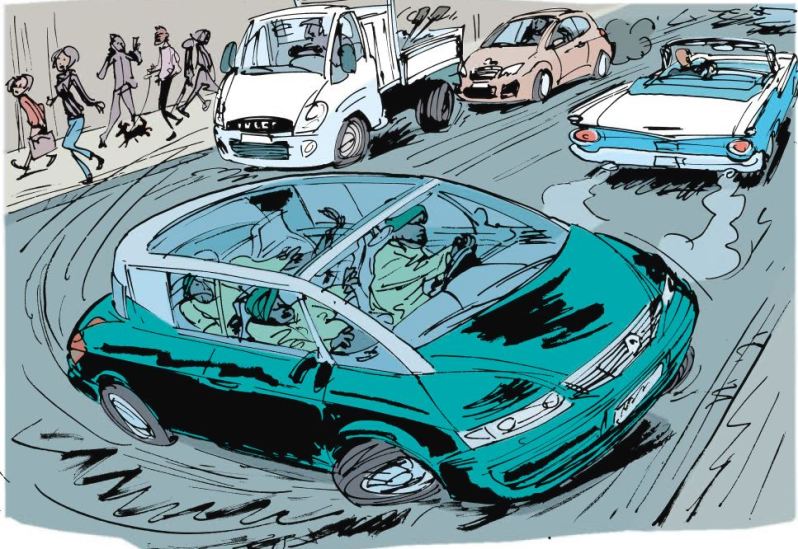
© Tronchet/Brumaire chez Casterman
… à tel point qu’il immerge assez bien le lecteur, c’est à lui de compléter le trait, de faire vivre encore un peu plus les personnages.
Il y a de ça, le trait n’est pas fini, pas léché ni fermé. Il n’est pas référencé comme d’autres auteurs, le Baron a une patte indéniable.
Puis, c’est aussi une façon d’oublier le premier cycle, de repartir à zéro sur ce deuxième. Je ne sais d’ailleurs pas si le lecteur de l’ancienne version sera au rendez-vous. Peut-être sera-ce l’occasion de toucher un autre public ?

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Dix ans, ça fait une longue ellipse… Vous savez ce que votre personnage a fait durant tout ce temps ?
Éh bien, écoutez, j’aimerais bien le savoir. J’aime à penser que les héros sont autonomes et vivants. Qu’ils n’ont pas toujours besoin de nous. Ce serait même désolant de savoir tout de leur vie, de leurs moindres secrets. Violine, c’est comme une amie qu’on retrouve, qui nous contacte et nous dis : « J’ai plein de choses à te raconter depuis la dernière fois. »

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Alors, voilà, on l’a retrouvée, elle est « posée » à l’école après son enfance mouvementée, elle n’a pas cessé d’être éruptive. Son don est toujours bien présent et Violine l’utilise lucrativement auprès de ces camarades d’école, en vendant quelques réponses de devoirs ou d’examens. On ne sait pas ce qui s’est passé durant cette longue période d’absence et il y a toujours la place pour que le lecteur invente, investisse avec sa propre imagination.
Vous parliez de cette amie qu’on retrouve, c’est finalement très cinématographique, comme la relation d’un réalisateur à un acteur fétiche. Mais en conviant le lecteur et en étant moins directif que ce que peut l’être un film.
Mais, ce serait pareil au cinéma, si je faisais un film, je pense. Ce que j’aimerais encore (ndlr. Le nouveau Jean-Claude est sorti il y a plus de quinze ans) … mais ça n’a pas souri jusqu’ici.
Après, c’est vrai que la gloire de la BD, c’est de laisser le temps, c’est très participatif.
Le titre de la série a changé (place au Troisième Oeil) mais le titre de ce premier tome, sur trois, est le même que ce qui devait être votre sixième album de Violine, avec Krings.
Avec Krings, je préparais une suite logique, avec les mêmes personnages du cycle africain. Mais on partait dans une vraie nouvelle aventure…
Déjà avec vue sur le continent asiatique ?
Oui, cet élément était déjà présent. Le premier cycle suivait la piste africaine, le deuxième s’accaparait la piste indienne. C’est une destination fascinante et j’aime bien déplacer notre ami le lecteur dans des endroits qu’il croit connaître pour mieux le surprendre. L’idée, c’est de déplacer le point de vue, de visiter la part d’ombre, celle qui ne va pas de soi dans les images qu’on nous rapporte le plus souvent. Tant qu’on ne l’a pas vécue, la réalité est faussée. Regardez nos enfants, à force de vivre dans un monde d’abondance, ils prennent ça pour acquis et même du. Il faut leur dire: « Attendez, les gars, ce n’est pas ça le monde! ».

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
Vous définissez-vous pour autant comme un globe-trotter ?
Non, ou en tout cas d’une façon particulière. Ma façon de voyager n’est pas celle qu’on conçoit comme un tour du monde à cartes postales et toujours en mouvement. Moi, les destinations que je choisis, je veux y rester un long moment, m’imprégner… J’ai ainsi vécu trois ans en Amérique Latine, au Pérou, en Équateur. Je m’y suis fait des amis, ai acquis une façon de vivre, compris le pouvoir politique en place. J’ai l’impression de savoir un peu plus qu’avant de quoi il retourne.
À cela, j’aime l’idée d’avoir un personnage évolutif. Qui, à dix ans, était en Afrique; à 16 en Inde et à l’âge d’être un jeune adulte en Amérique du Sud, pourquoi pas. On verra. Le deuxième tome sera en tout cas vraiment spectaculaire. Le premier tome pose les enjeux, un petit monde très européen pour pouvoir faire plus grand dans la suite. Le Baron met plein d’énergie mais c’est très exigeant. Ce n’est pas du dessin fait sur un coin de table, il faut aller le chercher cet enthousiasme graphique.

© Tronchet/Brumaire chez Casterman
D’autres projets ?
J’ai passé six mois sur une île de Madagascar, avec mon fils, en totale déconnexion, sans internet ni rien, seulement les gens du coin. Un roman est sorti, Robinsons père et fils et je souhaite l’adapter en BD.
Propos recueuillis par Alexis Seny
Titre : Le troisième oeil
Tome : 1 – Le sommeil empoisonné
Scénario : Didier Tronchet
Dessin et couleurs : Baron Brumaire
Genre : Aventure
Éditeur : Casterman
Nbre de pages : 56
Prix : 11,50€
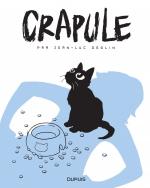
Crapule est un chat, un vrai. Le genre qui porte bien son nom. Dans son appartement au cœur de la ville, il profite d'une vie paisible - ce qui est moins le cas de sa maîtresse... Missions d'exploration dans les placards, amour fou avec les rideaux et séances de câlins incongrues : tout est garanti "100 % vécu" par les propriétaires félins. Servi par un trait léger et expressif, ce one-shot humoristique signé Jean-Luc Deglin est un cadeau à tous les adorateurs de machines à ronrons.
Interview du papa de « Crapule », Jean Luc Deglin
D’où vient l’histoire de «Crapule » ?
C’est une personne, chaleureusement remerciée dans le livre, qui m’a donné cette idée. Le but était de présenter quelque chose de très simple et d’accessible pour les gens qui ne lisent habituellement pas de bande dessinée. Le défi, c’était d’avoir du strip, quelque chose qui soit en dehors et démarqué du cadre habituel de le BD.
Quel est l’accueil du public ?
Je suis content, car en dédicace il y a beaucoup de gens qui me disent : c’est ma première BD, soit des enfants et même des adultes. Il y a des enfants qui apprennent même à lire avec le livre.
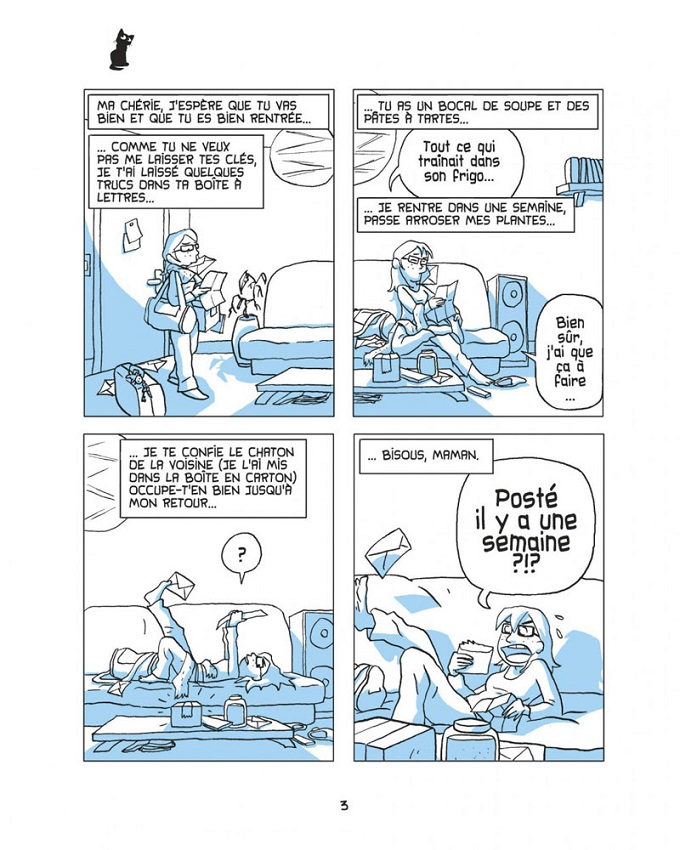
© Deglin - Dupuis
Avez-vous un chat à la maison ?
Oui, j’en ai un. C’est très inspiré de mon chat, qui identique et s’appelle crapule. Plus on est intime avec sa propre expérience, plus on est universel. Je me suis dit plutôt que dessiner un chat lambda je vais dessiner mon chat. Quand j’ai commencé crapule, je ne savais ni dessiner des chats et à peine dessiner les femmes ! Pour moi c’était aussi cela le défi : dessiner une BD avec ce que je ne sais pas faire. Mais j’ai encore beaucoup de progrès à faire pour dessiner les deux ! Du coup je me suis dit pour dessiner une femme et un chat autant dessiner quelque chose qui soit existant. C’est de cette manière que j’ai débuté et c’est ainsi que je continue.
L’idée de recevoir un chat dans une boite et de l’ouvrir une semaine plus tard ?
C’est un artifice de fiction, ce n’est pas une autobiographie. Il vaut mieux éviter l’expérience car cela se garde moyennement dans le carton !

© Deglin - Dupuis
L’histoire est abordable pour un large public ?
Ce qui me fait plaisir, c’est que dans mon public est composé d’enfants de 7 ans et de personnes âgées de 77 ans confirmant le but de départ. Jamais, je n’aurais imaginé qu’ils y aient autant d’enfants parmi mes lecteurs, cela me fait d’autant plus plaisir.
Des gags en une page ?
On a utilisé le même schéma de gag en quatre cases, pas beaucoup de textes ou alors ils sont très lisibles. Je l’ai testé avec ma nièce qui a bientôt trois ans en lui lisant le soir, elle regarde les images et cela la fait beaucoup rire.
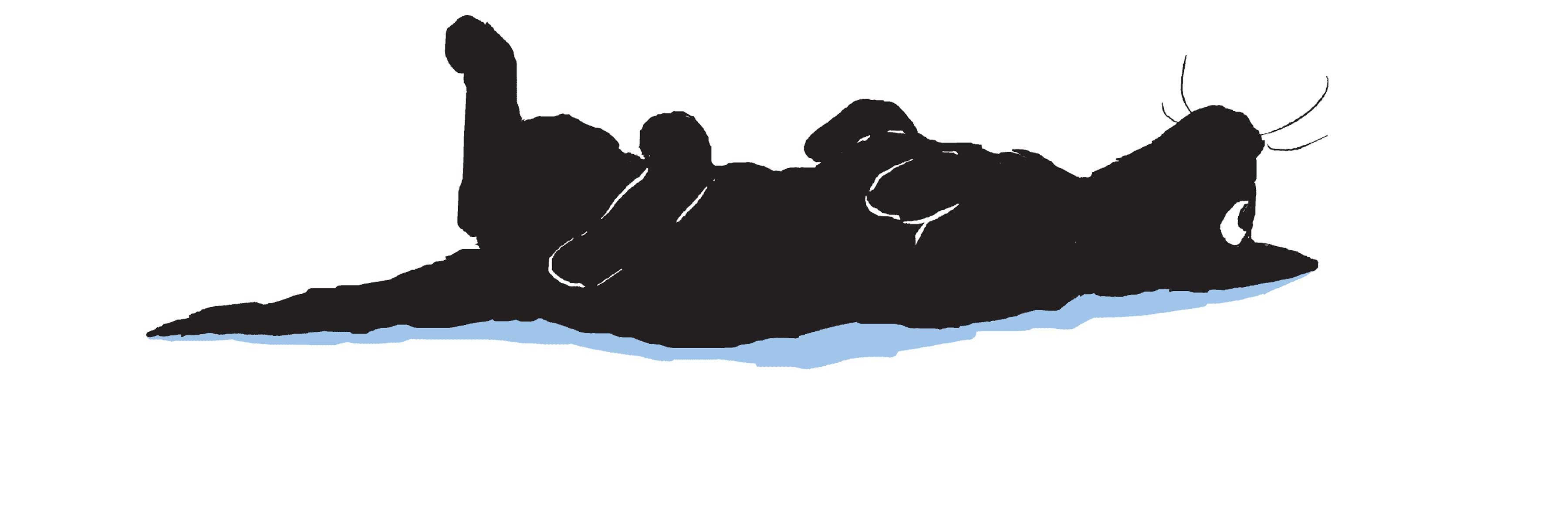
© Deglin - Dupuis
Au plus j’avance dans la lecture du livre, au plus je retrouve ma propre « Crapule » ?
Il y a énormément de BD de chat, je ne suis pas le dernier arrivé. « Crapule », cela a commencé il y a quand même dix ans dans Spirou. J’ai lu aussi tout ce qui est sorti entre- temps avant la sortie de « Crapule ». Il y a quelque chose qui se fait assez peu dans la bande dessinée, c’est représenté un véritable chat. C’est un chat qui ne parle pas, que l’on entend penser et qui se comporte comme un véritable chat. C’est vraiment du visuel, ce qui en fait le succès. C’est vrai que les gens reconnaissent assez facilement les attitudes de leurs chats.
Y a-t-il des éléments que tu voudrais retoucher ?
Plein de choses au début du livre et finalement je me suis dit non, le livre évolue avec mon dessin. Il faut assumer le fait que cela change entre la première et la dernière page. C’est aussi vrai pour les plus grands : si Uderzo dit je ne vais pas refaire mes pages, il faut accepter de laisser partir les planches.

© Deglin - Dupuis
Le choix de la bichromie ?
Vu que c’était du strip, il fallait mettre du décor et se limiter à l’indispensable. Pour la couleur, la seule dont j’ai besoin, c’est le noir du chat qui va me servir à la fois d’ombre et d’ambiance. On peut aussi prévoir le livre à l’international: à traduire cela ne va pas être trop compliqué, il y a peu de texte et les chats sont des animaux territoriaux.
Peut-on espérer une suite ?
Effectivement, je travaille déjà activement à la suite qui devrais sortir pour la fin de cette année.
Avec de nouvelles idées ?
Oui et tout en restant dans l’habitation, l’idée est de conserver un huis clos entre l’héroïne et le chat. Finalement je raconte autant de chose sur l’héroïne que sur le chat, l’idée était d’utiliser le chat pour raconter de l’intime. Ce sont des petits moments de la vie de tous les jours, ces petits moments de rien du tout qui racontent comment on est chez soi lorsque personnes nous observent sauf un chat. Ce dernier est témoin de chose que l’on ne voit jamais, que même une webcam ne montre pas c’est à dire des moments de vie, des moments de rien, des moments où l’on est assis sur un canapé, des moments où l’on a la tête ailleurs. Pour la suite, on va continuer de plus en plus à aller vers l’intime.
Un titre prévu pour le prochain tome ?
Cela va être très simple : « Crapule 2 » quoi que « Le retour de Crapule » où alors pourquoi pas (dans un grand éclat de rire) « La vengeance de crapule »…
Propos recueillis par Alain Haubruge
Série : Crapule
Tome : 1
Dessins : Deglin
Couleurs : Deglin
Scénario : Deglin
Éditeur : Dupuis
Collection : Tous Publics
Nombre de pages : 128
Prix : 14,50 €
ISBN : 9782800174006

Il y a un petit air de Reggiani qui nous parcourt l’esprit au moment d’ouvrir le nouvel album de Flore Balthazar. Seule aux commandes, la jeune autrice s’est plongée dans ses souvenirs de famille pour retourner dans sa ville, La Louvière, au moment de la Seconde Guerre Mondiale. Et notamment via ce que lui en a raconté sa grand-tante Marcelle. Des souvenirs finalement peut-être pas si douloureux que ce qu’on aurait pu le penser. La famille Balthazar, au-delà des privations, n’a pas eu à faire face à des drames trop insurmontables. Ce qui rend finalement le récit peut-être plus léger mais pas moins intéressant, loin s’en faut. D’autant que c’est la vie de femmes comme les autres que Flore suit à la trace et au crayon. Interview.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Bonjour Flore. Alors, ça y est, vous avez franchi le pas du scénario aussi. Du moins sur un album d’aussi longue haleine.
Je n’avais pas le choix. Cette histoire, personne d’autre que moi ne pouvait la raconter. Alors, oui, en effet, j’avais déjà scénarisé des histoires dans le Journal de Spirou mais ce n’était jamais plus qu’une dizaine de planches. J’ai eu un peu peur, 184 planches, ça revient à faire un saut quantique.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Chaque bouquin est un défi en soi: les décors, ceci et cela. Sur mon dessin, je n’ai pas toujours été sûre de moi, je ne voulais pas exagérer. Quant au scénario, c’était un saut dans le vide.
Cette histoire, c’était le meilleur moyen de le franchir, alors ?
Disons que c’était latent, au fond de moi, ça faisait partie de mon éducation. C’est l’histoire de Marcelle qu’on tannait pour qu’elle la raconte. On était fascinés.
Mais, dans certaines familles, le devoir de mémoire n’est pas si évident, il y a des silences, des tabous. Ce n’était pas le cas ici ?
Non, José-Louis Bocquet, mon éditeur, était intéressé par les histoires que véhiculait ma famille. Celle d’André Balthazar, mon grand-oncle, qui avait créé la maison d’édition Daily-bul dans les années 50. José-Louis me tannait. Moi, ça ne me parlait pas des masses. Par contre, s’il y avait une histoire à raconter sur ma famille, c’était celle que j’apprenais entre mes 15 et 20 ans. Cette histoire de famille pendant la guerre, avec des bonnes femmes.
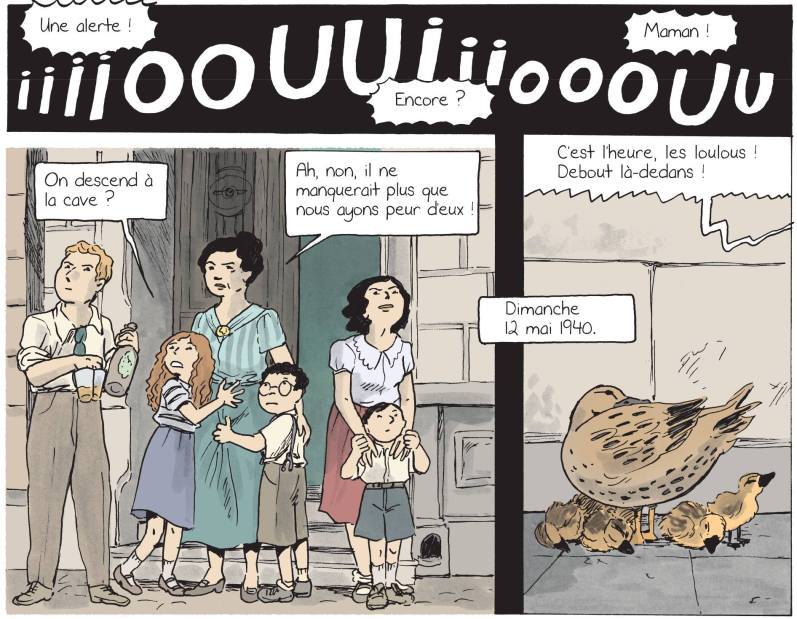
© Flore Balthazar chez Dupuis
Adolescente, ma grand-tante m’a pas mal éduqué, j’allais chez elle après les cours. Au fil des anecdotes, j’ai compris que les années de guerre ont aussi pu être joyeuses. Même s’il y avait des bombardements, même si certains prisonniers étaient emmenés loin. Il y avait une envie de s’amuser, de vivre. Sans doute n’y a-t-il pas eu de tabou parce que l’issue a été favorable pour notre famille, que tous ont échappé à la mort. Les tabous étaient sur d’autres sujets. Mais dans le quotidien de la guerre, il n’y a pas eu de grande catastrophe. Ce n’était pas la Grande Évasion tous les jours. Il n’y avait pas de moto, de toute façon. Non, l’enjeu, c’était par exemple de trouver des patates au jour le jour.
Alors vous commencez votre album par une phrase de Steinbeck.
C’est mon roman fétiche. John Steinbeck, c’est mon écrivain préféré, parce qu’il arrive à amener un côté « quotidien » dans son oeuvre. Rue de la sardine, Tendre jeudi, ce ne sont pas des grandes épopées mais ça touche.
Et cette citation qui, à l’heure où on sent souvent le besoin de la bande dessinée et de ses lecteurs à trancher entre la fiction et le réel, dit que ce n’est pas parce que ce n’est pas arrivé que ça ne peut pas être vrai.
Clairement. Globalement, tout ce qui est arrivé à ma famille est vrai. J’ai oeuvré avec respect, j’ai pris acte des remarques de ma grand-tante, je ne voulais surtout pas la gêner.
Par contre, Marguerite Bervoets, elle n’était pas de La Louvière mais de Tournai. Mais, globalement, les grandes étapes restent les mêmes, classiques. J’ai essayé d’en faire un archétype, une synthèse emblématique des femmes en résistance qui souvent s’occupaient de tâches comme la distribution, la logistique. Forcément, on fait moins attention à la petite-fille qui a l’air inoffensive qu’au grand malabar.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Puis, il y avait la résistance passive, les gens qui étaient obligés de travailler dans la production de charbon. Dès qu’ils le pouvaient, ils tiraient au flanc. Le but pour moi, c’était d’arriver à rappeler les enjeux, c’est bien beau d’écrire une oeuvre, mais je ne pouvais pas ignorer que si on était chopé, ça ne rigolait pas. Il y eut des moments d’occupation plus rigide.
Tout ça me donnait l’espace pour des choses plus intimes: l’avortement, le fait que certaines couchaient avec des Anglais parce que ces temps troublés incitaient à vivre dans l’instant. Certaines femmes faisaient des choses qu’en tant que femmes bien élevées, elles n’auraient jamais faites s’il n’y avait pas eu la crainte de la mort.

© Flore Balthazar chez Dupuis
J’ai mis la fiction et la réalité côte à côte pour que les deux axes s’entremêlent et se répondent, dans l’idée de faire un catalogue de ce que les femmes pouvaient faire à l’époque: de celle qui tombe sous le charme d’un Allemand à celle qui reste sage et s’occupe de sa famille… La voix des femmes a un intérêt pour moi, ce n’est pas ce qu’on a forcément beaucoup raconté… ou que les hommes racontaient à leur place. En tant qu’autrice, c’est important de donner, d’affirmer notre version des choses, là où on continue encore beaucoup de parler à notre place. Puis, c’est graphiquement plus facile, plus naturel de se diriger vers des personnages qui nous ressemblent.
Alors, avec Les Louves, vous nous emmenez aussi en balade.
C’était la réalité de cette région, campagnarde. Au bout de la rue, on se retrouvait très vite à la campagne.
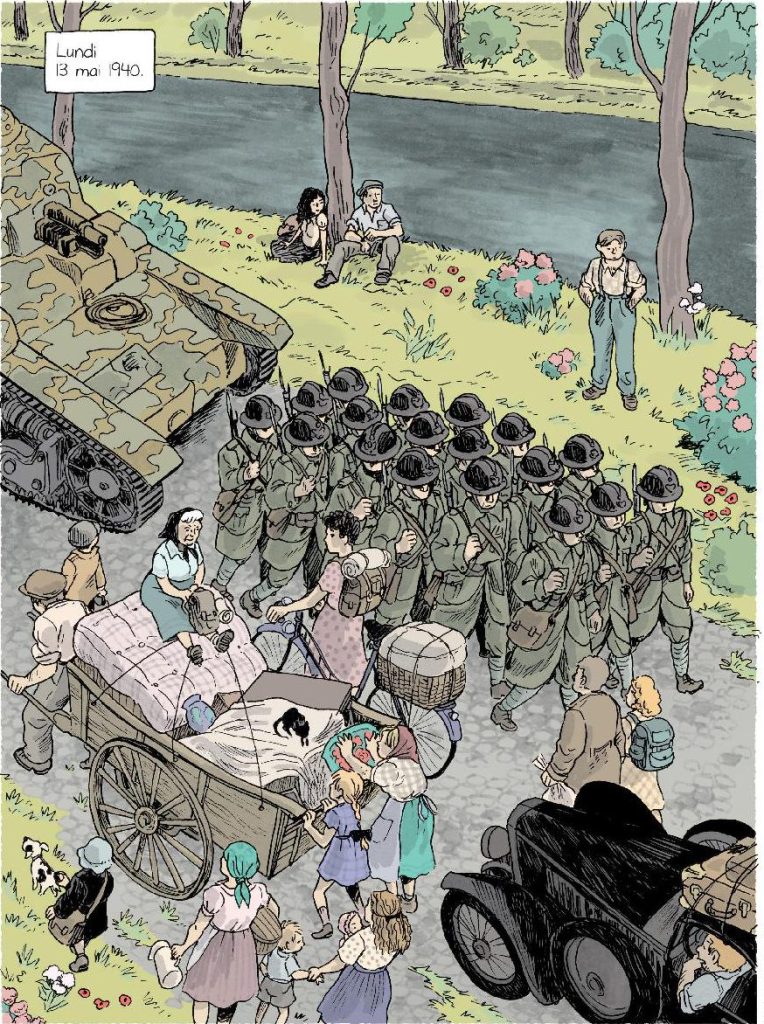
© Flore Balthazar chez Dupuis
La Louvière porte-t-elle encore des stigmates de la guerre.
Dans mon enfance, je vivais à un coin de rue du lieu de l’action. Il y avait encore un bout de terrain vague, un trou d’obus. Dans une des maisons familiales, au grenier, caché, on décelait deux types de briques différentes, celle d’avant-guerre et celle d’après-guerre. On devinait qu’il y avait eu reconstruction. Il faut dire que La Louvière était visée par les Américains qui voulaient atteindre un centre industriel proche. Les Louviérois leur en voulaient un petit peu. À raison: ils visaient très mal ; leur précision de bombardement équivalait à un rayon de 100 km. C’était le tapis, et si la cible était dans le tapis, tant mieux.
Paradoxal, non, qu’ils soient du coup accueillis comme des héros ?
Il y avait un rapport ambivalent. S’ils étaient vus comme des héros, ils étaient aussi des extra-terrestres, grands, bien nourris – plus que ceux qui étaient en guerre depuis des années là où les Américains « n’essuieraient » le feu nazi que durant quelques mois – pas totalement humains. « C’est nin des d’gins » comme nos grands-parents disaient.

© Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière
Les Anglais, pour le coup, nous ressemblaient plus, ils mangeaient mal depuis cinq ans. Bon, après, les gens étaient quand même admiratifs, très américanophiles. Mais ils venaient d’on ne sait où.
Tous, quelle que soit leur nationalité, sont à plusieurs moments du livre, représentés comme des loups.
À part les Nazis qui ont les yeux rouges, c’était une manière de les mettre tous à nu. Si ce n’est que certains boivent du thé, que d’autres râlaient… (elle rit).
Et Les Louves ?
Évident quand on parle de La Louvière, mais aussi parce que mon arrière-grand-mère était une mère-louve, repliée sur sa base. Puis, pendant la guerre, difficile de ne pas faire le rapprochement avec les animaux: la quête de nourriture, d’un abri… Les mecs belges ont bien tenté de protéger tout ça, mais ils ont tenu quatorze jours, disons que les Pantzers étaient plus motivés.
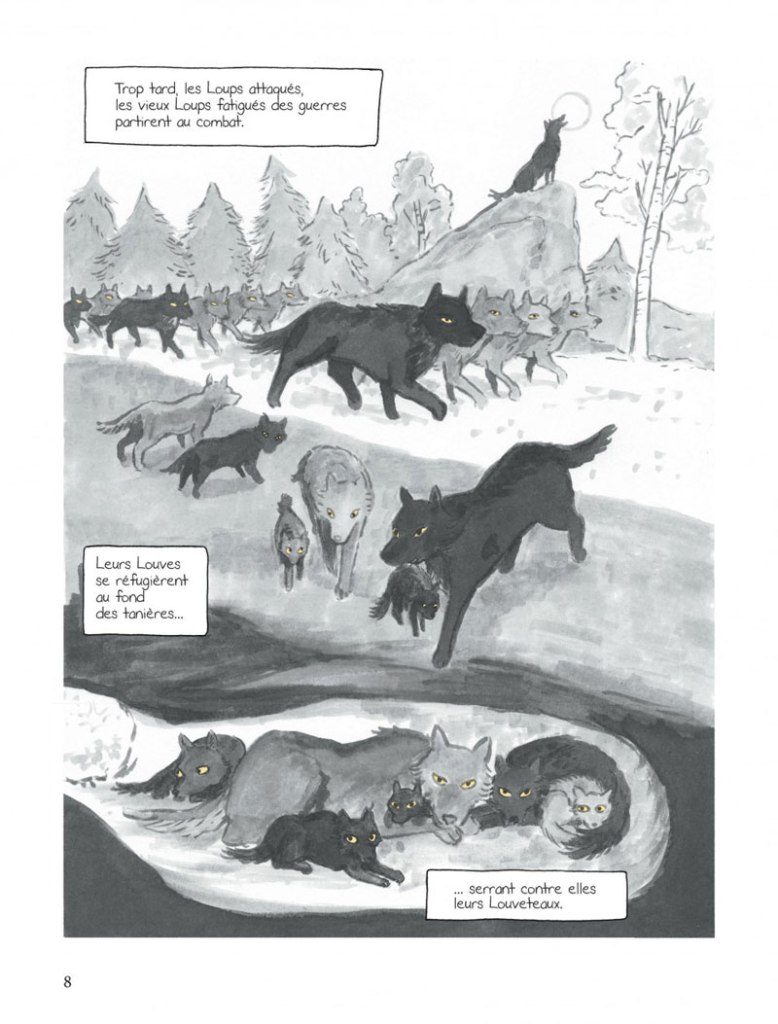
© Flore Balthazar chez Dupuis
Si on parle des occupants, vous faites bien la distinction entre Nazis et Allemands…
Le contre-maître auquel mon arrière-grand-père a eu affaire au stalag était un peu « syndicaliste », par exemple, il défendait les droits des ouvriers, quelle que soit leur provenance.
Il y a ce « ils sont comme nous », aussi.
Oui, certains étaient très endoctrinés, des idéologues forcenés. D’autres étaient contents que l’Allemagne gagne parce que c’était leur pays. D’autres encore ont eu une adhésion forcée aux valeurs nazies, des jeunes avaient été éduqués là-dedans. Un gars de 18 ans en 1940 avait ainsi déjà baigné dans le nazisme durant sept ans. À l’échelle de sa vie, c’était beaucoup. Sans compter, les faits de groupe, les obligations. Des choses qui, au départ, n’étaient pas forcément désagréables.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Cette figure du père, un peu défaitiste. Pas forcément réconfortante, si ?
Il avait été vaincu très vite, au bout de 18 jours. Mon arrière-grand-père était quelqu’un de très bien, très caustique mais pas méchant. Puis, s’il faisait une remarque, les ados se vexaient vite, vous savez. Il y avait autre chose : revenir après deux ans de captivité au Stalag, même s’il était plutôt bien traité, c’était aussi avoir à affronter un monde avait changé, les filles fréquentaient les garçons. Ah, ses précieuses filles.
Sinon, il avait une idée dépassée du fair-play, du combat en uniforme et face-à-face.
Et quand vient la fin de la guerre, les comptes se règlent.
Oui, avec dénonciation, tonte des femmes ayant couché avec des soldats allemands. C’était dégueulasse.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Il faut dire aussi que les Français, les Belges avaient vu leur honneur viril bafoué. Alors, il y avait sans doute là quelque chose d’un réflexe, d’une réaction virilise, de réappropriation du corps de la femme. « Non, vous ne faites pas ce que vous voulez de votre corps. »
Alors que, dans les faits, qu’on couche avec un allemand ou pas, ça ne changeait pas grand-chose, tout juste étaient-ils tous les deux un peu plus détendus, peut-être. (elle rit) Parfois, c’était encore pire que ça, avec des représailles pour des commerçantes qui avaient juste eu le malheur d’être aimables avec l’occupant.
La documentation, où l’avez-vous trouvée ?
J’avais déjà pas mal de documentation familiale, j’ai aussi été rechercher un album photo de La Louvière. Mais, il y a un stade où il faut savoir laisser les choses de côté, se laisser porter. Je ne cherche pas à être précise au numéro près dans une rue.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Et si de La Louvière, je connaissais bien le quartier de ma jeunesse, je ne l’ai pas non plus reconstitué de mémoire, je me suis servi de pas mal de photos. Parfois, on cherche comment représenter un détail, un petit truc flou, ou sous un autre angle… On est bien obligé de bidouiller. D’ailleurs, en discutant avec Thierry Deplancq, l’archiviste qui a rédigé la préface, j’ai vite compris que la gare que j’avais représentée comme celle de La Louvière le chipotait. « Tu es sûre que c’est celle de La Louvière? » Bien sûr que non. Si l’extérieur correspondait, l’intérieur, les quais n’étaient pas documentés. Alors du coup, j’ai fait ceux que je connaissais le mieux, ceux de… Schaerbeek. Je ne suis pas une historienne, je ne vais pas mettre des panneaux dans les cases : « Désolé, je n’ai pas trouvé de photo ».
Puis, il y a cette séquence qui dure presque vingt planches, le gros bombardement. Le rythme s’intensifie.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Quand un obus vous tombait sur le coin de la tête, ça ne rigolait pas. Ce sont des choses qui marquaient, écrites dans les souvenirs de Jacques ou Yvette, dans les archives de Tantelle. Ce genre de chose dont on réchappait avec du bol, en se posant la question de si, en cas d’alerte bombardement, il valait mieux aller dans le jardin ou à la cave. Le jour où il a fallu décider, ils ont choisi la cave. La bombe est tombée dans le jardin ! Il n’y a pas de raison à ça, sinon le coup de bol. Qui a contribué à ce que notre famille n’ait pas été touchée par la tragédie.
D’autres n’ont pas eu cette chance comme le montre l’image la plus gore (et la seule ?) de tout cet album : un malheureux facteur décapité ?
C’est véridique, on l’a vraiment retrouvé dans cet état ce pauvre facteur.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Si on reste à La Louvière mais qu’on prend un aller pour 2018, on peut vous retrouver au Centre Daily Bul & co pour une exposition, jusqu’au 15 avril.
Oui, le public peut y découvrir des planches mais aussi des recherches, les documents dont je me suis servie. Le making-of, quoi !

© Clichés Marcelle Balthazar
Puis, il y a donc cet album qui arrive chez Aire Libre, collection ô combien estimée qui fête ces trente ans.
Oui, et j’ai un certain nombre de coups de coeur dans cette collection. Le Zoo de Philippe Bonifay et Frank Pé, les albums d’Hausman, Will. Puis Blain, Le réducteur de vitesse ! Quand on m’a annoncé que j’allais intégrer la collection, j’ai été un peu gênée. Oh mon dieu ! Au final, c’est un petit Aire Libre dans le format, donc ça va. Mais, c’est vrai, que du beau monde dans cette collection.
La suite, alors ?
On a un nouveau projet avec Jean-Luc Cornette mais ce n’est pas tout à fait lancé. Puis, bon, je ne suis pas rapide. À long terme, je me dis que je me remettrais bien à scénariser un autre album.
On parle beaucoup désormais, et heureusement, des femmes dans le monde de la BD, mais êtes-vous des auteures ou des autrices ? Je me suis laissé dire que vous sauriez m’aider à trancher.
Chacune décide. Moi, pour le coup, je me suis tourné vers « autrice ». C’est le mot historique, « aimablement » viré par l’Académie Française et ses représentants masculinistes.
Auteure, c’est plus un néologisme, s’il démasculinise le terme, il n’est pas logique pour autant.

© Flore Balthazar chez Dupuis
Au-delà de ça, j’utilise également l’écriture inclusive. Ça reste une proposition, une recommandation, dans un langage de tous les jours qui reste très genré. Même si l’Anglais est plus pratique pour ça, c’est important pour moi. Une langue et la manière de l’écrire, ça change la pensée, ça occulte ou empêche d’occulter. On oublie facilement quand on parle du mouvement ouvrier des années 50 que s’il y avait des hommes dans ses rangs, il y avait aussi des ouvrières. Et si on parle d’un mouvement des ouvriers mais aussi des ouvrières, cela donne une autre signification aux choses.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Les Louves
Récit complet
Scénario, dessin et couleurs : Flore Balthazar
Genre : Guerre, Drame, Chronique familiale
Éditeur : Dupuis
Collection : Aire Libre
Nbre de pages : 200
Prix : 18€

1, 2… 1, 2… test… Vous nous entendez ? Bon, c’est vrai, il est plus facile d’émettre aujourd’hui qu’à l’époque de ces bonnes vieilles radios pirates, vectrices d’une libéralisation des ondes, de la parole (et notamment celle des marginalisés) pas forcément vu d’un bon oeil par ceux qui détiennent le pouvoir et… les bazookas pour éradiquer des mouches. On pourrait croire que c’était il y a des siècles mais non, c’était il y a moins de cinquante ans. Et Laurent Galandon et Jeanne nous font entrer dans ces cases de l’histoire avec l’image mais aussi le son. Interview avec Jeanne Puchol, autour de la radio d’hier et d’aujourd’hui, de Tac au Tac mais aussi de la situation actuelle du monde de la BD.

Ex-Libris pour BD Fugue © Galandon/Puchol chez Dargaud
Bonjour Jeanne,traiter de la radio mais sans le son, n’est-ce pas étrange ?
Mais il y a du son, des notes de musique, des chansons que les gens vont pouvoir fredonner. Le son, en BD, passe aussi par la forme des bulles. Puis, il y a aussi les bip bip, le brouillage de la TDF pour que le monopole ne soit pas entamé par ces radios pirate.
Mais, justement, cela ne revenait-il pas à utiliser un bazooka pour tuer une mouche ?
C’était en tout cas complètement disproportionné. C’étaient des radios bricolées, qu’on avait un mal fou à capter, qui faisaient 0 bénéf’. Alors pourquoi utiliser des camions de brouillage comme on le faisait lors de la Seconde Guerre Mondiale ?

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Qu’est-ce qui leur faisait peur à ce point ?
Laurent et moi, on n’a pas trouvé la réponse. Après, nous ne sommes pas des historiens. Moi, je pensais que c’était dû à la proximité de Mai 68, il y avait cette peur que ça recommence, que le mouvement s’amplifie et devienne une révolution, que la terreur renaisse de ces sens face à une conception gaulliste du pouvoir pour laquelle l’ORTF était la seule voix acceptable. J’ai aussi été très étonné que Giscard soit aussi sourd sur cette problématique alors qu’il a su être à l’écoute de pas mal de besoins de l’époque, des droits des femmes… Alors qu’en plus, à l’époque, la presse écrite avait une certaine liberté de ton, Libération réapparaissait. Je n’arrive pas à comprendre cette méfiance plus que de raison.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Qui n’allait pas jusqu’à l’arrestation, tout de même, comme pour votre personnage.
Non, il y avait des saisies, la destruction du matériel mais pas d’incarcération.
Et vous, vous avez vécu cette époque des radios pirates ?
Bien sûr, le vent des radios pirates soufflait, je le savais mais je ne m’y suis pas vraiment intéressée? J’étais à un moment de ma vie où j’avais la tête à autre chose. Je passais plus de disque que ce que j’écoutais la radio.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Mais, ça m’a rattrapée, quelques années plus tard, lors de la sortie de mon premier album. En tant qu’interviewée. Il y avait Radio Libertaire, Radio Fréquence Gaie et Aligre FM, ce sont ces radios libres, héritières des pirates, qui m’ont permis mes premières interviews. Le micro tenait avec du scotch dans cet appart’ aménagé en studio, c’était de l’impro totale. J’avais 25 ans, j’étais pétrifiée. Sur Fréquence Gaie, je me souviens qu’ils profitaient de la coupure musicale pour préparer ce qui allait suivre, j’étais effarée. Mais ce sont des bons souvenirs.
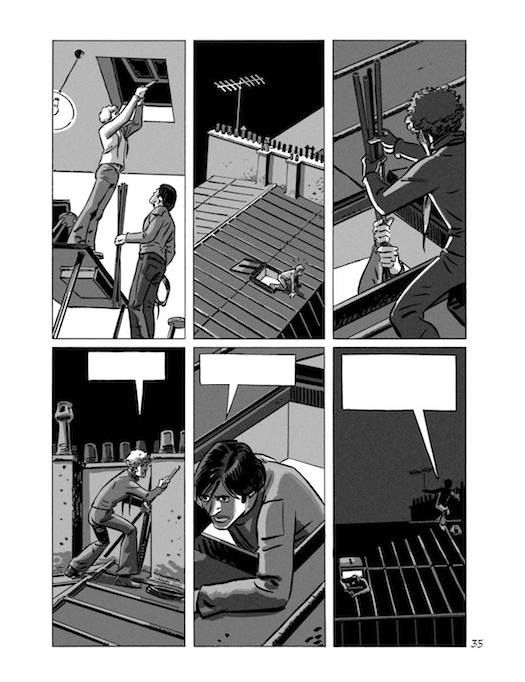
© Galandon/Puchol chez Dargaud
Comme avec Laurent avec qui vous collaborez pour la deuxième fois.
Oui, on avait commencé avec Vivre à en mourir, il y a quatre ans. On avait envie de retravailler et ce thème collait tout à fait avec mes préoccupations du moment. J’ai connu cette époque, j’ai le même âge que les protagonistes. Je pouvais donc y investir ce mélange de fougue et de naïveté, de qui j’étais. C’était très tentant de replonger.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Puis, Laurent, il a cette manière d’aborder la chronique sociale, d’amener une dimension humaine. Puis Interférences, c’est un peu le troisième volet d’une trilogie avec Le contrepied de Foué. C’est aussi une suite indirecte de LIP, qui avait permis à Laurent de découvrir ce monde des radios pirates. Laurent a ainsi appris que les militants enregistraient leurs revendications pour les diffuser ensuite. Ce n’était pas exactement de la radio en tant que telle mais le but était le même. Interférences restant un docu-fiction, une histoire inventée sur un arrière-plan qui restitue toute une époque.

Sur le plateau d’une émission de France Inter © Puchol
Laurent était projectionniste de cinéma dans une autre vie, ça se sent ?
Oui, rien que dans la représentation de l’émission de nos deux héros. C’est une longue séquence, quatorze planches de huis-clos, de la folie. Je me suis demandé comment j’allais mettre ça en scène.
Une époque qui démarre sur un formidable coup de bluff.
Sur TF1, Brice Lalonde, du parti écologiste, a fait croire qu’une radio, Radio Verte, émettait en dépit des réglementations. En réalité, au-delà de son petit transistor, il avait un complice dans la même salle qui émettait donc à très courte distance. Mais il a fait croire que c’était possible, c’était extraordinaire. Le PS, plus tard, allait en faire un argument électoral. En la voyant telle qu’elle était, une nécessité, un moyen d’entendre les gens qui d’ordinaire n’avait pas voix au chapitre.
Sur le tard, l’Italie, elle, n’avait pas attendu autant de temps et fournissait les « pirates ».
En 1976, le pays avait connu la libéralisation des ondes, c’était le pays par excellence où l’on pouvait aller chercher du matériel et des conseils.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Et comment ne pas évoquer Radio Caroline, mise en scène dans le fabuleux Good Morning England, d’ailleurs, pour tout vous dire, j’avais un peu peur que votre album soit redondant. Loin s’en faut.
C’est toute l’habileté du scénario de faire intervenir ce précurseur qui croisait dans les eaux internationales, dans l’illégalité tout en pouvant faire ce qu’ils voulaient. Et si nos deux héros vont croiser deux anglaises en France qui vont leur permettre de toucher à cette culture, ils vont aussi faire la rencontre déterminante de Douglas. Un ancien technicien de Radio Caroline. Après, c’est un hâbleur, dit-il vrai ou pas, la question est posée. C’est lui qui va les pousser à se lancer dans la radio pirate, ça va faire tilt.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Pablo et Alban sont vos deux personnages principaux, totalement différents, l’un faisant sa crise de bourgeoisie, l’autre venant d’une famille plus prolétaire. Comment crée-t-on graphiquement des personnages pareils ?
En respectant un BA-ba obligé quand on a affaire à deux personnages constamment à l’écran : il faut les faire les plus différents possible. Pablo est espagnol, plus trapu. Alban, lui, est blanc, blond, très clair. Après, comme on cherchait un binôme, Laurent m’a proposé Starsky et Hutch; moi, je pensais plus à Simon and Garfunkel, j’ai fait ma tambouille sur cette base.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Et maintenant, la radio, vous l’écoutez plus ?
Plus maintenant qu’à 20 ans, c’est un fait. Après, je dois bien concéder que je suis très service public: RFI, FIP, France Culture. Sans compter que j’ai toujours mes bons vieux disques.
Justement, notre culture musicale serait-elle la même s’il n’y avait pas eu ces radios pirates qui ont amené pas mal de groupes anglo-saxons désormais cultes ?
C’est évident, la bande-son est emblématique. Après, à part Satisfaction des Stones, je dois avouer que je n’étais pas très familière des groupes dont on joue quelques morceaux dans l’album. Je suis plus pop et folk, j’ai découvert des chansons grâce à Interférences.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Mais, pour représenter les chansons, j’ai dessiné les vraies notes, j’ai recherché les partitions. C’est important d’être précis, crédible face aux lecteurs dont certains sont sans doute musiciens. Bon, je n’ai pas mis les portées…
Puis, je trouve ça bien d’avoir mis en fin d’album, la liste des morceaux auxquels on fait référence. Ainsi, on peut écouter la BO pendant la lecture.
Et tant qu’à rester dans le sonore, il y a aussi une pièce radiophonique.
Exact ! Interférences était en cours de réalisation lorsque Laurent a participé à un stage d’adaptation/écriture radiophonique… Et c’est avec Éric Barral, de la radio libre Radio Méga, que Laurent a discuté. Pour créer la BD puis en vue d’en faire une pièce radiophonique, aidé par quelques moyens techniques de Dargaud. Cette pièce, elle est accessible via un QR code dans l’album. Puis, elle est disponible auprès de radio Méga pour toutes les radios libres qui souhaiteraient l’utiliser. Il doit y en avoir 600 locales/associatives, les petites-filles des radios pirates dont nous parlons.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Puis, on l’a également diffusée dans un cinéma devant 100 personnes qui ont pu l’écouter dans une qualité sonore optimale, avec du relief. Il y avait le son mais plus les images, sauf pour moi !
Et les couleurs en nuances de gris.
Oui, je voulais rester dans l’idée et l’esthétique de LIP même si mon dessin est différent de celui de Damien Vidal. C’était une occasion de me rapprocher de ce que je faisais à mes débuts en diluant de l’encre de chine mais avec, en plus, l’envie de l’outil informatique. Puis, ça me ramenait à mes études de photographie, à la photo argentique en noir et blanc. Tout en me dégageant de ce que j’avais fait sur Malik Oussekine dans un noir et blanc frontal. Les niveaux de gris amènent ici une sorte de tendresse amusée.
Vous parliez de l’improvisation de vos premières interviews. Trente ans après, vous avez refait de l’improvisation dans un autre genre : Tac au tac renaît et vous y avez participé.
Au départ, il y a deux ans, quand j’ai été contactée pour mettre en boîte l’épisode-pilote, j’étais sceptique : j’avais revu les anciennes émissions, historiques, j’ai trouvé ça lent, long. Aujourd’hui, la technique a changé et ça se sent dans nos modes de fonctionnement, après cinq minutes, on zappe. Je ne concevais pas que Tac au tac puisse s’adapter à l’impatience du spectateur actuel.
Ce pilote a servi au réalisateur pour régler la question technique. Finalement, dans un format court avec deux équipes de deux ou trois dessinateurs, le résultat est, je trouve, prodigieux. Un jeu d’une heure est ramené à quinze minutes, on voit à peine les coupes, c’est fluide. En temps réel, cela représente quatre heures de tournage pour trois jeux différents. À l’antenne, je crois qu’on ne s’en rend pas compte. Quant à l’impro, c’est génial, j’étais associée à Davy Mourier et Sylvie Fontaine. C’était un régal tant au niveau du texte que du dessin.
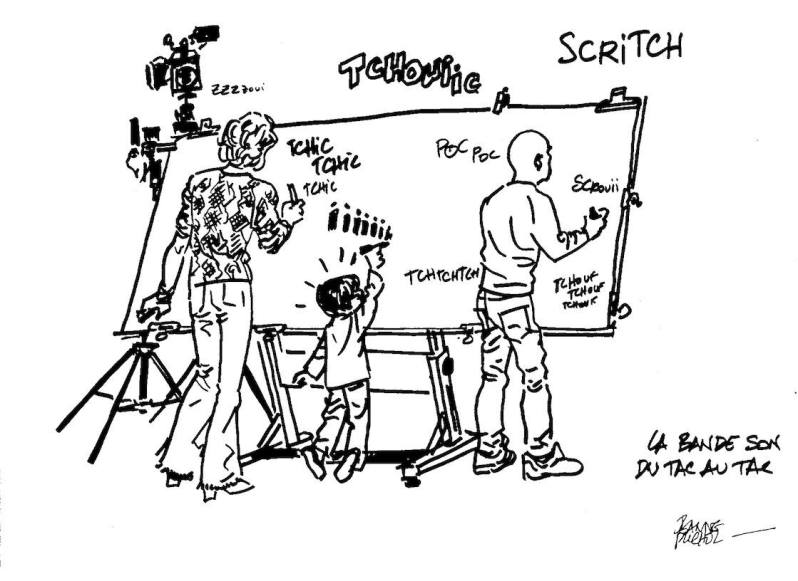
© Puchol
Vous « fêtez » vos 35 ans de carrière, quel regard jetez-vous dessus ?
Ça dépend des jours. Parfois, c’est de l’incrédulité. 35 ans, c’est quand même un bail. Je suis heureuse, en tout cas. Certes, ce n’est pas toujours simple mais ça ne l’est pour personne. Après, le monde de la BD a pas mal changé, comme le monde en fait. Ainsi, je donne des cours d’illustrations pour adultes. Lors du dernier cours, je reviens en général sur toute la fabrication d’un livre. C’est fou de se plonger là-dedans. Des débuts artisanaux chez Futuropolis, les repros etc., à ce qu’est devenue la chaîne graphique avec l’intrusion des technologies. Aujourd’hui, l’imprimerie est pilotée par ordinateur, c’est propre.

© Galandon/Puchol chez Dargaud
Après, concernant la production, il y a déjà un certain temps, je me souviens avoir assisté à des conversations durant lesquelles les libraires tiraient la sonnette d’alarmes parce que 700 albums paraissaient par an. On était encore loin de ce qu’on connaît aujourd’hui. Certainement, la production actuelle est inquiétante et pose la question du modèle qui va bien pouvoir intégrer cette nouvelle donne, mais, d’un autre côté, il y a tellement de choses formidables.
C’est sûr, je préfère avoir 60 ans, aujourd’hui, que 30 ans, mais en y réfléchissant, je me suis adaptée. Et je suis convaincue que personne n’est capable d’imaginer ce que sera le monde de sa maturité, à tous les niveaux. Actuellement, le monde de la BD connaît un moment critique, ce n’est pas normal que des auteurs ne vivent pas de leur métier comme il n’est pas normal que des livres doivent être détruits parce qu’ils ne sont pas vendus. Mais je suis confiante, des crises, je dois en avoir vécu deux. Le prochain modèle, on ne peut pas encore l’imaginer mais il arrivera.
La suite pour vous ?
Ce n’est pas encore décidé. Certains mitonnent, on verra.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Interférences
Récit complet
Scénario : Laurent Galandon
Dessin et couleurs (nuances de gris) : Jeanne Puchol
Genre : Drame, Histoire
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 128
Prix : 17,99€
 |
©BD-Best v3.5 / 2025 |
|
Dimanche 6 avril 2025 - 15:35:06
|